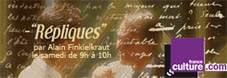Introduction par Florian Delorme : « Galilée – Descartes : une autre représentation du monde est-elle possible ? » avec Étienne Klein et Olivier Rey.
À l’aune du XVIIe siècle naissait la science dite moderne, celle initiée par Galilée. Sa visée n’a rien à voir avec l’étude de la nature d’Aristote. Il s’agit désormais de découvrir les lois qui régissent la nature en saisissant toujours plus finement leur langage mathématique. Dès lors, les promesses de la science modernes se veulent gigantesques, fabuleuses. Elles jurent de révéler aux hommes la réalité des hommes. Elles s’engagent même à calmer leurs tourments. Dans la lignée de Galilée, Descartes affirmait dans le Discours de la méthode que l’homme devait devenir comme maître et possesseur de la nature. Mais si l’objectif alors recherché était de tirer de la maîtrise technique de la nature un meilleur confort pour les hommes, il semblerait qu’il ait quelque peu dévié. Sans conteste depuis Descartes, notre emprise sur le monde s’est amplifiée de manière prodigieuse à tel point que le développement techno-scientifique s’emballe, nous donnant l’impression d’échapper à notre contrôle. Nous serions-nous fourvoyés sur le long chemin du développement scientifique et technique ? Pourquoi les sciences et les techno-sciences, plutôt que d’éclairer l’humanité, se mettent-elles à l’effrayer ? Le projet philosophico-scientifique initié par Galilée et Descartes a-t-il mené l’homme dans une impasse ? Nous serions-nous coupés de la nature ? Comment repenser notre rapport avec elle ? Ce seront certaines de nos questions du jour.
Et pour répondre à ces questions, ce matin nous avons invité Étienne Klein, qui est physicien, professeur à l’École centrale. Vous dirigez, Étienne Klein, un laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, au Commissariat à l’énergie atomique et vous venez de publier chez Flammarion, Galilée et les Indiens. Bonjour Étienne Klein.
Étienne Klein : Bonjour.
Florian Delorme : A vos côté, Olivier Rey, qui est chercheur en mathématique à Polytechnique, qui enseigne la philosophie à Paris I et qui est l’auteur, lui, d’Itinéraire d’égarement, sous-titré du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine et qui est paru chez Seuil en 2003. Bonjour, Olivier Rey.
Olivier Rey : Bonjour.
Florian Delorme : Alors, Étienne Klein, on va peut-être commencer avec vous, on vous connaît bien, vous vous êtes beaucoup intéressé notamment à la question du temps physique, ses implications dans le champ de la philosophie, or cet ouvrage que vous venez de publier est né d’une rencontre un petit peu particulière, celle avec des chefs Indiens, les Kayapos et c’est cette rencontre qui a suscité chez vous une réflexion sur ce que l’homme a fait du monde, sur sa vision de la nature héritée finalement de Galilée et de Descartes. En quoi cette rencontre a bouleversé le scientifique que vous êtes, Étienne Klein ?
Étienne Klein : En fait les questions que vous me posez, je me les posais avant de rencontrer ces chefs Indiens, chez une amie anthropologue, un peu par hasard d’ailleurs. Cette rencontre a cristallisé ces questions au point que je me suis senti obligé de me les poser vraiment. En fait, comme vous l’avez dit, je suis physicien et je suis plutôt fasciné par la physique. L’efficacité des mathématiques en physique a quelque chose d’impressionnant. On n’est plus dans la description des régularités de la nature, au XXe siècle notamment les mathématiques en physique ont agi comme une sorte de treuille ontologique. On a pu, par exemple, prédire avec des arguments mathématiques l’existence de nouveaux objets physiques, de particules qu’on n’avait jamais vues ou qui étaient même de nature différente de toutes celles qu’on connaissait. Je pense à l’antimatière, aux bosons intermédiaires que médiatisent les forces nucléaires, aux quarks etc. Donc, il y a dans cet acte fondateur de Galilée, qui décrète que le langage de la nature ce sont les mathématiques, quelque chose qui a mon montré une efficacité absolument bouleversante puisqu’on est capable aujourd’hui de raconter les 13,7 derniers milliards d’années de l’univers. En même temps, je sentais bien que la science et la société, comme on dit, ont des relations qui se reconfigurent, qui deviennent problématiques. Il y a de plus en plus de controverses, il y a même des crises et j’avais un peu de mal à comprendre l’origine de ces crises, à les analyser. Et cette rencontre avec les indiens m’a en quelque sorte décidé. Comme les scientifiques des sciences dures en général ne lisent pas les anthropologues, j’avais un rapport très, très naïf à ce que pouvait être ces cultures-là. Je me suis rendu compte en discutant avec eux que ce sont des êtres tout à fait rationnels, qu’ils manipulent le concept du tiers-exclu, qu’ils invoquent la causalité, qu’ils ont une pensée conceptuelle et donc, ce qui nous distingue d’eux ce n’est pas du tout la rationalité, comme on le croit trop souvent, c’est en fait les mathématiques, ou plutôt la science. La science dite moderne. Leur rapport à la nature n’a pas subi cette métamorphose radicale que l’acte fondateur de Galilée a créé, chez nous. Finalement, que dit Galilée ? La nature est quelque chose de clos sur elle-même, qui est régi par des lois mathématiques, que la physique a pour mission de découvrir, donc la nature est quelque chose de différent de nous, nous sommes en quelque sorte des êtres d’antinature, nous sommes dans la nature certes mais nous sommes en quelque sorte différents d’elle, nous sommes des êtres transcendants etc. Or, pour les indiens que j’ai rencontrés, et après avoir lu Lévi-Strauss, je me suis rendu compte que cette séparation qui existe chez nous, n’existe nulle part ailleurs. Pour eux, l’humanité ne s’arrête pas à l’humain. L’humanité inclut l’air qu’ils respirent, le gibier qu’ils chassent, les végétaux dont ils se nourrissent, le fleuve qui contient les poissons qu’ils pêchent etc.
Florian Delorme : Étienne Klein, tout à l’heure vous me disiez, avant l’émission, que vous ne vouliez pas que l’on vous présente comme un philosophe, est-ce que ces Indiens sont des philosophes ?
Étienne Klein : Je pense qu’il faut leur demander. Ce n’est pas à nous de décréter qu’ils ont telle ou telle capacité. En tout cas, ils ont réfléchi aux problèmes que posent chez eux notre développement puisque finalement s’ils étaient venus à Paris, -il faut peut-être préciser que je les ai rencontrés à Paris et non pas en Amazonie - c’est parce qu’ils venaient plaider leur cause auprès d’instances intergouvernementales. On veut construire un barrage qui les menace, qui menace leur écosystème, et ils essayaient de défendre leur cause à cette occasion.
Florian Delorme : Olivier Rey, vous qui n’êtes pas non plus un philosophe mais vous enseignez la philosophie. Vous êtes l’auteur, je le disais de l’Itinéraire de l’égarement - Du rôle de la science dans la société contemporaine. En quoi, selon vous, la science a-t-elle été victime ? En quoi ses prétentions, ses promesses, les illusions qu’elle a suscitées parfois, ont-elles dévié du projet initié par Galilée et Descartes ?
Olivier Rey : Comme Étienne Klein l’a bien souligné et comme vous l’avez dit vous-même dans votre introduction, la science dont on parle c’est la science moderne, c’est-à-dire une science tout à fait particulière qui est née, pour fixer les idées, à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, et qui a vraiment une singularité dans la pensée humaine. Par rapport à la science qui la précédait, qui valait dans l’Antiquité que nous connaissons et à l’époque médiévale, cette science était la science d’un monde que l’on peut appeler un cosmos, mot grec qui originellement ne renvoyait pas du tout à l’ensemble des choses mais désignait un ensemble harmonieux, un ensemble bien ordonné, ce n’est que relativement tardivement que les philosophes grecs se sont emparés de ce mot pour parler de l’ensemble de ce qui est. Mais en parlant de cosmos, les Grecs entendaient essentiellement une harmonie, ce qui veut dire que la science d’un monde qui est d’emblée conçu comme une harmonie est une science à l’intérieur de laquelle il n’y a pas de rupture entre la question des faits et la question des valeurs. C’est pour ça d’ailleurs que Rémi Brague a d’ailleurs pu parler au sujet des anciens d’une éthique cosmologique et d’un cosmos éthique. Il n’y a pas de séparation, dans ce monde des anciens entre encore une fois les questions de faits et les questions de valeurs puisque le monde en lui-même, tel qu’il est a une valeur. La science moderne, elle, signe l’arrêt de mort du cosmos. Le grand livre qui expose cette transition, c’est celui d’Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini. Et quelque chose qui n’a pas été forcément vue d’emblée mais qui va avoir des répercussions absolument gigantesques par la suite, c’est que la science moderne qui s’édifie avec cet idéal de mathématicité place d’emblée le monde en dehors du bien et du mal. Et donc, là, on va vivre dans une séparation radicale entre la question des faits, dont s’occupe la science, et la question des valeurs qui va être envoyée du côté, on peut dire par exemple, de la morale, de la politique mais de manière complètement distinguée. Et on passe à ce moment-là de ce qu’on pourrait appeler la raison objective à la raison subjective. La raison objective, c’était une raison qui était censée être dans le monde, dans le cosmos et le rôle de la raison humaine était de mettre l’homme en conformité avec cette harmonie du monde, de le mettre à la bonne place à l’intérieur de cette harmonie. On va passer avec la science moderne ensuite à une raison subjective qui vise essentiellement à ordonner des moyens en vue de fins qui se décident en dehors d’elle. La science ne s’occupe pas justement de ces fins. Et l’égarement, je pourrais dire, ou le malentendu, vient du fait que par inertie on a continué, je dirais, à demander à la science moderne des choses qui par nature elle ne pouvait plus donner. C’est-à-dire qu’on a continué à demander à la science moderne qu’elle fournisse des réponses à des questions - « Comment se diriger dans la vie ? » par exemple - qui étaient du ressort de la science ancienne en tant qu’elle était science d’un cosmos mais auxquelles la science moderne ne peut pas répondre dans la mesure où justement elle a mis entièrement les questions de valeur, de bien et de mal de côté.
Florian Delorme : La science n’a rien à dire sur l’existence de la vie des hommes, Olivier Rey ?
Olivier Rey : Elle a énormément de choses à dire mais ce n’est pas elle qui peut dire ce qui doit être –d’ailleurs Étienne Klein, dans son livre, je l’ai relevé ici, cite une phrase d’Einstein, qui dit : « Il est évident qu’il n’existe aucun chemin qui conduise de la connaissance de ce qui est à celle de ce qui doit être. » Voilà. A partir du moment où l’on demande à la science de répondre à des questions sur ce qui doit être, je pense que là il y a égarement.
Florian Delorme : L’un et l’autre, vous vous êtes lancés dans l’aventure scientifique, est-ce que vous ne vous êtes pas lancés dans cette aventure pour donner justement du sens à votre vie ? Et, est-ce que vous y êtes parvenus finalement ?
Etienne Klein : Quand j’étais jeune, j’étais tellement naïf qu’à cette question je n’aurais même pas répondu. Oui, je pensais effectivement que les physiciens étaient des gens qui avaient le pouvoir de changer le monde et de le rendre adéquat au désir qu’ils avaient qu’il devienne. Cette phrase d’Einstein exprime ce que, je crois, les philosophes appellent la loi de Young, c’est-à-dire qu’il y a effectivement séparation entre les faits et les valeurs et on a construit la science avec cette idée. La science ne nous dit pas ce que nous devons penser, mais elle nous montre ce que nous ne pouvons plus croire. Ce qui est déjà pas mal. D’autre par, moi, je crois que cette séparation qui existe, qui est légitime, n’est pas aussi étanche qu’on le pense, pour trois raisons. La première c’est que, par exemple, le fait de savoir qu’on appartient à un univers à 13,7 milliards d’années d’âge, dans lequel l’homme n’est apparu qu’il y a 2 millions d’années, fait que nous nous situons dans le cosmos, on devrait plutôt dire dans l’univers pour reprendre un terme inventé par Galilée, d’une façon qui est différente de celle que conçoivent ceux qui pensent que l’univers à 6 mille ans et qu’ils sont nés en même temps que les dinosaures, dans l’état qu’ils ont aujourd’hui. Donc, ce que nous appris la science change notre place dans le monde, nous décale en quelque sorte et ça, c’est une connaissance qui a une certaine valeur. Le deuxième argument qui nous ramène, là, plutôt vers la physique, c’est que la physique produit parfois, rarement mais quand elle le fait c’est très spectaculaire, des résultats qui correspondent à des découvertes philosophiques négatives, expression qui a été inventée, en 1939, par deux des pères de la mécanique quantique, London et Power, qui proposent cette expression à la fin d’un de leurs articles sur la théorie de la physique quantique. Qu’est-ce qu’ils veulent dire par là ? Que la physique ne vient pas contester la philosophie, la remplacer, tenter de se mettre à sa place mais que sur certaine questions philosophiques elle vient apporter des résultats qui viennent éclairer, peut-être contraindre, l’ensemble des réponses philosophiques qu’on peut apporter à cette question philosophique. Vous avez parlé de la question du temps. À propos du temps, les philosophes ont beaucoup disserté, apporté des choses évidemment très importantes et cruciales, mais la physique aussi a apporté des choses. Il y a une sorte de pensée qui vient se revivifier dès lors qu’elle s’intéresse à ce que la physique exhibe à propos des questions que discutent les philosophes. Par exemple la découverte de l’antimatière, nous dit des choses sur le principe de causalité, c’est-à-dire en fait sur le temps. Évidemment, si l’on sépare les disciplines, on ne voit pas cette fécondité, cette potentialité qu’à la science de rayonner en dehors d’elle-même. La troisième raison, c’est qu’il me semble que les progrès scientifiques ont de la valeur. Le fait de savoir a de la valeur. Du coup, si j’ai écrit ce livre, c’est aussi parce que j’ai une certaine inquiétude qui est qu’au motif que l’universel qu’exhibe la science est incomplet, évidemment la science ne répond qu’aux questions scientifiques, ça on en prend acte, la science ne répond qu’aux questions scientifiques, ça nous déçoit parce qu’on avait espéré mieux, mais le fait est…
Florian Delorme : Sauf qu’elle nous apprend quand même des choses sur notre existence. Quand on connaît par exemple l’histoire de l’univers, on connaît quelque part aussi notre histoire.
Étienne Klein : Voilà, disons qu’en premier ordre la science ne répond qu’aux questions scientifiques. Ces questions scientifiques en fait ne nous intéressent pas. Pourquoi est-ce que l’antimatière a disparue de l’univers primordial ? En gros, tout le monde s’en fiche. Comment est-ce que les particules ont acquis de la masse, dans l’univers primordial ? C’est ce qu’on essaye de montrer avec le LHC, ce collisionneur qui va démarrer au CERN, à peu près tout le monde s’en fiche. Donc, on ne s’intéresse pas aux questions scientifiques et du coup sous prétexte que la science ne répond pas aux questions qui nous importent vraiment, sur la justice, la liberté, le vivre ensemble, l’amour etc., le sens de la vie d’une façon plus générale, eh bien, je crains qu’on liquide la science au motif que l’universel qu’elle exhibe est incomplet.
Olivier Rey : Sur la connexion, malgré tout, entre les faits et les valeurs au sein de la science moderne, il y a quelque chose qui reste dans l’ombre mais qui est malgré tout omniprésent, c’est le fait que des faits il y en a une infinité et que le simple fait de désigner un fait implique un jugement de valeur. On ne s’intéresse pas à n’importe quel fait et le fait de considérer un fait plutôt qu’un autre - d’ailleurs c’est intéressant de voir l’ambigüité même qu’il y a dans le mot fait puisqu’on emploie le mot fait pour désigner ce que personne n’a fait et en même temps c’est le participe passé du verbe faire, c’est-à-dire que c’est nous qui faisons aussi le fait. Alors, ce qui se passe au sein de la science moderne, à partir du moment où elle se donne comme idéal la mathématicité, pendant assez longtemps, je dirais que la sélection des faits auxquels elle s’est intéressé a été plus ou moins imposée par la méthode, c’est-à-dire qu’on s’est intéressé aux faits qui étaient susceptibles d’être traités mathématiquement. Si on s’est intéressé par exemple beaucoup au début à l’astronomie, ça n’était pas forcément qu’on était absolument polarisé sur la trajectoire des astres, mais c’était parce qu’on avait depuis très longtemps vu qu’il y avait des régularités dans la trajectoire des astres et donc s’il y avait un endroit où la mathématicité devait s’appliquer c’était à cet endroit. Alors, il se trouve qu’aujourd’hui, avec le développement extraordinaire des instruments scientifiques qui permettent d’avoir accès à une étude de l’étant beaucoup plus étendue qu’auparavant, nous sommes renvoyés à une question véritablement de choix dans les domaines de l’investigation scientifique. Donc, là, évidemment il va y avoir des questions de valeur qui vont être impliquées dans le fait qu’on cherche dans telle ou telle direction. Mais cela étant, souvent, ces questions de valeur qui interviennent dans la sélection des orientations scientifiques sont évacuées, tout ça se passe dans une pénombre, une certaine obscurité.
Florian Delorme : Mais si la science ne nous apporte pas de réponse à tout, si elle n’est pas capable de dire comment est-ce qu’il convient de se conduire, si elle ne dit rien sur le sens, c’est qu’elle n’est finalement pas si importante que ça, c’est que les connaissances qu’elle apporte sont toutes relatives, Étienne Klein ?
Étienne Klein : Relative, je ne vais pas aimer ce mot. Simplement, je pense qu’il y a eu ce qu’on pourrait appeler une allotélie, c’est-à-dire que le but atteint est différent de ce qui était visé. On n’est pas arrivé à l’endroit que l’on avait visé, en tout cas que les fondateurs de l’idée de progrès, le siècle des Lumières par exemple, avait envisagé. Il me semble que chez Galilée, il y a l’idée que la science, la physique en l’occurrence, ne peut devenir puissante que si elle limite ses ambitions. Il y a de très beaux textes de Galilée dans lesquels il dit : si l’on veut avancer on doit renoncer à vouloir répondre à toutes les questions, on doit choisir les problèmes dont on pense qu’on pourra les résoudre grâce à une démarche qui allie la théorisation avec l’aide des mathématiques et l’expérimentation. Autrement dit, si l’on veut connaître la nature, il ne faut plus lire des livres, il faut aller chercher la vérité. Ce n’est pas l’observation qui va nous aider, il faut théoriser puis expérimenter. Il y a quelque chose d’assez humble chez Galilée. Il dit, par exemple à propos du temps : je ne m’intéresse pas à la question de la nature du temps, je me pose simplement la question de savoir comment je dois le représenter dans une équation pour qu’il devienne une variable pertinente me permettant de traduire une loi naturelle. Il est le premier à introduire ce paramètre temps dans une équation pour décrire la chute des corps. En fait, cette posture humble au départ va avoir une efficacité tellement grande qu’au XIXe siècle notamment on va penser que la science qui est si efficace va pouvoir répondre à toutes les questions que nous nous posons. Ça, c’est un courant que l’on appelle le scientisme. Le scientisme est en mauvaise santé aujourd’hui. Le XXe siècle est passé par là. Il y a eu les remarques dont celles qu’Olivier Rey vient de rappeler, c’est-à-dire la science n’éclaire pas le sens, etc. donc, il reste des tas de questions pour lesquelles nous sommes orphelins, en tout cas nous ne bénéficions d’aucune aide venant de la science pour les traiter. Il me semble que nous sommes dans une situation où l’on doit comprendre que dans cette histoire, le meilleur ennemi de la science ça a été le scientisme parce qu’il a créée une attente qui ne pouvait être que déçue. Donc, le scientisme a organisé la déception et puis, surtout, ses outrances et ses excès ont produit un deuxième ennemi de la science, qui est en quelque sorte son symétrique, qui s’appelle le relativisme. C’est-à-dire que finalement, les connaissances scientifiques sont des connaissances comme les autres, elles procèdent de récits, elles sont des constructions humaines, on peut les accepter ou bien les contester selon l’opinion qu’on s’en fait, etc. alors qu’à mon avis même si la recherche c’est effectivement l’exercice du doute, les chercheurs doutent, par exemple ceux qui essayent d’aller au-delà de ce qui est connu en matière de physique des particules pour aller à des énergies plus élevées ils explorent plusieurs pistes, ils ajoutent des dimensions d’espace-temps, ils mettent de la super symétrie, ils testent, envisagent des tas de modèles différents et ils doutent, ça c’est la recherche. Il y a des connaissances scientifiques dont nous ne devons plus douter, par exemple que l’atome existe, que la théorie de la relativité, c’est la bonne théorie de l’espace-temps, etc. Il me semble que le relativisme lorsqu’il est absolutisé, si j’ose dire, devient un ennemi très dangereux. Non pas que la science atteigne le vrai, mais ce qu’elle a conquis, elle l’a conquis de hautes luttes, selon une démarche qui n’a pas de concurrent possible.
Olivier Rey : Je pense qu’il faut sortir de la dichotomie : « ou la science est tout, ou la science n’est rien », soit elle doit répondre à tout, soit elle n’est pas capable de répondre à tout et à ce moment-là elle ne vaut rien il faut la jeter à la poubelle. Il y a un proverbe delphique que j’aime beaucoup et qui dit : « La moitié est plus que le tout. ». Justement, ce qui fait la valeur de la science c’est qu’elle répond à certaines questions mais elle ne répond pas à d’autres. De toute façon tout discours qui prétend répondre à tout, je pense que si véritablement cette ambition était remplie, s’annihilerait de lui-même. De plus, on a tendance aujourd’hui, où nous sommes confrontés à certains problèmes très urgents du fait d’un certain déchainement technologique, à oublier qu’avant que ces problèmes se posent la technique, le technologie, on pourrait dire, la technique en tant qu’elle est issue du développement scientifique moderne, a aussi, pour nous, résolu un grand nombre de questions. Il y a toujours une tendance à l’ingratitude qui vient de l’oubli des problèmes résolus. Et aujourd’hui par exemple on se pose des questions sur les maladies induites par le développement, il n’en reste pas moins que l’espérance de vie par exemple a été énormément augmentée du fait du développement scientifique depuis quelques siècles.
Florian Delorme : Tout à l’heure Étienne Klein, vous disiez qu’on était devenu des êtres d’antinature. Alors, est-ce qu’il faudrait redéfinir notre rapport à la nature aujourd’hui ? Et surtout qu’elles pourraient être les modalités de ce nouveau rapport ?
Étienne Klein : Oui, j’ai parlé tout à l’heure de la coupure galiléenne. La coupure galiléenne c’est donc l’idée d’une nature autonome mathématisée et ça donne la science moderne, puis, quand on ajoute Descartes à Galilée, ça fait cette exploitation parce que cet asservissement de la nature etc. Donc, d’une part des connaissances très originales produites par la science, d’autre part une utilisation de la nature qui aujourd’hui nous pose des problèmes puisqu’on l’avait considérée comme infinie, solide et on se rend compte qu’elle est fragile, réactive et que finalement nous allons bientôt, et nous dépendons d’ailleurs déjà de choses qui dépendent de nous. Je pense aux changements climatiques, à des choses comme ça. Nous avons un problème avec l’environnement qui va certainement nécessiter que nous changions notre mode de vie, notre relation à la nature. Le risque…
Florian Delorme : En quoi ?
Étienne Klein : On va en discuter mais il me semble que déjà il y a un risque. Le risque c’est de jeter le bébé scientifique avec l’eau du bain écologique. C’est-à-dire de considérer que c’est la science qui nous a menés à ce problème-là de relation avec l’environnement. Or, il me semble qu’aujourd’hui, nous avons beaucoup plus à faire dans nos vies quotidiennes, dans notre façon de vivre, dans notre façon de travailler, de communiquer etc. à une techno-science, comme on dit, qu’à la science. En gros, depuis la Seconde guerre mondiale, la science est devenue en partie techno-science, c’est-à-dire qu’elle s’est enrobée d’un halo très diffus, qui masque d’ailleurs complètement ce que j’appelle, moi, l’esprit de la science, c’est-à-dire la volonté de comprendre le monde et non pas de transformer nos vies. Et cette techno-science diffuse à peu près dans toutes nos activités et, au contraire de ce qu’on avait pu espérer du temps des Lumières, nous n’avons pas fabriqué une société de la connaissance nous avons fabriqué une société des usages des technologies. Ça, c’est quelque chose qui pose aujourd’hui des problèmes parce que nous manipulons des objets (téléphone portable et autres) dont nous ne comprenons pas le fonctionnement et avec lesquels finalement nous avons un rapport magique. Donc, tout se passe comme si la techno-science qui fabrique des objets, des outils, qui créée des désirs parce qu’elle s’accompagne de publicité, elle créée des désirs que nous n’avons pas spontanément etc., cette techno-science masque la science et on la considère, notamment dans l’enseignement, dans les écoles d’ingénieurs par exemple, comme si elle était autonome par rapport à la science. La techno-science est enseignée, vécue comme si elle s’était émancipée de la source qui l’a rendue possible.
Olivier Rey : Je suis content qu’Étienne Klein aborde cette question parce qu’effectivement depuis le début nous avons parlé de la science moderne comme si nous étions toujours dans la science moderne et on peut se poser la question si cette science moderne n’a pas trépassé au cours du XXe siècle. Jean-François Lyotard, « Dans la condition postmoderne » avait bien analysé notre nouvelle situation. Il parlait des deux grands récits qui avaient soutenu le développement scientifique moderne depuis quelques siècles. Pour aller très vite, d’un côté le récit de l’émancipation, c’est-à-dire que la connaissance scientifique va permettre à l’homme de prendre son autonomie par rapport aux anciens ordres qui l’asservissaient, on pourrait dire que c’est un récit plutôt français. Puis le récit spéculatif, l’accomplissement de la vie de l’esprit, c’est le grand récit qui a porté l’université allemande au XIXe siècle…
Florian Delorme : Mais sur la question de la redéfinition et notre rapport à la nature, tout à l’heure Étienne Klein disait : il y a le risque de jeter le bébé scientifique avec l’eau du bain écologique. Est-ce que vous pensez qu’il y a quelque chose de ça ?
Olivier Rey : Je termine juste sur cette question. En fait le XXe siècle a été extrêmement cruel avec ces grands récits puisqu’on a vu que la science ne servait pas forcément l’émancipation humaine et ne servait pas forcément l’esprit. Elle pouvait tout à fait aller avec une nuit de l’esprit et ça a nourri le passage à un nouveau régime postmoderne du savoir scientifique où ce sont les critères d’efficacité qui deviennent absolument déterminants, qui prennent le pas sur toutes les autres considérations, y compris le vrai qui était censé être le but ultime de la science exacte, elles obéissent essentiellement au principe de l’optimisation et des performances, en anglais « it works », il y a une expression très laide en français qui se répand beaucoup et qui est : « ça le fait », finalement c’est un peu un principe général y compris dans la pratique scientifique aujourd’hui. D’ailleurs, il y a quelque chose de tout à fait frappant c’est les mutations de vocabulaire, la modernité a imposé le terme de savant contre le terme ancien qui était celui de docte. Il y avait les doctes du Moyen-âge et il y a eu les savants de l’ère moderne. Aujourd’hui, la fin du XXe siècle a vu la fin des savants et le remplacement des savants par des chercheurs. Et le but premier du chercheur ce n’est pas le vrai mais l’innovation. Donc, là, on voit bien la transition. Ça m’a beaucoup frappé, on est vraiment en plein là-dedans. Le CNRS, qui est en plein réaménagement, comme vous le savez, a récemment changé de logo et le vocabulaire qui accompagne ce changement de logo est absolument révélateur, je vous lis, juste la phrase : « pas tout à fait rond, novatrice, la forme du logo figure le processus même de la recherche toujours en devenir et évoque la matière mise à la disposition de nos chercheurs par notre planète - donc, la planète en tant que matière première – une matière malléable prête à se livrer aux expertises de la recherche scientifique comme de la motte de terre glaise dans la main du sculpteur ». Ce sont des termes grotesques des experts en communication mais en même temps en voit très bien cette évacuation totale du souci du vrai au seul profit d’emprise.
Florian Delorme : Sur cette question du risque de l’écologie et de jeter le bébé scientifique, comme disait Étienne Klein tout à l’heure, avec l’eau du bain écologique, vous êtes d’accord avec Étienne Klein, il y a un risque vraiment important de ce point de vue ?
Olivier Rey : Étienne Klein, le disait très bien. On est dans l’opposition de plus en plus tranchée entre deux discours, un discours qui d’un côté, comme je viens de le lire, est absolument dans l’emprise. On peut le comprendre aussi puisqu’en fait nous avons développé la science pour nous rendre maître de la nature, mais ce faisant nous avons déchaîné une telle puissance que nous sommes devenus esclave de cette puissance. Aucun État aujourd’hui qui veut continuer à jouir d’une certaine autonomie sur la scène mondiale ne peut se permettre de dire nous allons rompre avec ce mouvement scientifique. Puis, en même temps, vous avez un discours radical de l’autre côté qui vous dit : « Tout cela nous mène à l’abîme, il faut tout jeter ».
Florian Delorme : Finalement, si je vous comprends bien, avec cet exemple du CNRS, selon vous, il faut finalement redéfinir les contours de l’activité scientifique, il n’y a pas quelque chose de ça aussi ?
Olivier Rey : Si vous voulez, là en l’occurrence moi, je ne suis pas en train de dire voilà ce qu’il faut faire, voilà ce qu’il ne faut pas faire. Je pense que là, actuellement on est soumis à des forces qui s’imposent à nous comme une forme de destin. Quand on est pris dans les forces du destin, ce qu’on peut au moins essayer de faire, c’est de comprendre ce qui se passe à défaut d’infléchir la dynamique au moins utiliser sa pensée pour savoir où on en est.
Étienne Klein : Oui, effectivement, moi, je suis d’accord avec cette analyse. La techno-science est pensée, envisagée, configurée, comme si elle était à la source de toutes les puissances, économiques d’abord mais aussi militaires, symboliques, politiques presque aussi.
Florian Delorme : Il faut justement démêler cette chose ?
Étienne Klein : La question, c’est, est-ce qu’il existe un esprit de la science qui soit encore vivace et qui ne soit pas dans ce grand mouvement-là ? Ce que j’appelle l’esprit de la science…
Florian Delorme : Et selon vous, la réponse est ?
Étienne Klein : J’ai encore des doutes. A mon avis, la situation n’est pas complètement clarifiée. Ce que j’appelle l’esprit de la science, c’est le fait de vouloir comprendre. Une sorte de puissance d’intelligibilité que la science nous donne, une sorte d’élan qui vise à comprendre le monde tel qu’il est sans penser immédiatement à des applications. Vous avez cité tout à l’heure Descartes. Descartes dit effectivement qu’il faut être comme maître et possesseur de la nature mais pas pour le plaisir. Cette maîtrise-là a un but qui lui est extérieur. Et ce but, c’est le bonheur et la liberté. Donc, la maîtrise de la nature est un moyen pour atteindre un but qui la dépasse complètement.
Florian Delorme : Et aujourd’hui, le but c’est le profit finalement.
Étienne Klein : Là, je vous renvoies à Heidegger dans un livre qui s’appelle Le dépassement de la métaphysique qui montre comment nous avons en fait hérité de Descartes autant que nous l’avons trahi. C’est-à-dire qu’il y a Nietzche qui est passé par-là, La Volonté de puissance et l’innovation, dont nous parlons aujourd’hui, ça n’est plus quelque chose que nous devons faire pour viser un futur que nous aurions décidé ensemble qui nous semblerait attractif et crédible, l’innovation, c’est une obligation pour ne pas mourir. Une entreprise qui n’innove pas disparaît. Donc, au lieu d’être tirés vers le futur, nous sommes poussés par derrière par une sorte de fourche qui nous pique le dos, dès que nous donnons le sentiment de ne pas aller assez vite dans l’innovation. Donc, le rapport au futur s’est comme inversé, la vitesse s’est inversée et l’innovation est vécue sous le mode de l’obligation et non pas comme une étape ou une succession d’étapes qui nous mènerait vers un futur désirable. Il me semble, même si je suis d’accord avec Olivier Rey, que la situation est un peu plus compliquée. Nos opinions publiques sont ambivalentes sur ces questions. Quand on explique à une partie de l’opinion, par exemple quand on fait des conférences sur le LHC, ce collisionneur, en expliquant que ce LHC va nous permettre de comprendre l’origine de la masse des particules ou comment l’antimatière a disparue de l’univers primordial, eh bien les gens disent à quoi ça sert tout ça ? On nous reproche de faire une science à l’ancienne, d’une certaine façon, qui obéirait aux critères de la science moderne d’autrefois. On ne peut pas promettre que les découvertes qui seront faites changeront la vie des gens. Donc, on nous reproche de dépenser l’argent public et d’être des sortes de danseuses de la République qui s’offre des Circuit 24 de grand luxe.
Florian Delorme : C’est quand même un signe que la science...
Étienne Klein : En même temps, cette science qui ne promet rien d’autres que des retombées technologiques éventuelles est jugée inutile et discutable. Puis en même temps quand on regarde toutes les controverses qui agitent l’opinion, elles concernent toujours des applications de la recherche : le nucléaire, les OGM, les nanosciences bientôt. Donc, voilà, si on entend le premier message on se dit qu’il ne faut plus faire que la recherche appliquée ou finalisée, en écoutant la demande dite sociétale, et si l’on entend le deuxième mouvement seulement, eh bien on se dit il ne faut faire que de la recherche fondamentale en évitant toute application parce que ce sont elles qui provoquent les crises.
Florian Delorme : Vous trouvez, Olivier Rey, que l’opinion reproche quelque part aux scientifiques, à la science d’agir trop librement et en dehors de tout profit ? Étienne Klein parlait du LHC à l’instant, il expliquait que l’opinion critique cette démarche.
Olivier Rey : Je n’ai pas l’impression que ces critiques soient si virulentes que ça. En revanche il y a des critiques qui sont quand même adressées là, de manière beaucoup plus audible, sur les scientifiques au service simplement du capital. Il me semble que c’est là une critique plus répandue que la critique du LHC, avec là d’ailleurs quelque chose qui est assez ambigu parce qu’aujourd’hui de plus en plus la recherche est pilotée, elle est pilotée en fonction des promesses d’innovations qui pourront donner lieu à des brevets qui permettront des développements économiques - puisque la puissance d’un État se mesure essentiellement à sa puissance économique - mais qu’est-ce qui fait qu’une entreprise a des objets vendables sur le marché ? C’est qu’ils peuvent répondre à un désir des consommateurs qui est éveillé par la publicité qui caresse ses pulsions. Donc, en dernier recours, les consommateurs critiquent la science de se livrer au capital alors que le public en tant que consommateur est aussi celui qui alimente la dynamique. Au passage d’ailleurs on retrouve une situation qui est extrêmement étrange aujourd’hui, la science qui avait été vue comme devant imposer le règne de la rationalité, imposer le principe de réalité, devient aujourd’hui éventuellement une entreprise qui doit amener à nous libérer du principe de réalité selon le slogan : « Vous en avez rêvé, Sony l’a fait » Finalement les scientifiques sont mis dans la situation un peu de soutiers qui doivent élaborer dans la salle des machines les bons objets, pour que sur le pont supérieur la croisière s’amuse.
Florian Delorme : Comment est-ce que vous jugez, l’un et l’autre, la politique publique concernant la recherche scientifique ?
Olivier Rey : Je ne veux pas du tout accabler les hommes politiques qui sont dans des situations extrêmement complexes. De toute façon, nous sommes quand même dans des régimes démocratiques, donc accabler les hommes politiques c’est aussi d’une certaine manière, dans une certaine mesure, s’accabler soi-même. Ça doit nous remettre aussi en cause…
Florian Delorme : Mais est-ce qu’ils ne sont pas là pour avoir une vision, nous donner le chemin ? Ou alors en tout cas entendre ce que souhaite le peuple et agir dans ce sens.
Olivier Rey : Ils entendent une population qui effectivement voit très bien les problèmes posés par le développement technologique, mais en même temps il faut se rappeler ce qui s’est passé par exemple au XIXe siècle avec la Chine et le Japon. La Chine et le Japon étaient deux grands empires qui vivaient tranquillement chez eux, les Occidentaux sont arrivés et tout d’un coup se sont mis à faire la loi, parce qu’ils avaient des armes beaucoup plus efficaces qui avaient été élaborées grâce à la science moderne. Que s’est-il passé ? Le Japon à l’ère Meïji, et puis la Chine plus tard, se sont convertis à la technologie occidentale pour ne pas être écrasés. En Chine, la période 1850-1950, s’appelle le siècle de l’humiliation. Donc, en fait les hommes politiques doivent aussi tenir compte de cela, parce que le rapport que l’on a eu à la Chine au XIXe siècle peut très bien s’inverser au XXIe siècle ou au XXIIe siècle.
Florian Delorme : Étienne Klein, sur cette question de la gestion du projet scientifique.
Étienne Klein : Moi, je n’aimerais pas être un homme politique aujourd’hui. La recherche doit être pilotée mais pour partie seulement. Une partie de la recherche doit échapper au pilotage puisque selon la formule célèbre : « Ce n’est pas en perfectionnant la bougie qu’on a inventé l’électricité ». Il y a des tas de découverte, notamment dans une période que je considère comme complètement miraculeuse, c’est les années 20, vers 1920 jusqu’à 1932, une sorte de décennie incroyable en physique où l’on invente la physique quantique, les gens font une percée incroyable sans jamais penser aux applications, et aujourd’hui tout le monde utilise ça.
Florian Delorme : Ça ne serait pas possible, aujourd’hui, ça ?
Étienne Klein : Eh bien, je ne crois pas. Je pense qu’effectivement le statut du chercheur a changé, son métier a changé, ses sources de financement ont changé. Il faut quand même d’une certaine façon entendre la demande sociétale, comme on l’appelle. Le problème, c’est d’où vient cette demande sociétale ? Qui en est le porte-parole ? Où s’exprime-t-elle ? Que veut-elle vraiment ? Est-ce qu’il y a une demande sociétale pour la découverte du boson de Higgs du LHC ? Et S’il n’y en a pas est-ce qu’on doit renoncer au LHC ? Est-ce que l’on considère qu’il y a encore des problèmes de science qui sont posés par le développement même de la science, parce qu’une discipline évolue et se pose un certain nombre de questions, bien posées qu’elle estime pouvoir résoudre grâce à tel ou tel type d’instrument ? Est-ce qu’on doit faire confiance à cette demande interne de la science ? Ou est-ce qu’on doit tout débattre et mettre en question avec la société ? Olivier Rey a écrit un très bel article sur le LHC, dans Philo Magazine. Je crois qu’il l’a visité assez longuement et il a écrit un article dans lequel il fait part de ses réactions et de ses impressions. Je ne me souviens plus très bien de la phrase, mais je crois qu’il dit quelque part : « que le LHC, ou cette recherche-là, c’est une sorte de reliquat de modernité dans la poste-modernité. » C’est-à-dire que c’est une machine certes monstrueuse mais qui procède d’une démarche intellectuelle qui est l’analogue de celle que l’on avait dans le passé. J’espère que je ne me suis pas trompé.
Olivier Rey : Je me pose la question de savoir si effectivement le LHC n’est pas une sorte de la dernière pointe avancée de la modernité au sein de la post-modernité. Ce qui fait que l’on peut vraiment se poser la question, c’est que les Américains avaient un projet encore plus important que le LHC, avec un collisionneur qui devait faire 80 km de circonférence, 20 km ont été creusés dans le désert du Texas, puis l’administration Clinton a arrêté les frais. Ce qui fait que l’on se retrouve avec 20 km qui ne serviront à rien.
Étienne Klein : Sauf, peut-être, à enfouir, à stocker les déchets nucléaires. Vous voyez, le problème dans lequel nous sommes, c’est que si l’on veut obtenir un financement de la part d’une agence nationale ou européenne ou d’un organisme, on doit dire ce qu’on veut faire et doit aussi dire à quoi ce qu’on va trouver va servir. Donc, on doit promettre. Donc, on assiste aujourd’hui dans l’écriture des actes de recherche à une sorte d’inflation…
Florian Delorme : Mais avec le LHC, Étienne Klein, on ne promet rien et pourtant vous dîtes que l’opinion est contre le LHC…
Étienne Klein : Si je dis promesses, ça veut dire des retombées. Ce qui fait qu’il y a une inflation de promesses qui ne sont pas toutes crédibles.
Florian Delorme : Est-ce qu’il y a vraiment des promesses ?
Olivier Rey : Le CERN est quelque chose de vraiment très intéressant, parce qu’il a été créé après la Seconde guerre mondiale, et vraiment dans une rencontre entre d’un côté des physiciens européens qui, dans un continent dévasté, cherchaient à reconstruire une recherche en physique fondamentale qui puisse être au niveau de ce qui se passait en Amérique, et d’autre part des États qui ayant vu à quel point la puissance nucléaire pouvait avoir des effets colossaux, se disaient : La science est une chose trop sérieuse pour que l’on ne s’occupe. Un des slogans de l’époque, c’était « Science on the tap, not on the top ». Évidemment le jeu de mots est difficile à traduire en français mais ça voulait dire « La science au robinet non au sommet ». C’est-à-dire que les hommes politiques ne voulaient pas être simplement dans le fait de devoir aller demander aux scientifiques : « Qu’est-ce que vous savez faire » mais ils voulaient prendre la direction des opérations. Et le CERN est un organisme qui est vraiment né avec des visées extrêmement contradictoires avec des États qui se disaient : « Le nucléaire, c’est trop sérieux pour que l’on ne s’occupe pas », puis, de l’autre côté des scientifiques qui ont instrumentalisé, d’une certaine manière, cette puissance du feu nucléaire, pour obtenir des crédits, pour mener des recherches qui effectivement ne sont absolument pas là pour construire des bombes.
Étienne Klein : On peut faire cette lecture de la création du CERN mais il y a une autre qui s’ajoute. Le CERN n’a pas du tout été créé pour faire la bombe atomique. D’ailleurs, il ne l’a jamais faite. Toutes ses publications sont ouvertes etc. simplement, il y a un certains nombre de pays, qui s’étaient fait la guerre, qui ont décidé de mutualiser leurs efforts non pas pour un projet particulier, comme ça se fait aujourd’hui dans le cadre de l’Europe, on s’accorde sur des projets, là, c’était pour financer collectivement une discipline scientifique, qui était en l’occurrence la physique des particules. Le but c’était de comprendre la matière. Donc, on peut faire une lecture pragmatique en disant : « il fallait empêcher la fuite des cerveaux », « il fallait garder la maîtrise de tout ça » etc. en même temps, je pense que cette conquête des lois de la matière, fait intégralement partie de l’histoire européenne. C’est nous, c’est l’Europe qui a inventé ce questionnement. La coupure galiléenne est européenne, le développement de la science, jusqu’à cette époque de l’avant Deuxième guerre mondiale est quasi intégralement européen, et il me semble, c’est peut-être une illusion, qu’il y a une façon de faire de la science en Europe qui n’est pas la même qu’aux États-Unis. Du coup, la question que l’on doit résoudre maintenant est : est-ce que l’Europe doit suivre le modèle américain, qui est plus puissant ? Ou est-ce qu’elle doit raviver, en son sein, des valeurs liées à sa recherche qui ont fait son histoire ?
Florian Delorme : Étienne Klein, vous dites, dans votre livre, quelque chose à propos de la croissance, qui ferait frémir bon nombre d’économistes et même de dirigeants, qui s’efforcent d’aller chercher toujours plus de croissance. Je prends exactement ce que vous dites, page 110 : « Il faudrait plutôt de toute urgence opter pour la décroissance économique. »…
Étienne Klein : Ce n’est pas ce que je dis, je fais parler, là, les objecteurs de croissance, je les cite.
Florian Delorme : « seule voie pour sauver la planète des excès de l’humanité en commençant par décoloniser nos imaginaires galvanisés par la publicité. Tout esprit habitué au maniement de la règle de 3 peut en effet comprendre qu’une croissance continue est matériellement impossible dans un monde fini. » Il est urgent, Étienne Klein, d’entrer dans l’ère de la décroissance ?
Étienne Klein : J’oppose les arguments de ceux qui défendent la croissance, sans dire de quoi d’ailleurs, la croissance un mot magique, à ceux qui défendent la décroissance.
Florian Delorme : Mais, selon vous ?
Étienne Klein : Je pense que le problème est mal posé. Je vais vous donner, si vous voulez que j’aille un peu plus loin, un problème qui vient de la physique. Au XIXe siècle, à la fin, il y a un problème, un énorme problème de compatibilité entre les deux piliers de la physique, qui sont d’un côté la mécanique et de l’autre côté l’électromagnétisme. Les physiciens se rendent compte que les principes qui sous-tendent ces deux formalismes sont contradictoires entre eux. Ils sont incompatibles. Les uns vont dire que c’est la mécanique qui est la bonne physique et l’électromagnétisme doit rentrer sous la coupe de la mécanique et les autres disent : non, c’est l’électromagnétisme qui est bon et c’est la mécanique qui doit se plier. Puis arrive un gars, qui s’appelle Albert Einstein, et qui dit : je vais prendre de la mécanique ce qu’elle a d’essentiel, c’est-à-dire le principe de relativité, je vais prendre de l’électromagnétisme ce qu’il a d’essentiel, la relativité s’exprime différemment de ce qu’en fait la mécanique, et il fait un dépassement des deux.
Florian Delorme : Ça veut qu’on attend l’économiste qui va nous faire la synthèse einsteinienne de la croissance et de la décroissance, Étienne Klein ?
Étienne Klein : Exactement. Que quelqu’un nous dise ce qui est bon dans la croissance, et d’ailleurs on vise quelle croissance ? La croissance de quoi ? Si c’est la croissance de l’éducation, je suis pour. Si c’est la croissance systématique de la consommation, je ne vois pas l’intérêt. De même pour la décroissance. Dans l’idée de la décroissance, il y a des notions qui peuvent être intéressantes. Je pense qu’une synthèse va devoir s’imposer puisque pour des raisons strictement mathématiques presque, une croissance indéfinie est impossible et la décroissance telle qu’elle est pensée aujourd’hui conduit à une augmentation de la pauvreté qu’on n’est peut-être pas capables aujourd’hui d’assumer.
Olivier Rey : Je pense qu’on est aujourd’hui quand même dans une dynamique à laquelle il est très difficile d’échapper, pour parler en termes mathématiques, on va dire qu’on est prisonnier d’un attracteur extrêmement puissant, matériellement, du fait encore une fois, je le répète, de la puissance qui s’attache à la technologie qui nous empêche de s’en désolidariser et puis psychologiquement. La phrase de Heidegger qui disait : « Seul un Dieu peut nous sauver », je crois que l’on peut l’entendre de la manière suivante : s’il y a un changement d’orientation qui doit intervenir, il ne viendra pas sous la forme d’une solution, c’est-à-dire sous la forme d’un programme d’action. Souvent quand on décrit la situation on vous dit : « Oui, mais alors qu’est-ce qu’on fait ? » Justement, des programmes d’action c’est ce que l’on fait depuis plusieurs siècles et c’est ce qui nous a amené ici et ce n’est pas un programme d’action supplémentaire, serait-il décroissant, qui nous fera changer de direction. Galilée, dans ses écrits, à un moment donné parle de ce qu’il appelle une nécessaire refonte des cerveaux pour changer le monde. Mais la refonte des cerveaux ce n’est pas quelque chose qui se décrète. C’est quelque chose qui essentiellement advient. Alors, on pourrait se dire : Qu’est-ce qui pourrait advenir ? Je pense qu’avec le XXIe siècle, nous sommes entrés dans une période de très, très grande turbulence, si je pouvais faire une analogie biologique, on s’est rendu compte que les organismes lorsqu’ils sont placés dans une situation de stress, très précaire, ont un taux de mutation qui augmente, quelle qu’en soit la raison, ça permet en tout cas aux organismes d’explorer beaucoup plus de possibilités qu’à l’ordinaire. Je pense qu’au XXIe siècle, il va se passer des choses dont on n’a guère idée maintenant.
Florian Delorme : Merci. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à vous Olivier Rey. Je rappelle que vous êtes l’auteur de l’Itinéraire d’égarement, sous-titré du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine, paru au Seuil. Quant à vous, Étienne Klein, Galilée et les Indiens qui vient de paraître chez Flammarion. Merci, à tous les deux.
Étienne Klein : Avec un sous-titre, Allons-nous liquider la science.
Florian Delorme : Merci à vous. C’était Répliques, une émission d’Alain Finkielkraut, présentée aujourd’hui par Florian Delorme. Attachée de l’émission : Claire Poinsignon. A la technique aujourd’hui : Claire Levasseur et à la réalisation, Didier Lagarde.