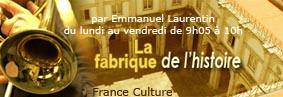En 1967 Gaston Defferre est résolu : la ville de Marseille dont il est maire doit devenir une grande métropole régionale et cette modernisation passe notamment par l’aménagement d’un grand centre commercial et culturel dans le quartier de la Bourse. Les camions excavateurs se lancent sur le terre-plein central pour y creuser les fondations et y aménager un grand parking à la hauteur du futur centre d’activité. Rapidement les ouvriers découvrent des vestiges qui se révèlent être le port hellénistique antique de Marseille. Les archéologues se mobilisent afin de retarder les travaux destructeurs tandis que le ministère de la Culture se lance dans un bras de fer financier avec le maire. Premières fouilles archéologiques de sauvetage de cette envergure, la découverte de ce site déclenche une mobilisation institutionnelle et populaire inédite à Marseille que l’on accuse depuis longtemps d’être une « ville sans passé ». Les stratégies politiques et la renaissance de la notion de patrimoine participent du débat et les séances du conseil municipal exacerbent les divisions de la coalition municipale.
Avec Claude Varoqueaux, Robert Vigouroux, Marius Aubert, Henri Treziny, Michel Bonifay, Jeanne Laffitte, Jacques Bonnadier et François Salviat.
Introduction par Emmanuel Laurentin : Deuxième temps d’une semaine consacrée par « La Fabrique de l’Histoire », à l’histoire de l’archéologie. Hier, Alain Schnapp, archéologue et historien de l’archéologie nous a expliqué le passage long de la conquête du passé par ce qu’on a appelé à l’époque les antiquaires à ce qu’on a appelé ensuite les archéologues, tels qu’ils s’inventèrent surtout au milieu du XIXème siècle. Demain, nous nous approcherons de la personnalité de Leroi-Gourhan, rénovateur de l’archéologie française des années cinquante. Jeudi offrira l’occasion à quatre archéologues de décrire une discipline archéologique en mouvement, celle qui existe aujourd’hui en France. Et aujourd’hui, le documentaire d’Anaïs Kien et de Renaud Dalmar, « Bienvenue au Centre Bourse ! » s’attarde sur un des grands moments de la prise de conscience archéologique dans la France des années 60 et 70. Cela se passe à Marseille mais cela aurait pu se passer dans d’autres grandes villes qui à l’époque s’aménageait, que cela soit Lyon, Rouen ou Bordeaux. Des travaux d’aménagement sont envisagés sur la municipalité de Gaston Defferre sur un site riche en vestiges hellénistiques, début de scandale, mélange entre politique et défense de patrimoine culturel, destruction, préservation et finalement le souvenir où les archéologues étaient confrontés aux aménageurs et modernisateurs. C’est la naissance des grandes fouilles de sauvetage. « Bienvenue au Centre Bourse ! » avec les témoignages de Claude Varoqueaux, Robert Vigouroux, Marius Aubert, Henri Treziny, Michel Bonifay, Jeanne Laffitte, Jacques Bonnadier et François Salviat.
Interview dans la rue avec un fond sonore de la circulation, les mouettes, etc.
Voix d’homme (1) : Je relève dans Le Provençal, c’était en juillet 67, un sondage qui est intitulé habilement « Pour la sauvegarde et la mise en valeur des vestiges grecs de la Bourse ». Il y a tout un papier qui précède et le questionnaire est savoureux. Marseillais, voulez-vous renoncer à l’ensemble de la Bourse, à 2 000 places de parking, à la maison de la culture, à la création de 2000 emplois, à la restructuration du centre de la ville, à un chantier dont l’arrêt entraînerait pour la ville un dommage de quatre milliards et demi d’anciens francs, perte qui devrait être compensée par des impôts d’un montant égal, à un projet qui injectera dans l’économie marseillaise un apport financier de l’ordre de quinze milliards, au moment où cette économie connaît de graves difficultés, pour que soient présenté dans un lieu encaissé et d’accès discutable les importants vestiges des remparts grecs, qui perdraient ainsi une grande partie de leur attraits, Oui ? Non ? Voulez-vous au contraire que se poursuive la réalisation du projet de la Bourse, que soit construit le parking automobile de 2000 places, que soit bâtie la maison de la culture, que soient créés 2000 emplois, que soient regroupés, pour votre commodité, d’importants services administratifs tout en permettant la mise en valeur des vestiges passés, dans la pleine lumière méditerranéenne, d’un beau jardin où ils constitueront un des fleurons de la cité et où ils seront d’un accès libre et gratuit, oui ? Non ? Veuillez barrer la mention inutile et retourner au Provençal.
Voix de femme (1) : Ça, c’était signé Gaston Defferre ?
Voix d’homme (1) : Oui, c’était lui qui était PDG du Provençal qui avait suscité ce papier dans sa rédaction, et qui l’avait commandé. [on va laisser passer ces mecs-là].
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Gaston Defferre est également maire de Marseille et rêve d’en faire une grande métropole régionale. Un centre commercial à l’américaine est en chantier mais la découverte de vestiges antiques perturbe la réalisation de ce beau projet. Au culte de la modernité s’oppose la notion naissante de patrimoine. Doit-on sacrifier sur l’autel du progrès les traces archéologiques de la cité phocéenne alors que Marseille est communément raillée pour être une ville sans passé ? Que faire de ce site ? La mairie, le ministère des affaires culturelles et les archéologues commencent une longue discussion qui ne trouvera sa conclusion qu’au début des années 80 avec l’inauguration du Jardin des vestiges, au cœur du quartier de la Bourse. « Bienvenue au Centre Bourse ! ». Jacques Bonnadier est journaliste et chantre de sa ville natale. Entre le Vieux-Port et les grilles du Jardin des vestiges, retour sur l’année 67.
Jacques Bonnadier : Peut-être qu’ici, on aperçoit des choses. On voit des murs de pierres qui ont été exhumés, les premiers pans de murs en février 1967 à l’occasion du chantier de construction, des premiers travaux de construction d’un ensemble immense, qui devait comprendre un centre de commerce international, un nouveau magasin des Nouvelles galeries pour remplacer celui qui avait brûlé en octobre 1938, sur la Canebière. Quand les premières excavatrices se sont mises à défoncer le terre-plein dit “de derrière la Bourse”, elles ont mis au jour des fragments de remparts. Les archéologues ont voulu mettre le holà : arrêtez tout maintenant ! Il y avait Gaston Defferre qui a dit : comment arrêter tout ? J’ai signé tous les contrats. Il s’est même emballé. Il se répandait partout, notamment dans les couloirs de l’Assemblée nationale : « Ce n’est pas pour quatre petits cons d’archéologues que je vais renoncer à un chantier qui va transformer ma ville ». Ou alors, « ce n’est pas pour quatre vieilles pierres qu’on va stopper une entreprise comme celle-là ». C’était parfaitement légitime que de vouloir moderniser sa ville, utiliser ce terrain vague, on peut dire puisque depuis la démolition des vieux quartiers de la Bourse, c’était un terrain qui servait de parking, de terminus pour des autobus. Donc, il y avait ce vaste projet pour lequel les contrats avaient été signés. Malheureusement pour lui, on met au jour ces vestiges dont on s’aperçoit que ce sont des vestiges grecs.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Les archéologues guettent ces vestiges hellénistiques du IIIème siècle avant notre ère depuis bien longtemps. Devant l’assaut des pelleteuses et autres machines, François Salviat, membre de l’École française d’Athènes et directeur des Antiquités donne le signal d’alarme pour suspendre les travaux d’aménagement du centre Bourse.
François Salviat : Je me rappelle cette répartie de Monsieur Labourdette, l’architecte, qui s’est illustré à Sarcelles aussi pour faire des HLM : Vous savez Monsieur, c’est une affaire de gros sous, de très gros sous. J’étais jeune, cela ne m’a pas tellement impressionné mais les choses étaient lancées et il avait besoin d’aller au bout puisque c’était un financement déjà engagé et un permis de construire qui était entaché quand même d’une certaine irrégularité puisqu’il y avait un élément du rempart antique qui était classé monument historique.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Le Mur de Crinas.
François Salviat : Le mur dit de Crinas, oui. On s’est aperçu qu’il était en train de travailler autour de ce vestige important, avec des pelles mécaniques et on est intervenu en disant que c’était un monument historique dont le sort n’avait pas été réglé autrement, donc il fallait le protéger et non seulement il était protéger lui-même mais il protégeait l’environnement. On avait des crédits que l’on appelait des crédits à discrétion et on n’avait pas la servitude de s’accrocher aux basques du constructeur pour lui demander des crédits. On était indépendant, entièrement. On était une sorte d’épine dans le pied du constructeur qui pouvait difficilement détruire quelque chose qui était monument historique. Il devait se plier quand même à certaines règles. Et la règle la plus draconienne, c’est celle de l’occupation temporaire, c’est-à-dire que l’État peut décider d’occuper temporairement un terrain et de faire pratiquer des fouilles jusqu’à ce que l’on décide du sort du terrain et éventuellement sa restitution au constructeur etc.
Claude Varoqueaux : Quand je suis arrivée, les découvertes avaient eu lieu. Les premiers accrochages, si on peut dire, avec les promoteurs, les constructeurs et même la ville de Marseille, puisque le seul vestige conservé c’était le mur de Crinas, et qu’il était question dans le projet d’aménagement de le démonter.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Le ministère des affaires culturelles nomme un conseil scientifique pour étudier les ressources du site. Claude Varoqueaux, assistante à la direction des Antiquités.
Claude Varoqueaux : Déjà là, le directeur des Antiquités de Provence, François Salviat, avait lancé un cri d’alarme en disant : il n’y a pas que ce bout de mur, on a des traces de ce rempart antique sur une très grande distance et ce n’est pas pensable de démonter un bout de mur, cela ne rimerait plus à rien par rapport à la topographie de la ville antique. Donc, il s’est vraiment investi lui-même, beaucoup battu face aux bulldozers, si je peux dire, en essayant d’arrêter les travaux chaque fois que l’on trouvait un vestige, un bout de mur supplémentaire jusqu’à ce qu’un décret d’occupation du terrain ait été pris justement, en 1967, laissant une zone de 13 000 mètres carrés à la disposition des archéologues pour investir, essayer de voir ce qu’il y avait, ce que contenait ce terrain puisque personne encore, localement, à part les scientifiques ne croyait à l’importance des vestiges. Au bout de trois ou quatre mois, François Salviat devait aller rejoindre son chantier de Délos, en Grèce, puisqu’il était membre de l’École française d’Athènes, il avait aussi d’autres obligations, les étudiants partaient plus ou moins en vacances, le personnel… cette première partie du chantier avait déjà épuisé les ressources en personnel, moi qui était venue ici en juillet 67, j’ai été mise sur le chantier de la Bourse dès le mois d’août 1967, avec une reprise d’un terrain qui venait à peine d’être dégagé par les entreprises, donc entièrement ravagé par les engins de chantier, les tas de déblais, les passages incessants de camions et il fallait organiser là-dessus, sur cet espace qui nous était concédé un chantier à peu près organisé avec pour mission de découvrir le plus de choses possibles, de façon à obtenir la protection et la conservation sur place.
On a fait une campagne de fouilles. Au début cela a été dur. Pourquoi ? Comme j’étais du bâtiment, travailler à faire des fouilles, ce n’est pas la même chose. J’avais des ouvriers à commander, des fois 60 ouvriers à commander, ce n’est pas la même chose que le bâtiment, pas du tout ! Au début, c’est un peu dur et puis on se laisse attraper par la beauté des choses que l’on trouve, c’est magnifique, quoi. – Marius Aubert, contremaître sur le chantier de fouilles du Centre Bourse. On a trouvé de petites assiettes, des lampes à huile, des paniers en osier, dans la boue, des tissus brodés à la main, des têtes de thon avec de la chair accrochée encore, de l’époque, dans la vase. On était dans la vase. On a trouvé des amphores pleines d’olives, avec le fenouil, des feuilles de laurier dedans, tout. On aurait dit des olives vraies. On a trouvé des amphores de toutes époques, des petites, des grosses, des moyennes, de tout. Et même, quand ils sont venus faire les travaux pour faire le parking, nous, on surveillait les pelles mécaniques devant et on récupérait toutes les amphores qu’on pouvait. À une époque, on n’avait plus le droit en dehors du chantier de la Bourse, autour on avait une limite…
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : En fait le chantier avait été circonscrit.
Marius Aubert : Voilà. Oui, oui.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Et vous aviez le droit de fouiller sur un hectare seulement.
Marius Aubert : De l’autre côté, on n’avait pas le droit de fouiller. Comme ils étaient en train de faire un terrassement, on se mettait devant les pelles mécaniques et quand ils tiraient un godet de terre et que l’on voyait une amphore, on y allait, on la prenait par une anse et on revenait ou on la cassait, on faisait ça. Et le soir, quand ils partaient et qu’il y avait une tranche par la pelle, toutes les amphores que l’on voyait, si on n’avait pas le temps de les récupérer, on les cassait. On les cassait pourquoi ? Pour pas que les ouvriers les prennent et qu’ils les vendent. Après, on a trouvé le bateau.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : En 1974.
Marius Aubert : Oui.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : C’est vous qui l’avait trouvé d’ailleurs.
Marius Aubert : Brusquement j’ai arrêté la pelle. Comme j’étais dans le bureau en train de travailler, en train de récoler les amphores, tout d’un coup je me retourne et je vois un bout de bois qui partait. Vite, je suis sorti et j’ai vu, dans le trou, un départ d’un fond de bateau. J’ai dit : Félix arrête-toi. Mais pourquoi ? J’ai dit : il y a un bateau en dessous ! Il me dit : Tu es un fada, ce n’est pas vrai. J’ai dit : arrête-toi, descends et regarde. Pour lui faire peur, j’ai dit : si tu ne t’arrêtes pas, Félix, je vais chercher les gendarmes. Ça a été dur pour les arrêter.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Un de vos rôles principaux sur ce chantier, Marius Aubert, ça a été un rôle de vigilance finalement ?
Marius Aubert : Moi, j’étais là sur le chantier, l’entreprise on était là pour fournir le personnel de fouille. On commandait du personnel. S’il fallait, mettons, dix bonshommes, on en commandait vingt parce que ce n’est pas tout le monde qui est censé faire des fouilles comme il faut, de gratter… Ces bonshommes, c’est des types qui arrivaient d’Algérie, il y avait des types qui avaient 40-50 ans, sur le nombre on prenait les dix meilleurs et ceux qui comprenaient le mieux le français. À 85%, c’était des bonshommes qui vraiment étaient sérieux pour travailler, des gens formidables, des musulmans, formidables. Un jour, ils ont trouvé sur le chantier… Il était là sur le chantier, moi, je n’étais pas loin de loin, une pièce en or, c’est une pièce qui valait une fortune, en grattant, il l’a trouvée, il a dit à Michel : Tiens Michel, j’ai trouvé ça…
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Michel Bonifay.
Marius Aubert : Michel Bonifay. Il a dit : Michel, tiens j’ai trouvé une pièce, voilà. Une pièce en or. Vraiment des mecs très bien, très, très, très bien. Très bien.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : On va aller sur le chantier, comme ça on sera directement sur place.
Marius Aubert : Oui… Vos arriverez à vous garer là-bas ?
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : On va essayer.
Marius Aubert : Sans ça, on va aller au parking, eh oui !... Il y aurait encore à fouiller parce que moi, je le connais le chantier, par cœur. Je connais mieux le chantier que ma maison, sérieux hein ! Je connais des endroits où il y a des amphores marseillaises. Je connais des endroits où il y a des vases grecs, il y en à mais on ne le dit pas.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Avec Marius Aubert, sur la route du jardin des vestiges où nous devons rencontrer les archéologues Michel Bonifay et Henri Treziny.
Après le parking, les escaliers mécaniques, la traversée du centre commercial, nous arrivons au musée d’histoire et d’archéologie, niché au sous-sol du Centre Bourse, et par lequel nous accédons enfin aux vestiges marseillais.
Voix masculine (2) : Qu’est-ce que tu as fait de la moustache ? Je suis heureux de te voir. [échanges d’amabilités difficiles à transcrire car entremêlées et pas très audibles]
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : « Ce projet a déjà abouti à la construction de quatre immeubles de 18 étages, dus à Monsieur Laboudette, en bordure du Cours Belsunce. On s’accorde pour dire, à Marseille, que leurs silhouettes anguleuses n’améliorent pas l’esthétique du centre mais l’on admet que la rentabilité du terrain et la nécessité de loger les gens justifient ce sacrifice à l’habitat vertical. » Le Méridional, mai 1968.
[Poursuite des échanges non identifiables]
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Aujourd’hui le Jardin des vestiges est aménagé, il est ouvert au public, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il ressemblait quand vous êtes arrivé sur le chantier en 1968 ?
Marius Aubert : Ah, ce n’était pas comme ça, hein ! Ce n’était pas comme ça. C’était un amas de terre. On ne voyait que ce mur sortir. Le mur de Crinas.
Michel Bonifay : Ce n’est qu’un morceau du rempart parce qu’en fait quand on l’a fouillé en 1914, il y avait un quartier ici, un quartier du XVIIIème siècle, XVIII-XIXème. En 1911, on a tout rasé pour des mesures d’assainissement, pour faire une ville moderne, que l’on n’a pas faite d’ailleurs ensuite. Cela s’est arrêté avec la Guerre de 14, les travaux se sont arrêtés. Le mur de Crinas était un mur de cave en fait. Nous sommes ici au niveau, même sous le niveau des caves du XVIIIème siècle. Il faut imaginer que l’on avait au-dessus l’étage, le premier étage, et le mur de Crinas a été conservé parce qu’il avait servi de mur de cave et de fondation de maison moderne. En fait on l’appelait le mur de César quand on l’avait trouvé. On se disait que c’est le rempart qui a servi aux Marseillais à se défendre contre Jules César en 49 avant Jésus-Christ lors du grand siège qui a marqué la fin de la venue (?) grecque. Puis après c’est Michel Clerc qui l’a débaptisé, un des grands archéologues marseillais, qui l’a appelé mur de Crinas, du nom d’un médecin marseillais, que l’on connaît de par le texte de Pline l’Ancien, qui aurait à l’époque de Néron, soit près d’un siècle après César, reconstruit les remparts de sa ville en dépensant une bonne partie de sa fortune qui était considérable.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Qu’est-ce qui fait que ce chantier est un chantier important, réellement ?
Michel Bonifay : On est quand même face aux fortifications de la ville grecque de Marseille. On a quand même quatre lignes de fortifications visibles encore. On a le rempart archaïque, qui est par ici, dont on a quelques fragments par ici, le rempart hellénistique. Un avant-mur tardif du Vème siècle après Jésus-Christ. Puis ici, probablement les restes d’une fortification du X-XIème siècle. Donc, là déjà c’est l’endroit où l’on a, disons, le maximum d’informations sur les fortifications de Marseille, je crois que l’on peut le dire. Peut-être même un des endroits en Méditerranée où l’on a des éléments de stratigraphie de fortifications aussi regroupés.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : On n’est pas à quai, les bateaux venaient jusqu’ici et l’on se trouve à peu près à 250 mètres du Vieux-Port.
Michel Bonifay : Oui, c’est le prolongement du Vieux-Port. C’est la fin Vieux-Port, seulement le Vieux Port était plus grand qu’aujourd’hui. Il se repliait, formant une espèce de doigt qui remontait un petit peu, que l’on appelle la corne du port. Les bateaux remontaient par là. À l’époque romaine, ils allaient prendre l’eau dans le bassin que l’on a vu à l’entrée. Ce grand bassin servait probablement, on n’est pas sûr, à récolter de l’eau douce pour le ravitaillement des bateaux, vraisemblablement.
On va passer au niveau de la mer à l’époque romaine qui se situe à peu près à 30 centimètre en-dessous du nivellement général de la France qui lui-même est un petit peu en dessous du niveau actuel de la mer. Enfin, bon, c’est à peu près à ce niveau-là. On peut voir la manière dont le port a reculé et pourquoi il est là où il est actuellement, comme vous le dites à 300 mètres au-delà. Au-dessus de ce quai, on a retrouvé, en fouillant, des maisons. C’est-à-dire qu’au VIIème siècle, la corne du port était déjà partiellement comblée et des maisons s’étaient déjà installées sur le comblement de la corne du port. Et petit à petit, évidemment tout cela s’est comblé et le port a reculé.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Michel Bonifay, vous, vous avez travaillé directement en tant qu’archéologue sur ce chantier.
Michel Bonifay : Oui, moi j’ai accompagné la dernière phase des travaux sur le site, c’est-à-dire l’aménagement du Jardin des vestiges. J’avais été embauché à l’époque pour trois mois et en fait je suis resté quatre ans. Les architectes étaient très optimistes, ils pensaient qu’on pouvait aménager le site en quelque mois, notamment vider la corne du port - ici, la corne du port antique, qui était encore pleine de ses sédiments, de vestiges, de céramiques, etc. – à raison de 25 mètres cube par jour, avec une pelle mécanique. Mais à l’époque, on a fait de la résistance. Marius, François Salviat, Guy Bertucchi et moi, qui étais tout feu, tout flamme à l’époque. On a résisté, on a sondé et on a pu faire, je crois, du bon boulot.
Henri Treziny : Certainement le plus grand chantier peut-être par l’ampleur mais c’est surtout la première fois que l’on s’est trouvé devant la nécessité de fouiller une surface aussi grande en relativement peu de temps et que l’on s’est donné les moyens de le faire. Ce qui s’est passé en 67, c’est que malheureusement les archéologues se sont trouvés,… d’abord il n’y avait pas d’archéologues, eh bien oui, il n’y avait pas d’archéologues. En 67…
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Michel Bonifay n’est pas tout à fait d’accord.
Henri Treziny : Pas en 67. En 67, il n’y avait pas d’archéologues. Il y avait le directeur de circonscription, qui était François Salviat, qui était professeur d’archéologie grecque à l’université, donc il n’avait que ça à faire, il n’était pas sur le terrain, il l’était quand il le pouvait, il y avait Maurice Euzennat, après, qui est venu. Il y avait très peu d’archéologues dans la première année. On se contentait de vider, de nettoyer les déblais de la pelle mécanique. Après on a mis en place, avec des équipes d’archéologues, avec aussi beaucoup d’étudiants qui venaient faire leurs stages de fouille sur le chantier, des fouilles véritablement programmées, avec des méthodes de fouille. On a appliqué ici, pour l’une des premières fois en France finalement, la méthode que l’on appelle des carrés Wheeler, qui aujourd’hui paraît très, très vieillie, que l’on utilise plus, qui consistait à découper tout le terrain en quadrillage et à fouiller par carrés. Mais il n’y avait pas à l’époque, et c’est cela que l’on a du mal à comprendre aujourd’hui, ces grandes équipes d’archéologues de sauvetage que l’on a aujourd’hui avec l’Inrap.
Michel Bonifay : Ce que je voulais dire, c’est que ce n’était pas un désert archéologique non plus, la Provence.
Henri Treziny : Non, mais…
Michel Bonifay : Mais c’est vrai que l’on a loupé un épisode en France, pas seulement en Provence, qui est l’épisode de l’après-guerre. Nos collègues anglais, allemands même, après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ont fait des fouilles systématiques sur les terrains qui avaient été rasés par les bombardiers. Et nous, en France, on n’a pas fait cela, notamment à Marseille. Le quartier du Vieux-Port, qui était quand même un des quartiers les plus centraux de la ville antique, qui avait été plastiqué par les Allemands pendant la guerre, n’a pratiquement pas fait l’objet de fouilles. Fernand Benoit a couru après les bulldozers, les grues, de façon à faire quelques observations.
Henri Treziny : Lui, il fouillait avec les prisonniers allemands.
Michel Bonifay : Il faut se rendre compte qu’on était extrêmement en retard en France à cette époque-là.
Henri Treziny : Je crois que les fouilles de la Bourse a été l’occasion d’abord peut-être de prendre conscience de ce retard-là et de commencer à le combler un petit peu. Cela a été peut-être le point de départ d’une prise de conscience de la nécessité de l’archéologie de sauvetage. Aujourd’hui, on est arrivé, je crois, à avoir de bonnes techniques de l’archéologie de sauvetage, de l’archéologie préventive, par contre, on a pris l’habitude de ne rien conserver. C’est-à-dire que si vous allez vous promener dans Marseille aujourd’hui, vous ne pourrez visiter, à peu de choses près, que le Jardin des vestiges de la Bourse. Tout le reste est systématiquement détruit. Et ça, il faut en avoir conscience. Si vous allez en Italie par exemple, cela ne fonctionne pas du tout de la même manière. Ce n’est pas un problème marseillais, c’est un problème de l’archéologie française.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Michel Bonifay, quels contacts aviez-vous, si vous en aviez, avec les habitants du quartier, avec les Marseillais ?
Michel Bonifay : Vous voyez cette coursive, là, qui conduit au centre commercial, chaque matin, nous allions placer sur la rampe de cette coursive, un panneau explicatif en disant : voilà ce que nous sommes en train de faire. D’ailleurs ce panneau était évolutif parce qu’évidemment les fouilles avançaient, on mettait de nouveaux plans, de nouvelles photos. Les gens - je dois même avoir une photo, je vous montrerai - se regroupaient autour de ce panneau et discutaient. On entendait des choses comme : cinq mille francs ils sont payés pour faire ces bêtises ! À l’époque, je ne les touchais pas les cinq mille francs. D’autres répondaient : mais, c’est très bien, c’est notre passé. Les gens se disputaient sur la coursive, à notre propos. Il y avait vraiment une animation. Les gens nous interpellaient, ils nous disaient : qu’est-ce que vous trouvez ? Qu’est-ce c’est ? Et aujourd’hui ? C’était vraiment extraordinaire. On ne se contentait pas de fouiller les niveaux romains, on voulait aussi connaître l’époque contemporaine, moderne, médiévale. On voulait avoir, bien sûr, une compréhension globale du passé de la ville, de son évolution, de l’évolution du paysage urbain, d’autre part avoir un contact avec les habitants de façon à leur faire comprendre que ce que l’on faisait était bien.
Claude Varoqueaux : Visiteurs, le 5 septembre Monsieur Paul-Marie Duval, professeur au Collège de France, Monsieur Jacques Coupry, directeur de circonscription, Gallet de Santerre, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Montpelier, directeur de circonscription, Monsieur Ernest Will, directeur de la circonscription, c’était l’Alsace, Monsieur ( ?), conservateur du musée Borély, accompagné du conservateur du musée de Brooklyn.
« Archive ( ?), L’intervieweur ( ?) : Marcel Pagnol si vous déviez dégager l’image clef, l’image force de Marseille, que diriez-vous ? / Marcel Pagnol : C’est une ville grecque, Marseille. Puis, avec ce port énorme, c’est une ville cosmopolite, enfin internationale ! / L’intervieweur ( ?) : Quand vous dites grecque, elle a été fondée par les Grecs mais est-ce qu’elle l’est restée ? / Marcel Pagnol : Oui, il en reste des traces très profondes. Je ne parle pas seulement des ruines, on vient encore de découvrir, sur la place de la Bourse, des murs grecs de toute beauté, que Malraux a fait classer, n’est-ce pas. On voulait faire un parking mais le ministre a dit : Non, il ne faut pas y toucher. / L’intervieweur ( ?) : Comme traces par exemple, qu’est-ce que l’on eut cité comme traces de la Grèce, dans le peuple par exemple ? / Marcel Pagnol : Il reste même des mots grecs dans le parler des gens du peuple, du Port surtout. Quand j’étais jeune, j’entendais parler des pêcheurs qui pour dire du pain, disaient de l’arton et arton, c’est l’accusatif grec, c’est arton, le pain. Il reste plusieurs mots comme ça. Mec, c’est aussi un mot grec, mecos ( ?), homme de mauvaise vie. Ce mot est monté jusqu’à Paris. Peut-être parce que c’était des Marseillais de mauvaise vie qui l’avaient apporté. »
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Poètes, historiens, banquiers, conseillers municipaux, figures locales ou nationales et même critiques gastronomiques, tout le monde s’empresse de donner son avis. Sur le terrain, Claude Varoqueaux coordonne les différents corps de métier.
Claude Varoqueaux : Il n’y avait pas d’équipes de fouille. J’étais encore contractuelle à l’époque mais seule permanente, si je peux dire. C’est comme cela que, par négociation, l’armée a mis à disposition d’une part des sapeurs du génie avec deux caporaux, et surtout un énorme camion, GMC, pour transporter les déblais et une benne-grue, qui permettait aussi de transporter les blocs d’architecture qui étaient épars un peu partout sur le terrain, qu’il fallait regrouper avant d’être numérotés, analysés. Ils ont commencé à faire ce travail-là, après on a eu 15 légionnaires du 1er Régiment d’infanterie, qui venaient d’Aubagne. Alors eux, c’étaient de gros bras. Ils ne parlaient pas français, c’étaient pour la plupart des Allemands. On avait quelque mal à leur donner directement des ordres mais ils avaient un sous-officier avec eux qui faisait la liaison. Eux, ils ont construit des murs de soutènement, ils ont fait aussi de très gros travaux d’aménagement, jusqu’à ce que, quand le chantier a été à peu près aménagé, ils ont trouvé que ce n’était pas assez dur pour eux, on les a envoyé en Corse, pour construire une route, parce que là, à Marseille, ils avaient trop de temps-passion avec les anciens légionnaires qui venaient les voir et qui essayaient de discuter avec eux. Parallèlement, on avait déjà quelques crédits de fouille, on a pu embaucher cinq manœuvres terrassiers, lesquels étaient forcément à l’époque, pour tous les chantiers de grands travaux, des Maghrébins, des Algériens. Alors, cela posait quelques problèmes de coordination parce qu’il fallait que les légionnaires soient quand même assez loin des Maghrébins qui avaient une peur bleue d’eux et qui ne pouvaient pas rester à moins de dix mètres des légionnaires sans partir à toutes jambes. On avait des secteurs maghrébins, des secteurs légionnaires et des secteurs sapeurs du génie. Puis, peu à peu, les crédits sont arrivés et on a pu, au mois de janvier 1969, je crois, Marius Aubert a pu vous le dire, quand ils étaient arrivés 20 terrassiers, de l’entreprise Girard des Monuments historiques, et je me suis retrouvée catapultée sur cette fouille. Il fallait que je puisse organiser le travail et pour ça, Marius Aubert ne m’a pas laissé beaucoup de temps de répit. Chaque fois qu’une de ses équipes de 5-6 ouvriers terrassiers, pelleteurs avait abandonné, terminé un secteur, il me disait : il faut tout de suite les remettre quelque part. Il fallait vite, vite aller rouvrir un secteur de fouille et remettre en place l’équipe pour ne pas perdre de temps. C’était effectivement un travail à la chaîne. Ça a été un travail à la chaîne aussi bien pour les terrassements que pour le lavage des céramiques, tout était enclenché par équipe. C’était une organisation qui était assistée même par un colonel en retraite, le colonel Thiebault, qui, lui, faisait toute la gestion administrative et financière. Si on avait besoin d’un crayon ou d’une gomme ou d’un dumper, c’était par lui que cela passait en fonction des crédits qui étaient alloués au compte-gouttes, par le ministère, et qui sont venus après de façon plus régulière. La mise en place a été quand même assez pénible.
« Archive Inter actualités de 1964, L’annonceur ( ?), voix masculine : Revenons à Paris maintenant, une manifestation vient de se dérouler dans notre maison de la RTF. Une manifestation qui nous tient à cœur car il s’agissait d’une initiative RTF. Monsieur Malraux remettait, tout à l’heure, les Prix des concours chefs-d’œuvre en péril. Grâce aux lauréats, grâce à beaucoup d’autres aussi, déjà des vieux hôtels, des églises, des monuments ont été sauvés de la ruine ou plus simplement de l’oubli qui mène à la dégradation. La présence de Monsieur André Malraux était le salut très officiel de l’État à l’œuvre entreprise par Pierre de Lagarde à la RTF, dans des émissions hebdomadaires. André Malraux : Nous voulons tous ensemble qu’un certain nombre de chefs-d’œuvre français, qui sont aujourd’hui agonisant, et que l’État aujourd’hui, n’est pas en état de sauver, soient sauvés. Ils le seront parce qu’il y aura des moyens d’État. Ils le seront parce qu’il y aura des moyens d’argent. Mais en définitive, cet argent et ces moyens ne seront donnés que parce qu’à un moment vous aurez été là pour faire les choses avec rien. »
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Le patrimoine se résume traditionnellement aux monuments s’imposant d’eux-mêmes aux yeux des Français : le château de Versailles, la cathédrale de Chartres et les Alignements de Carnac sont à l’honneur dans les manuels d’histoire. Mais dans les années 60, la reconstruction du pays s’achève et une certaine méfiance pointe face aux excès du modernisme. Sous l’influence d’André Malraux, l’idée d’un patrimoine plus vaste et plus accessible se fait jour et l’on porte un regard plus attentif aux vestiges du passé qui parsèment le territoire. Ce que l’on considérait jusqu’ici comme de vieilles pierres destinées au recyclage sont intronisées chef-d’œuvre en péril. Gaston Defferre tente de défendre son projet face à cette lubie patrimoniale, y compris au sein du Conseil municipal.
Voix d’homme (1) : Gaston, dans Le Provençal, avait fait faire une sorte de sondage, de référendum, où il fallait répondre par oui ou par non. Voulez-vous conserver les vieilles pierres ? Voulez-vous moderniser votre quartier ? C’était vraiment très… comment dirais-je ? C’était…
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Un peu manichéen ?
Voix d’homme (1) : Oui. C’est ça. C’était construit de telle façon… il pensait que la réponse s’imposait.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Robert Vigouroux, en 1967, vous êtes conseiller général des Bouches-du-Rhône, quels sont les échos qui vous parviennent de la découverte du site archéologique sur le chantier du Centre Bourse ?
Robert Vigouroux : Cela dépendait beaucoup des uns et des autres. Certains étaient très heureux de cette découverte. J’en étais parce qu’il n’y avait pas beaucoup de choses antiques, de souvenirs architecturaux ou autres à Marseille. Gaston Defferre était, je crois, assez hésitant parce qu’il y avait une poussée d’un certain nombre de personnes, des adjoints autour de lui pour dire qu’il fallait continuer, que c’était très important pour l’avenir économique de Marseille et qu’on ne pouvait pas payer d’amende… Gaston Defferre, je crois, j’en suis presque sûr, lui voulait conserver ces vestiges, à tout prix. Ce qui s’est passé ensuite, je ne le sais pas. Il y a eu un accord qui a été signé pour la restauration de la Vieille Charité, par Gaston Defferre, à Marseille, avec un ministre, mais à ce moment-là ce n’était pas Malraux qui était ministre, je ne me souviens plus du nom d’ailleurs…
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : C’était Edmond Michelet.
Robert Vigouroux : Peut-être. Donc l’accord a été fait mais l’État participe pour la restauration de la Vieille Charité. J’y repense, je suis sûr qu’à cette époque, Gaston Defferre a joué fin, il était très habile, il disait qu’il allait détruire la Vieille Charité mais c’était en réalité pour avoir de l’aide pour restaurer la Vieille Charité.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : C’était une provocation, finalement.
Robert Vigouroux : Vous savez, en politique on discute, on dit le contraire au besoin de ce qu’on désire de façon à ce que les autres, qui veulent dire le contraire, entrent dans le positif. C’est assez courant ça.
Voix d’homme (1) : Le ministre, je le vois encore, juste derrière moi, dire : Il faut garder ça, il faut garder ça. Le ministre de la culture à l’époque, Edmond Michelet. Des pétitions circulaient, la municipalité elle-même a failli éclater à un moment puisque tout un pan de la municipalité, sous la conduite de quelqu’un qui a été un grand adjoint à la culture, qui s’appelait Jean Goudareau, toute cette frange de la municipalité, qui était je le rappelle une municipalité socialo-centriste, si on veut, avec même des gens de droite, plus à droite encore, ce qui était le cas d’ailleurs de la fraction qui s’était rebellée. Et cette fraction a dit : Monsieur le maire, on ne peut pas renoncer à conserver ça. On se plaint toujours, Marseille ville antique sans antiquité, c’est un cliché que nous traînons depuis des décennies, faisons en sorte que ces vestiges soient maintenus, maintenus in situ. Et là, Gaston a découvert un mot nouveau, le mot in situ. Il faut les garder, là où ils sont.
Voix d’homme ( ?) : Les gens n’étaient pas hostiles, franchement. On avait l’impression qu’on gênait beaucoup une entreprise qui était sur les rails, c’est tout. Même dans la municipalité de Marseille, il y avait beaucoup de gens, dans le personnel, qui étaient très ouverts à cela. C’est avec Defferre que la plupart on a eu ces problèmes-là. Les rapports n’étaient pas toujours très cordiaux. Il était un peu autoritaire. Mais je pense qu’il a quand même compris qu’il y avait intérêt à ne pas construire, bourrer le centre de Marseille avec des cubes de bétons. Il a été quand même finalement assez ouvert à la fin à la solution Vieille Charité, échanges, nouveaux projets de la Bouse, etc. la municipalité de Marseille était disposée finalement à renoncer à ce projet tel qu’il était défini dans la première mouture parce que l’État a donné les moyens de restaurer la Vieille Charité, qui est dans le quartier
du Panier, qui était due à Puget. Maintenant c’est très bien restauré, c’est vraiment un centre culturel magnifique.
Claude Varoqueaux : On a été énormément aidé par la presse nationale et locale. On avait presque tous les jours, Le Méridional, Le Provençal, La Marseillaise, qui venaient nous demander les résultats des travaux pour faire des articles tantôt pour, selon leur tendance, tantôt contre mais il s’est rapidement formé davantage de majorité pour la conservation. Monsieur Defferre, alors maire de l’époque, avait demandé qu’on laisse l’accès libre aux Marseillais, pour que tout le monde puisse venir voir, juger lui-même ce que c’était que ces fameuses découvertes de la Bourse, donc on a été amené à faire, en plus des fouilles, des visites de chantier, c’est-à-dire recevoir et accueillir le public, qui venait n’importe quand, n’importe quelle heure. Les gens du quartier qui promenaient leur chien trouvaient ça très agréable de venir sur ce grand terrain enfin ouvert au public. On avait les spécialistes de l’extérieur qui en avaient entendu parler par la presse. On avait un normalien, qui était, lui, préposé à recevoir les visiteurs et à leur faire visiter le chantier. Comme il était passionné, lui, forcément, c’était son métier l’archéologie, il convainquait à peu près tout le monde ce qui fait que tous les visiteurs sortants étaient au contraire convaincus qu’il fallait absolument garder ces vestiges et cela nous a beaucoup aidé.
Gaston Defferre, le 28 octobre 1967 : Après l’arrêté signé par Monsieur Malraux, une lettre qu’il m’a écrite, la responsabilité financière de l’État est bien confirmée, pour les Marseillais, c’est une chose très importante. Reste ensuite à savoir ce que l’on fera de ces vestiges. Eh bien, voyez-vous, aucun de ceux qui ont écrit ou délibéré ces derniers mois, n’est capable de le dire car il ne s’agit pas de trésors artistiques, comme le Parthénon d’Athènes ou le Forum de Rome mais de vestiges archéologiques. Il faut pour cela des spécialistes. Les spécialistes doivent avoir le temps d’examiner les choses de près, ils vont pouvoir restaurer le chantier et ils nous diront à ce moment-là si ces vestiges représentent une très grande valeur et s’ils doivent être conservés, comme on dit maintenant à Marseille, même ceux qui n’ont pas appris le latin, in situ. La municipalité aura à se prononcer. La lettre de Monsieur Malraux, qui a été publiée ce matin, est très claire à ce sujet. La municipalité sera consultée, j’espère, personnellement, que l’on pourra tout à la fois conserver les vestiges et poursuivre le programme de modernisation du centre de Marseille car, il ne faut pas oublier que si le passé est une chose importante, l’avenir compte aussi beaucoup et que le devoir de la municipalité, tout en conservant les vestiges du passé, est de moderniser le centre de Marseille, pour en faire la première Métropole régionale.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Éditrice et libraire, Jeanne Laffitte, dirige les Arcenaux dans le centre-ville de Marseille. Elle fut également en charge des questions touristiques pour la municipalité.
Jeanne Laffitte : Si les choses durent, c’est peut-être justement que pour faire les fouilles il faut beaucoup d’argent. Qui paie les fouilles ? C’est la ville ou c’est l’État ? C’est cela qui s’est modifié, si vous voulez, dans la naissance du patrimoine. Il y a l’idée qui est là, on a voulu sauver des choses, par contre il y a aussi qui paie. Et l’État à l’époque, pour remuer le cocotier à cette époque-là, ce n’était pas facile. Il a fallu attendre les années 80 pour que l’on dise, quand Mitterrand est arrivé, Jacques Lang est arrivé, que l’on consacre une partie budgétaire. Aujourd’hui, on ferait bien de se préoccuper de ça. Donc, moi, si vous voulez, Gaston Defferre, il ne faut pas lui faire dire des choses qui ne sont pas, il faudrait savoir et être assez perspicace pour aller dans les dossiers d’archives municipales, de savoir quels étaient les partenaires du dossier et de savoir quels étaient les partenaires qui freinaient des quatre fers. C’est amusant de savoir, je dis bien amusant, parce que même à l’époque où la ville s’agrandit, à la fin du XVIIème, on sait pertinemment que les vestiges sont là et on s’en fiche complètement. On s’en fiche complètement. Alors, si vous voulez, c’est cela qui est amusant parce qu’il faut après qu’il y ait cette renaissance de l’esprit patrimonial des Français, peut-être même d’autres pays, c’est possible que cela se passe ailleurs aussi, tout cela c’est l’après-guerre, l’après-guerre, il y a d’abord la reconstruction, il y a les démolitions qui font réapparaître des choses puis après il y a la volonté de faire certains quartiers qui vont être ce que l’on appelle les nouveaux quartiers. Quand on fait quelque chose comme ça, on a des financiers qui sont là, on a des partenaires. Donc, la ville, même si elle est décisionnaire, même si elle donne certains droits de bâtir, elle n’est pas celle qui paie.
Voix d’homme ( ?) : Si on avait continué à explorer, notamment du côté de la Poste, sachant que César avait établi son camp sur la butte Saint-Charles…
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Là, on est juste en-dessous de la butte Saint-Charles.
Voix d’homme ( ?) : Voilà.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : En dessous de la Gare de Marseille.
Voix d’homme ( ?) : On aurait certainement trouvé d’autres choses. Il y en a qui dorment tranquillement, en attendant un jour, que j’espère, mais que moi je ne le verrai pas, où l’on trouvera des merveilles, encore d’autres merveilles. Donc, on a circonscrit, ce qui veut dire que tout ce qui était en dehors de la circonscription, on l’a sacrifié. On l’a relevé, étudié, analysé, on l’a démonté, conservé ailleurs, mais on l’a enlevé d’ici. Les années passent, on découvre encore des choses, on met en valeur. J’avais fait le pari, un jour, avec François Salviat, l’un des deux archéologues, que nous inaugurerions triomphalement le Jardin, en présence du maire, Gaston Defferre, qui viendrait couper le ruban tricolore et dire : nous avons pu conserver ces vertiges, de haute lutte, nous les avons maintenus, contre vents et marées… et c’est exactement ce qui s’est passé.
Voix de femme, probablement celle d’Anaïs Kien : Merci à Jacques Bonnadier, Marius Aubert, Claude Varoqueaux, Michel Bonifay, Henri Treziny, Jeanne Laffitte, Robert Vigouroux et François Salviat. Archives Ina, Olivier Tosseri. Mixage, Claire Levasseur. « Bienvenue au Centre Bourse ! », Anaïs Kien, Renaud Dalmar.
Emmanuel Laurentin : Merci également à Vincent Charpentier qui tient une émission d’archéologie sur France Culture, depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années, « Le Salon noir », que vous retrouverez demain, de 14h 30 à 15h, comme tous les jours. Vincent Charpentier qui nous a aidés à préparer cette semaine sur l’histoire de l’archéologie. Demain d’ailleurs, il traitera de la Chine, c’était notre thème de la semaine dernière, autour de l’exposition « Les soldats de l’éternité », à la Pinacothèque de Paris. Pour tout renseignement, sur le site de France Culture, pour l’émission « Salon noir » mais également pour « La Fabrique de l’Histoire ». Puis, à propos d’internet, nous avons reçu, d’un auditeur, l’annonce de la création d’un groupe Facebook - on ne sait pas très bien comment cela marche, un groupe Facebook – consacré à la « La Fabrique de l’Histoire ». Puis également, saluons l’initiative de plusieurs auditeurs, qui prennent sur leur temps personnel pour pouvoir scripter certaines des émissions de « La Fabrique de l’Histoire ». C’est le cas d’un site qui s’appelle « La Fabrique de sens », fabriquedesens.net, qui scripte et qui a scripté plusieurs émissions de « La Fabrique de l’Histoire », certaines d’entre-elles, mais pas seulement d’ailleurs mais aussi d’autres émissions de France Culture puisqu’il y a des émissions d’hommage à Jean-Pierre Vernant. La dernière de « La Fabrique de l’Histoire » qui ait été scriptée, c’est le documentaire consacré à la « Bleuïte ou l’art de la guerre », diffusée il y a quelques mois, en février dernier, « La Fabrique de l’Histoire » dans la collection, « Histoire du renseignement ». Puis également, un autre site qui s’intitule, Le thiboniste, qui a scripté plusieurs émissions liées à l’histoire de l’histoire, à l’historiographie ou encore à l’enseignement de l’histoire, c’est le cas de l’enseignement de l’histoire en France, des manuels scolaires de l’histoire, d’une émission sur Vidal de La Blache ou encore des émissions que nous avions consacrées, il y a quelques années, à Marc Bloch. Remercions donc, ces auditeurs d’avoir fait cet effort de scripter pour des auditeurs qui n’auraient pas pu les entendre, certaines de nos émissions.