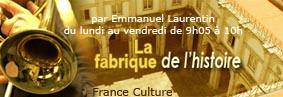Introduction par Emmanuel Laurentin : Vous l’avez compris, nous avons cette semaine, une semaine spéciale, dans La Fabrique de l’Histoire, consacrée à l’histoire des crises économiques ou plutôt les crises économiques dans l’histoire. Troisième temps de cette semaine spéciale, après nous être demandé, lundi, si la notion de crise économique était valide pour la Grèce antique ou encore pour Rome puis nous être arrêtés sur les sociétés italiennes, hier, de la fin du Moyen-âge et les faillites bancaires que connurent les Florentins et les Vénitiens du XIVe siècle au XVIe siècle, et avant, demain, de nous intéresser, et ça n’est pas très étonnant, à la supposé très connue crise de 29, nous nous poserons, aujourd’hui, la question des crises économiques et bancaires du XVIIIe siècle. Nous parlerons en particulier de la banqueroute de Law, en 1720 mais aussi de toutes les autres crises financières qui précédèrent la Révolution française. Avec Séverine Liatard de La Fabrique de l’Histoire, Jean Cartelier, économiste, professeur émérite à l’Université de Paris 10 Nanterre, auteur de « La monnaie », chez Flammarion, Joël Félix, professeur d’histoire moderne à l’université de Reading, en Angleterre, et auteur d’une biographie de l’Averdy, publiée aux éditions du Comité d’histoire économique et financière de la France, et avec Guy Lemarchand, professeur émérite à l’Université de Rouen et auteur très récent, chez Armand Colin, de « L’économie en France de 1770 à 1830 ».
« Ce 17 juillet 1720, au matin, il y eut une telle foule, à la banque et dans les rues voisines, pour avoir chacun de quoi aller au marché, qu’il y eut 10 ou 12 personnes étouffées. On porta, tumultuairement, trois de ces corps morts à la porte du Palais royal où le peuple voulait entrer à grands cris. On y fit promptement marcher un détachement de la compagnie de la garde du roi des Tuileries. La Vrillière et Leblanc arrangèrent séparément ce peuple. Le lieutenant de police y accourut, on fit venir des brigades Duguet, on fit, après, emporter les corps morts et par douceurs et cajoleries, on vint enfin à bout de renvoyer le peuple et le détachement de la garde du roi s’en retourna aux Tuileries. Sur les 10h du matin, que tout cela finissait, Law s’avisa d’aller au Palais royal. Il reçut force imprécations par les rues, Monsieur le Duc d’Orléans ne jugea pas à propos de le laisser sortir du Palais royal où deux jours après il lui donna un logement. Il renvoya son carrosse, dont les glaces furent cassées à coups de pierres, son logis en fut attaqué aussi, avec grands fracas de vitres. » C’est un extrait des mémoires de Saint-Simon.
Guy Lemarchand, vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu à Rouen. Quand vous entendez cette panique, cette volonté de vouer aux gémonies celui qui avait été porté aux nues quelques années plus tôt, ça vous fait penser à quoi, vous qui êtes un spécialiste de cette économie de l’Ancien régime et en particulier du XVIIIe siècle ?
Guy Lemarchand : C’est bien typique des renversements de conjonctures qui caractérisent l’évolution du capitalisme. Mais, si l’affaire Law est une affaire compliquée, institutionnalisée en quelque sorte, le capitalisme a déjà montré son instabilité, je dirais presque dès sa naissance dans un cadre beaucoup plus frustre, moins institutionnalisé que ne l’est l’épisode des années 1720.
Emmanuel Laurentin : À quoi pensez-vous exactement ?
Guy Lemarchand : Je pense à ce qui a été cité récemment dans des propos d’économistes, assez nombreux, à propos de la crise du XXIe siècle : l’épisode de la tulipomania dans les Provinces Unies dans les années 1620-1630.
Emmanuel Laurentin : Effectivement, on a entendu Olivier Pastré, Jacques Marseille évoquer cette crise des tulipes. Vous pouvez nous résumer, en deux mots, de quoi il s’agissait exactement ?
Guy Lemarchand : Je dirais qu’elle est intéressante, elle est beaucoup plus réduite naturellement que l’affaire Law, mais précisément, elle se déroule dans un cadre qui n’est pas encore institutionnalisé, organisé et donc, elle est extrêmement spontanée et au fond, elle définit bien l’esprit profond du capitalisme débarrassé des bondieuseries, sur le bon capitalisme opposé au mauvais etc., etc.
Emmanuel Laurentin : Il n’y aurait pas un tout petit peu d’idéologie dans ce que vous êtes en train d’analyser ?
Guy Lemarchand : Non, non, pas du tout, parce qu’on y voit la spéculation à l’état pur dans une économie d’échanges déjà largement monétarisée.
Emmanuel Laurentin : Il faut rappeler qu’effectivement la tulipe est toute récente. Elle arrive à la fin du XVIe siècle en Hollande, aux Pays-Bas, qu’il y a une sorte de passion qui s’empare des habitants des Pays-Bas autour de cette tulipe tout juste découverte, arrivée en particulier par la Turquie, et on commence à spéculer sur les bulbes de tulipes. Il y a d’ailleurs un roman, récent, qui s’appelle Semper Augustus, qui fait référence effectivement à la tulipe la plus recherchée de l’époque justement, la Semper Augustus.
Guy Lemarchand : On commence à spéculer effectivement et c’est une véritable frénésie. Après 1620, le prix des oignons va augmenter considérablement, on va les vendre souvent plus de 20 fois le prix d’achat. En même temps, la culture du précieux oignon va se développer autour d’Harlem, dans la Province de Hollande à proximité d’Amsterdam. On voit se mettre en place des procédures, des pratiques qui sont celles que nous connaissons au XX-XXIe siècle : l’achat à terme, même à découvert, on achète, généralement contre de l’argent, naturellement, les oignons en question, éventuellement contre, si l’on n’a pas d’argent liquide, de l’argenterie, des tissus ou même de l’argent que l’on aura obtenu en hypothéquant sa maison.
Emmanuel Laurentin : C’est ce qu’on appelle, c’est comme ça en tout cas que ça a été conçu ou perçu par les historiens de l’économie, la naissance d’une bulle spéculative. On a dit cela.
Guy Lemarchand : Voilà, exactement. Jusqu’à février 1636 où le cours étant monté ci-haut la tendance s’inverse. Et alors-là, c’est la débâcle en quelques semaines, qui va se prolonger sur des mois, et qui donne lieu déjà à une intervention des pouvoirs publics parce que beaucoup de gens avaient participé à la spéculation, des riches, bien sûr, mais également des gens à la limite de la pauvreté dans la perspective d’enrichissement. Les pouvoirs publics vont d’abord annuler les derniers marchés, mettre en place des commissions d’arbitrage et limiter la surface de culture de l’oignon en question.
Emmanuel Laurentin : Faisant baisser justement le prix de ce même oignon de tulipe. On voit que l’histoire ce sont des faits mais ce sont aussi des interprétations. L’histoire économique n’y échappe pas. Je pense que Joël Félix, qui est avec nous, qui est également historien et professeur à l’université de Reading, spécialiste de XVIIIe siècle, il sort un tout petit peu de son siècle pour remonter au XVIIe avec vous, Guy Lemarchand, n’est pas du tout d’accord avec votre interprétation sur l’histoire de la crise de la tulipe.
Joël Félix : Ce n’est pas que je sois spécialiste exactement de la tulipe, mais enfin j’ai lu un petit peu les derniers travaux qui ont été écrits, en particulier par une historienne anglaise, récemment…
Emmanuel Laurentin : Il faut dire que sur ce sujet-là, les Anglo-Saxons sont plus en avance, en tout cas s’intéressent plus à ces questions-là que nous.
Joël Félix : En effet, l’année dernière, apparemment, le livre le mieux documenté sur cette question, qui est une personne qui dit que les Hollandais sont calés dans les archives, montre en réalité que l’affaire de la tulipe est beaucoup plus compliquée que ça. Les sources, on sait très peu de choses en réalité sur les oignons. C’est tiré d’un certain nombre de pamphlets. Ce que montre cet auteur en grande partie, c’est que l’affaire des tulipes est montée en épingle, si je puis dire, pour essayer de critiquer le développement du capitalisme, certainement au début du XVIIe siècle. Pourquoi ? Parce que d’une certaine mesure cela inquiète le magistrat à l’époque, ça remet en cause un certain nombre de classifications sociales. Cela dit, voir dans la tulipe, comme le dit Monsieur Lemarchand, pour lequel j’ai beaucoup de respect pour ses travaux, semble un peu excessif, comme il l’a très bien dit d’ailleurs, les conséquences ne sont pas très grandes sur le marché financier ou économique. D’autre part, on a toujours tendance à parler du marché à terme de la tulipe, c’est-à-dire que vous fixez un prix de vente à une date précise, le problème est que la tulipe est quelque chose de très spécial parce que la tulipe vous la voyez une fois par an pendant deux mois et pendant ce temps-là ce sont des oignons qui sont cachés et qui se vendent. Donc, il faut attendre et vous êtes là dans un marché à terme et vous vous dites pendants 6 mois je vous achèterai un oignon un tel prix.
Emmanuel Laurentin : Ça veut dire, Jean Cartelier, vous n’êtes pas historien, vous êtes économiste, qu’il y a toujours cette tendance habituelle, les historiens n’y échappent pas, à trouver la première fois, le premier moment, à essayer de rechercher le moment qui permettra l’analogie. On a essayé tout au long de cette semaine, en essaye encore jusqu’à demain, d’échapper à cette analogie, à cet anachronisme, mais on cherche toujours un moment dont on peut se dire : « eh bien voilà, c’est l’origine, c’est le point de départ ». Jean Cartelier ?
Jean Cartelier : En ce qui concerne le système de Law et son échec, je ne pense pas du tout à une analogie avec ce qui se passe aujourd’hui. Guy Lemarchand a parlé du capitalisme, d’une sorte de permanence, je dirais, à propos de l’échec de Law, que c’est plutôt un échec à instaurer, à un moment qui ne s’y prêtait pas pour des tas de raisons politiques et sociales, un système plus proche de ce qui existera plus tard que de ce qui excitait à l’époque. Et si le mot de crise financière, à propos de Law, s’applique, c’est dans un sens ancien où la finance désignait tout ce qui était autour des finances publiques.
Emmanuel Laurentin : Alors, justement, puisque vous évoquez, on va clore le chapitre très court autour de la tulipe et du XVIIe siècle et arriver au XVIIIe siècle avec cette crise de Law en 1720. Écoutons une archive, tirée des archives de l’Ina, c’était en 1976, une Tribune de l’Histoire, qui mettait en scène cette crise de Law.
- « C’est la banque du royaume.
- Que Monsieur Law, soit le contrôleur général, que son affaire se confonde avec les finances du roi, ne retire rien à la chose. Les financiers lui en veulent. Comme ils leur restent passablement de ressources, ils peuvent quand ils veulent, et ils l’ont déjà fait, jouer de mille et un artifices pour provoquer tantôt la hausse, tantôt la baisse, voire la panique. Certaines altesses ne procèdent pas autrement, voyez, le prince de Condé, duc de Bourbon. Law les calment en gavant. Tant qu’ils seront sûrs d’être gavés, ils seront à peu près sages. Après, leur intérêt seul, prévaudra.
- Et l’intérêt de l’État, l’intérêt du royaume, qu’en fais-tu ?
- Hors vous et moi, qui s’en préoccupe ?
- Law.
- Ho ! Ho ! Ho ! Altesse, après l’avoir converti, vous allez maintenant le canoniser !
- Laisse-moi tranquille. Tu es bon ouvrier en affaire extérieures mais tu ne connais rien à la finance.
- Justement ! Un ecclésiastique ne saurait convaincre le plus grand prince du monde. Mais, je vous le dit, mon seigneur, le système est une machine fragile. D’autant plus fragile que Monsieur Law, toujours prêt à se recommander de Descartes et de Leibniz n’a justement point hérité du cartésianisme.
- Tu philosophes maintenant ! On aura tout entendu.
- Monsieur Law vous dit, au début des opérations bancaires, c’est indispensable pour inspirer confiance et pour satisfaire aux demandes de remboursement.
- C’est logique, non ?
- Mais parfaitement logique. Mais il affirme encore que la circulation des billets peut-être infiniment supérieure à l’encaisse métallique.
- Mais bien entendu ! Du moment que le public a confiance.
- Non, mon seigneur. La confiance est trop fragile. Il faudrait au moins déterminer une règle permettant de calculer la quantité de billets susceptibles d’être mis en circulation. Et cette quantité doit logiquement être fixée en fonction même de l’encaisse en métal précieux.
- C’est dommage que tu ne sois pas plus ouvert aux grandes idées. Tu oublies le Mississipi et l’ensemble des compagnies coloniales. Ce ne sont point là de fallacieuses promesses et il est normal que cela favorise les investissements. »
Emmanuel Laurentin : Extrait d’une Tribune de l’Histoire, sur France Inter, en 1976, résumant cette faillite de Law, cette banqueroute de Law. On a eu beaucoup de mots prononcés, beaucoup de pistes. Il va falloir peut-être dénouer tout ça pour les auditeurs qui ne se souviennent plus très bien de ce dont il s’agit.
Sévérine Liatard : Il s’agit du contexte, le système économique de l’époque, à quel moment Law arrive à se faire écouter par la Régence puisque c’est le duc d’Orléans en fait qui dirige l’État. Joël Félix, est-ce qu’on peut revenir un petit peu sur…
Emmanuel Laurentin : À la fois sur la personnalité de Law et sur le contexte.
Joël Félix : Law est un personnage assez intéressant parce qu’il est Écossais. C’est un étranger en France, ça lui sera reproché d’ailleurs plus tard.
Emmanuel Laurentin : On évoque sa conversion justement.
Joël Félix : Quand on pense à l’Écosse, à part peut-être Gordon Brown maintenant qui est chancelier de l’échiquier, on ne pense pas du tout à des économistes. L’Écosse a fourni un grand nombre d’économistes dont Harvey ( ?) et Adam Smith. Donc, c’est un monde très intéressant. Lui-même est le fils d’un orfèvre ce qui est très important parce que ce sont des banquiers, à la fin du XVIIe siècle, qui sont en train de réfléchir sur les mouvements d’argent etc. Alors, Law est un personnage haut en couleurs. Il a une bonne éducation. C’est un homme très beau. C’est un dandy à la fin du XVIIe siècle. Il a un problème avec un autre dandy et ils se battent en duel pour une maîtresse, il le tue. Condamné, il est obligé de s’enfuir en Europe. Il va passer de ville en ville, de pays en pays, essentiellement en jouant. Il paraît qu’il était très doué pour les statistiques et les mathématiques, il était capable aux tables de jeu de pouvoir assez rapidement voir quel était l’enjeu. Ça, c’est pour Law, sa personnalité. Ce qu’il faut comprendre aussi c’est qu’à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle il était commun, pour un certain nombre de gens qui avaient des idées économiques, de suggérer au gouvernement des projets de réforme. On les appelait les projecteurs, en Angleterre, ou les donneurs d’avis. Donc, régulièrement, des dizaines, même des centaines de gens écrivaient aux ministres pour leur suggérer des idées.
Emmanuel Laurentin : Ah ! oui, c’était une pratique ?
Joël Félix : Absolument.
Emmanuel Laurentin : Il y avait comme ça des gens qui spontanément envoyaient des projets de réforme ?
Joël Félix : Absolument. On a des travaux très précis sur ce sujet au XVIIe - XVIIIe siècle. Ils essayaient évidemment de les voir mis en place par le ministre et obtenir un…
Emmanuel Laurentin : Une compensation.
Joël Félix : Absolument.
Emmanuel Laurentin : Une compensation financière. Jean Cartelier, sur ce contexte de 1715, parce qu’il faut se souvenir de la mort de Louis XIV, de la Régence, d’une France qui, sans être en faillite est en mauvaise santé financière. Donc, il faut redresser l’état financier de la France et voilà ce Law qui arrive dans ce contexte, un peu particulier, et qui vient proposer sa solution à la crise française.
Jean Cartelier : Vous avez raison de dire qu’il y avait des problèmes de finance énormes puisqu’en 1715 il y a le fameux visa qui va réduire la dette publique qui est un problème énorme et qui indique, les chiffres diffèrent, mais cette réduction par le visa, selon certain auteurs, va jusqu’à 60% de la valeur de la dette, ce qui veut dire que les créanciers sont spoliés bien entendu, mais ça donne une indication du crédit public à cette époque. Law arrive dans une situation où pratiquement il n’y a pas d’autres solutions, il y a d’autres expédients, mais les temps sont mûrs pour quelque chose de grandiose.
Emmanuel Laurentin : De grandiose de quelle façon ? Comment va-t-il mettre en musique ce caractère grandiose ?
Jean Cartelier : C’est précisément ce qui fait, à mon sens, l’intérêt de ce système de Law, qui évite d’ailleurs d’avoir des comparaisons avec ce qui se passe aujourd’hui. C’est que Law a une vision très claire des choses. Il va construire un système sur deux piliers qui vont être réunis. Les deux piliers vont se mettre en place, à partir de 1716-1717 et ils vont être réunis en 1719. Je dis rapidement. Le premier pilier, c’est la création de la banque générale en 1716, qui va devenir après la banque royale en 1718. Donc, cette fameuse banque à laquelle il est fait allusion…
Emmanuel Laurentin : Dans l’extrait qu’on vient d’entendre.
Jean Cartelier : Voilà. Où il y a une encaisse métallique, bien entendu, une émission de billets, une banque classique qui émet des billets par escompte, très bien. Puis, il y a un deuxième élément qui va être mis en place au même moment où quelques temps après,…
Emmanuel Laurentin : C’est la Compagnie.
Jean Cartelier : La Compagnie coloniale qui hérite de la Louisiane et que Law va faire prospérer, qui va prendre différents noms jusqu’à s’appeler la Compagnie des Indes, qui va prendre en charge progressivement un certain nombre de ressources : fabrication des monnaies, les tabacs, les impôts etc., qui va donc avoir un certain nombre de ressources. Le système va consister à fusionner ou à mettre en relation étroite…
Emmanuel Laurentin : Cette banque d’abord privée, ensuite devenue Banque royale avec ce système de compagnies coloniales.
Jean Cartelier : Voilà. Alors l’idée est très simple. L’idée est : vous avez les créanciers de l’État, avec tout ce système financier traditionnel, Law veut briser ce système en interposant une compagnie qui va devenir la créancière de l’État, qui va émettre les fameuses actions, où il y aura soi-disant spéculation, qui vont être souscrites grâce à la monnaie émise par la banque.
Emmanuel Laurentin : Donc, une sorte de système intégré.
Jean Cartelier : Totalement intégré.
Emmanuel Laurentin : Conçu de façon très précise. Il faut dire que c’était un penseur de l’économie, il avait écrit quelques textes économiques qui justement tentaient de penser avant de mettre en application ce qu’il allait faire plus tard. Joël Félix, puis ensuite, je donnerai la parole à Guy Lemarchand.
Joël Félix : Oui, bien sûr il avait pensé l’économie, écrit un certain nombre de textes, suggéré des propositions au Régent. Ce que je voudrais rajouter c’est qu’en 1715, c’est la mort de Louis XIV. Il y a une volonté de renouvellement complet en France. Le Régent qui est considéré, parmi les historiens, comme l’homme des plus intelligents veut prendre des mesures nouvelles. Pourquoi ? Parce que la France est à un niveau d’endettement absolument considérable, il y a des dettes qui ne peuvent pas être payées et c’est le Régent précisément qui connaît Law personnellement, qui l’a rencontré, qui décide de le soutenir contre l’avis de l’establishment de l’époque qui refuse, le Parlement, les financiers, les négociants,…
Emmanuel Laurentin : On peut dire qu’il a tout le monde contre lui à ce moment-là
Joël Félix : Il a beaucoup de monde contre lui.
Emmanuel Laurentin : Il a juste le soutien de celui qui est à la tête de l’État.
Joël Félix : Il l’a définitivement, c’est sûr.
Emmanuel Laurentin : Guy Lemarchand ?
Guy Lemarchand : Ce qui est frappant dans l’épisode de Law, avec évidemment les différences par rapport à aujourd’hui, c’est quand même trois choses me semble-t-il : La collusion entre le privé et l’État, qui vient d’être rappelée par les intervenants précédents ; deuxième trait, le gigantisme de l’entreprise, avec cette réunion des activités de banques proprement dite, et puis des activités économiques d’exploitation coloniales ; troisième élément, la fragilité des combinaisons financières qui sont opérées dans l’épisode et qui, on le sait, évidemment vont aboutir à un fiasco complet.
Emmanuel Laurentin : Évidemment, vous l’avez dit, gigantisme, vous n’êtes pas d’accord avec l’idée du mélange du privé et du public, Jean Cartelier ?
Jean Cartelier : Non, ce n’est pas exactement que je veux dire. Ce n’est pas le mélange, le mot n’est pas bon. Ce que je veux dire, c’est qu’il ne faudrait pas réduire ce qui s’est passé à ce moment-là à de vulgaires spéculations.
Emmanuel Laurentin : C’est ce qui a d’ailleurs souvent été fait après coup…
Jean Cartelier : Exactement.
Emmanuel Laurentin : Y compris la faillite de 1720, on a tout de suite dit, c’était de la spéculation, point barre. Mais c’est beaucoup plus complexe que ça.
Jean Cartelier : C’est plus complexe parce que pour que le système marche, et ça, Law en a une très claire conscience, il faut deux choses au moins : il faut - bien qu’il ait l’appui du Régent, il ne peut pas édicter, il le sait très bien d’ailleurs – l’accord des agents économiques en général et il lui faut imposer les billets à la place de la monnaie métallique. Donc, c’est dans une concurrence d’une problématique entre les monnaies, qui est une problématique très moderne de ce point de vue-là, et Law va se livrer à toute une série de manipulations pour faire en sorte que les billets soient préférés à la monnaie métallique. Parce que si les billets ne l’étaient pas, naturellement la banque ne pourrait pas aider ce système de la dette publique.
Séverine Liatard : Justement, Law va se rendre compte de l’excès de liquidité et donc il va commencer à prendre des mesures vers 1719, pour obliger finalement à ce que le public utilise finalement ce papier – monnaie. En prenant ces mesures, il intervient justement dans un système économique alors que justement l’idée c’était qu’il ne fallait pas justement légiférer a priori.
Jean Cartelier : Ah ! non, il est toujours intervenu dès le départ.
Séverine Liatard : Il n’y a pas plusieurs interprétations ?
Jean Cartelier : Je prends juste l’exemple du haussement considérable des monnaies qu’il a fait, je n’ai plus la date exactement en tête, mais dont Paris-Duverney a dit que c’était le plus grand haussement qui avait jamais été fait en temps de paix, de 50%, avec une programmation des diminutions successives qui font que les agents savent que la monnaie métallique va perdre de sa valeur, et ça, c’est programmé par Law, donc, ils préfèrent les billets. Le billet avait une sur-cote par rapport à la monnaie métallique. C’est une intervention directe de Law, il n’a pas arrêté d’intervenir.
Emmanuel Laurentin : On a du mal à imaginer aujourd’hui ce que cette pensée économique avait, dans son application au quotidien, de révolutionnaire, Joël Félix. Il faut savoir qu’avant l’introduction de cette monnaie fiduciaire, ces billets de banque, il y avait une circulation de la monnaie métallique avec par ailleurs une monnaie de compte qui était différenciée de la monnaie métallique. On avait, par exemple, la livre tournois, pour la France, la livre sterling, pour la Grande-Bretagne et la différence entre cette monnaie de compte et la monnaie métallique était décidée par le pouvoir qui donnait des titres en disant : la monnaie réelle vaut tant par rapport à la monnaie de compte. Alors, qu’est-ce qu’il y a de révolutionnaire dans ce système de Law ?
Joël Félix : Il y a deux choses qui sont révolutionnaires. D’une part, on est à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle dans un système de rareté de monnaie. Donc, les gens essayent de trouver des solutions pour compenser la monnaie, on arrivera sans doute à nommer Keynes parce que Law est considéré comme le précurseur. Donc, il essaye d’introduire une forme de monnaie qui soit beaucoup plus stable que celle qui existe. Il pense en particulier que si vous multipliez la monnaie vous allez soutenir l’économie et de cette manière évidemment vous apportez des solutions aux dettes de l’État qui sont considérables en 1715. Mais ce que je voudrais dire, c’est que le système de Law, comme vous l’avez bien dit Monsieur Cartelier, c’est un système qui s’étend sur plusieurs années, de 1716 à 1720, qui a des développements progressifs, il est difficile de suivre. Si on voit bien la pensée au début de 1716, il est moins dévident de comprendre ce qu’il fait en 1719-20 et 23 quand il parle encore au Régent de revenir en France.
Emmanuel Laurentin : Oui parce qu’on est surpris du succès que remporte, dans cette France de 1716-1717, ce système particulier. Guy Lemarchand, sur ce point ?
Guy Lemarchand : Oui. Il y a surtout la perspective et des Indes orientales et surtout la grande nouveauté, l’exploitation de la Louisiane, le Mississipi. Il y a la perspective de faire des profits énormes, avec l’exploitation de ce territoire colonial, que l’on connaît fort mal, qu’on n’a même pas fini, loin de là, d’explorer.
Emmanuel Laurentin : Et qui, il faut le rappeler, est bien plus grand que la Louisiane actuelle, c’est un immense territoire au Sud-est des États-Unis. Effectivement on peut espérer qu’il y ait là des ressources considérables à exploiter. C’est ça, Guy Lemarchand ?
Guy Lemarchand : Oui. Et puis il y a aussi le problème de la dette qui a été rappelée et la variété des titres de créances émis par l’État pour payer ses dépenses, des titres qui sont à échéance d’un mois ou quelques mois, qui circulent « virtuellement » comme une espèce de papier monnaie et qui constituent une masse absolument énorme.
Séverine Liatard : Il y avait aussi cette question de la création d’une banque qui devait être soutenue par l’État, ce qui sera le cas en Angleterre, Joël Félix alors que ça ne sera pas le cas en France. C’est aussi ça, d’après certaines interprétations qui fait l’échec du système de Law. C’est finalement les financiers qui vont reprendre la main sur les finances du royaume.
Joël Félix : La France et l’Angleterre au XVIIe et XVIIIe siècle sont des ennemis, se font la guerre, on parle de la seconde guerre de Cent ans qui va de 1715 à 1815. Il y a deux modèles politiques et financiers. L’Angleterre a connu à la fin du XVIIIe siècle, ce que les historiens Anglais appellent Financial Revolution. C’est fondé sur un parlement, une représentation, la banque d’Angleterre qui intervient pour prêter de l’argent notamment sur la dette. En France le problème est : Peut-on avoir une banque ? Un certain nombre de personnes considèrent qu’en France le type même du régime ne permet pas de créer une banque dont les fonds vont être saisis par ce gouvernement. Il y a un manque de confiance.
Emmanuel Laurentin : Et d’autonomie, c’est cela que vous voulez dire ?
Joël Félix : Et de contrôle de l’autorité royale.
Jean Cartelier : Joël Félix a tout à fait raison. D’ailleurs, il y avait un mot qui avait circulé à propos de la banque de Law, on a dit : Non, il ne risque pas de prendre le Trésor où il n’y a rien, c’est plutôt le Trésor qui va prendre la Banque où il y a quelque chose.
Emmanuel Laurentin : C’est très étrange tout de même ce personnage qui est étranger à la France, qui arrive un peu comme tous ces voyageurs du XVIIIe siècle, qu’on connaît bien quand on s’intéresse à ce siècle-là, même du XVIIe siècle, qui arrive, qui s’installe et qui d’un seul coup part dans cette sorte de folie d’imaginer de réduire la dette publique, parce qu’il y a aussi cette idée-là. Par son système, il va finir par réduire la dette publique. Quel est son intérêt dans cette affaire-là ? On se pose encore la question aujourd’hui. On se demande si c’était un aventurier, quelqu’un qui avait un sens du bien commun supérieur à tous les autres, à ce moment-là ?
Joël Félix : Je crois qu’il y a un peu de tout. C’est un personnage composite. Les historiens décrivent des personnages différents de Law et il est présent un peu dans tous les portraits qu’on montre. Certainement qu’il est un aventurier. Certainement il est un joueur. Mais en même temps, il faut penser que la France c’est une grande puissance, c’est l’équivalent des États-Unis de nos jours. Ça attire beaucoup de gens, il y a des masses considérables d’argent, il y a des possibilités financières.
Séverine Liatard : Law pense ce système au moment où il rencontre le duc d’Orléans, est-ce que ce n’est pas une sorte de marché qu’il établit finalement avec le Régent ? Je vais monter un nouveau système économique et financier et en contrepartie je vais essuyer la dette de l’État.
Emmanuel Laurentin : Un modèle de pensée qui pourrait s’appliquer et devenir une sorte de réalité. Jean Cartelier, puis Guy Lemarchand.
Jean Cartelier : John Law est un faiseur de projet. Il a fait des projets de banques foncières en Angleterre et en Écosse, Murphy a publié son « Law’s Essay on a Land Bank », « Money and Trade » est aussi un projet de banque foncière, il date de 1705, plus tard, après son échec en France, il fera un projet pour le duc de Savoie à Turin. Donc, c’est vraiment quelqu’un qui veut appliquer des idées. Mais il a des idées originales et des idées très fortes.
Guy Lemarchand : Je crois qu’il y a quelqu’un qui a dit que Law est un personnage très complexe. Je crois que dans ces 4 ans, entre 1716 et 1720, il y a deux personnages successifs. Au point de départ, à la fondation, en mai 1716, de la Banque générale, Law est un personnage modéré, en ce sens qu’il est prévu que l’encaisse métallique doit égaler les billets, les billets émis ne doivent pas dépasser l’encaisse métallique, et d’autre part il est prévu déjà un lien indirect avec l’État en ce sens que les actions de la banque nouvelle sont payables pour une grande part en papier public. Il y a donc l’idée en même temps pour l’État d’éponger la dette. Puis, au fil des années, le projet va devenir gigantesque jusqu’à cette collusion où Law devient officiellement contrôleur général des finances, remplaçant Argenson.
.
- « Monseigneur, j’ai dit cent fois à votre Altesse royale que je voulais m’en aller.
- Monsieur Law, je t’ai dit cent fois que tu devais rester. Tu as voulu faire des miracles, je te condamne à les faire.
- Par grâce, mon seigneur, j’étais sûr de mon système mais j’avais compté sans la méchanceté des hommes.
- Tu avais aussi compté sans moi. J’ai fait rentrer sous terre des gens qui jouait à la baisse. J’ai muselé le parlement. J’ai voulu, avec toi, jouer la plus grande expérience monétaire qui fut, pour le bonheur de ce peuple que j’aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je te nomme, écoute-moi bien, John Law, je te nomme, et ce titre n’existait plus depuis messire Nicolas Fouquet, vicomte de Vaux, je te nomme surintendant des finances. ».
.
Emmanuel Laurentin : Quel était l’intérêt du duc d’Orléans à pousser, à soutenir à ce point, y compris jusque dans ses travers, le système de Law ?
Joël Félix : Une chose importante, c’est qu’entre les finances et les politiques il y a toujours des liens très importants. Il faut savoir que la situation du duc d’Orléans n’est pas absolument stable en France au début du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que l’héritier du trône, qui est le jeune Louis XV à l’époque, était un peu souffreteux et personne ne sait exactement combien de temps il va vivre. Mais en Espagne, il y a un roi, qui est l’héritier direct de Louis XIV et qui pourrait bien en effet, dans le cas où le jeune Louis XV mourrait, prendre la place du duc d’Orléans. Une conspiration est montée, précisément dans les années 1718, pour essayer d’éliminer le Régent du trône et par conséquent le Régent décide de rentrer en guerre contre l’Espagne qui est un Bourbon aux côtés de l’Angleterre. On a donc besoin d’un financement. Trouver de l’argent pour financer cette guerre, d’où la volonté du Régent de soutenir Law’s, de transformer sa banque privée en une banque royale.
Emmanuel Laurentin : Oui, on voit bien qu’effectivement ces financements des guerres est essentiel, en particulier au XVIIIe siècle, c’était déjà le cas au XVIIe siècle. Je voudrais revenir sur ce que disait, avant même d’écouter cette archive de 1976, La Tribune de l’Histoire, Jean Cartelier, Guy Lemarchand. Il disait : il y a en gros deux Law. Il y a un lLaw plus sage et un Law plus fou. C’est la thèse d’ailleurs aussi que défendait Edgar Faure, dans son livre de 1977, où il disait : il y a un plan sage, jusqu’en 1719 et puis il y a un plan fou, c’est le plan final que vous avez décrit tout à l’heure, Jean Cartelier. Est-ce qu’on peut ainsi séparer l’expérience de Law en deux, comme ça aussi nettement ? Ou est-ce que c’est simplement le développement d’un projet initial qui contenait déjà ce qui allait advenir ?
Jean Cartelier : Je pense que c’est une commodité de présentation qui fausse un peu la perspective. En fait, s’il y a une coupure qu’il faut faire, c’est entre la pensée de Law et son application. Car il est vrai que Law avait pensé par avance tout ce qui est la question monétaire, la concurrence entre les monnaies, il n’avait pas pensé explicitement la question fiscale et financière. Là, il y a effectivement une coupure. Et quand il se lance dans cette énorme chose, il faut quand même réaliser qu’alors le capital de la compagnie depuis 6 ans, qui par la suite deviendra…
Emmanuel Laurentin : La Compagnie des Indes.
Jean Cartelier : Le capital de Compagnie était de 100 millions, il lance un emprunt qui au total va faire un milliard six cents millions pour précisément éponger la dette, c’est-à-dire pour se substituer, comme créancier de l’État, à l’ensemble de la masse des créanciers. Donc, effectivement, il y a bien un projet qui décolle à un certain moment. Mais, il est dans une certaine logique qui est la volonté de modifier à la fois le système fiscal en même temps que le système de l’endettement. Or, il n’a pas pu le faire et là, c’est pour ça que je voudrais revenir sur le soutien que le Régent a apporté à Law, ce n’est pas un soutien sans mélange. C’est vrai que le soutien est tout à fait justifié pour des raisons de politique extérieure, et Félix a parfaitement raison, en revanche sur le plan intérieur le soutien du Régent lui fera défaut, à Law, au moment décisif. Et disons que dans le combat intérieur entre des gens qui avaient intérêt à l’ancien système et des gens qui avaient intérêt au nouveau, le Régent finalement ne saura pas trancher de façon suffisante.
Séverine Liatard : Qui n’a pas intérêt justement à ce nouveau système ? Les financiers ? Les grands ? Les princes ?
Jean Cartelier : Symboliquement,…
Emmanuel Laurentin : Les services généraux ?
Jean Cartelier : C’est les frères Paris, qui vont être chargés de la liquidation du système de Law, qui sont les grands adversaires. Or, ces gens, qu’est-ce qu’ils vont faire ? Ils vont naturellement participer à la spéculation, ce qui va leur donner des moyens énormes, pour ensuite jeter ces actions sur le marché au bon moment. Il va y avoir des raids. Il y a eu un premier raid sur la banque, en 1718, qui a été fait par les frères Paris. Ça va continuer. Donc, il faut bien voir que tout cela n’est pas un long fleuve tranquille. Il y a une véritable lutte entre des intérêts opposés.
Séverine Liatard : Le roi, l’État empruntent à ces financiers ?
Jean Cartelier : Le roi a 40% déjà du capital qui a été mis initialement dans la banque. Il a payé, on ne sait pas trop comment, on n’a aucune trace. C’est son trésor de guerre, disons.
Séverine Liatard : Ce qu’on apprend c’est que la royauté est dépendante. Elle n’est pas autonome financièrement.
Emmanuel Laurentin : Elle l’a toujours été depuis le Moyen-âge.
Séverine Liatard : Là, d’autant plus que la dette est considérable.
Joël Félix : Peut-être pour revenir sur les deux Law. C’est un thème assez intéressant. Moi, il me semble que c’est tout de même assez valable d’avoir deux définitions de Law. Dans la première phase, qui va jusqu’en 1719, Law se trouve dans une situation où il a toujours un coup d’avance sur le marché parce qu’il acquiert des compagnies progressives, qu’il fait monter la valeur des actions, lui-même essaye, par des marchés à terme, de soutenir la valeur de ces actions, avec l’idée à la fin de rembourser la dette à bon marché. Puis à partir de décembre 1719 - janvier 1720, quand le cours de l’action commence à s’effriter parce que précisément les financiers transforment, vendent leurs actions en billets de banques puis ensuite en espèce métalliques, le cours de l’action s’effondre et alors là, il a un coup de retard sur le marché qui le dépasse et le système s’effondre parce qu’il devient si compliqué qu’il devient pratiquement non manipulable.
Emmanuel Laurentin : Est-ce que c’est un système trop complexe pour la pensée économique ou la pratique économique de l’époque ? Ou est-ce que c’est simplement la conjoncture qui ne l’a pas soutenu ?
Joël Félix : Je pense que c’est dans une certaine mesure la conjoncture et un certain nombre d’erreurs de Law. Il y a un aspect jeu chez Law. Si l’on veut mettre un nouveau système en place, il faut essayer de le soutenir, que ça prenne et ça part. Mais à un moment, ça ne part plus chez Law et c’est la déconfiture.
Guy Lemarchand : Il y a un élément du contexte, qui d’ailleurs a été signalé au début de cet entretien, la rareté du métal précieux, la rareté de la monnaie métallique. Précisément, dans les années 1718-1720, on est dans une période de difficultés du commerce franco-espagnol, qui est un commerce positif pour la France et qui approvisionne en bonne partie la circulation monétaire, par les piastres espagnoles, en France. Or, ce commerce est en difficulté. Évidemment, ça va gêner considérablement les choses. Mais l’affaire Law n’est qu’une affaire de pure spéculation financière. Je suis tout à fait d’accord avec ce qui a été dit précédemment. Il y a des aspects positifs sur le plan économique, pour l’avenir, de cette affaire. Mais on va peut-être en reparler.
Emmanuel Laurentin : Jean Cartelier, une des questions que l’on peut se poser, c’est de savoir si tout compte fait, le public à qui a été adressé ces actions, - ce nouveau mode de répartition des richesses - était éduqué à comprendre comment cela fonctionnait. L’extrême nouveauté du système a peut-être aussi joué devant à la fois cet engouement, puis ensuite d’un désengouement progressif vis-à-vis du système de Law. Non ?
Jean Cartelier : La finance, est compliquée certainement mais les gens savent très bien où est leur intérêt.
Emmanuel Laurentin : On voit bien que vous êtes économistes.
Jean Cartelier : Ils arrivent tout à fait à s’orienter. Il faut revenir sur ce que Joël Félix a dit, avec lequel je suis totalement d’accord. Il faut peut-être ajouter une chose, c’est que cette histoire d’actions dont les prix montent, ce n’est pas du tout de la spéculation au sens habituel du terme, c’est absolument programmé par Law. Pour le comprendre, il faut juste se rappeler, sans faire de théorie bien compliquée, que le taux de l’intérêt varie en fonction inverse du cours des actions généralement. L’objectif de John Law est d’atteindre le taux d’intérêt de 2%. Donc, on sait très bien, on le sait, que quand le cours de l’action atteint 10 000 livres, eh bien Law cesse toutes les manipulations, dans le détail desquelles je ne vais pas entrer. Law a manipulé considérablement pour porter le cours des actions à 10 000 livres et quand le taux atteint 10 000 livres, Law s’arrête car son objectif est un taux d’intérêt de 2%. Je crois qu’on ne l’a pas assez remarqué ça. Cette histoire de taux d’intérêt est peut-être le talon d’Achille. Il y a sûrement une erreur dans la pensée de John Law en pensant que le taux de 2% est un bon taux. Alors, je voudrais juste ajouter une chose tout de même, c’est qu’aujourd’hui on ne sait toujours pas quel est le bon taux de l’intérêt, ni la théorie ni la pratique ne nous le disent. Donc, de ce point de vue, Law n’est ni en avance, ni en retard.
Emmanuel Laurentin : A ce propos, je voudrais signaler, j’ai commencé à le lire et c’est absolument passionnant, une petit livre paru à la Découverte, de Bruno Latour et Vincent Antonin Lépinay, sur l’économie, où ils disent que : L’économie, - c’est à propos de la pensée de Gabriel Tarde, assez peu connu encore aujourd’hui – c’est la science des intérêts passionnés. Ils disent justement qu’à chaque fois on pense que l’économie est rationnelle mais évidemment il y a la question de la mesure de la passion à l’intérieur de ces questions-là.
Joël Félix : Je suis tout à fait d’accord avec Jean Cartelier. Un article récent, que l’on peut trouver sur Internet, de François Weil, qui est un bon spécialiste, qui prépare en ce moment un livre sur Law’s, explique, comme vous le dites, que si le taux avait été à 3% peut-être que le système aurait pu être valable, si la spéculation n’était pas montée si haut.
Emmanuel Laurentin : Mais, ça veut dire qu’on a affaire à quelqu’un qui a pensé son système, en observant évidemment la réalité économique de son temps, sur le papier et ensuite il a tenté d’appliquer ce qu’il avait pensé en ne tenant pas toujours compte de la réalité de ce qui se passait sur le marché. C’est cela, Jean Cartelier ?
Jean Cartelier : Oui. On le classe quelquefois dans les mercantilistes, tous ces gens qui sont partisans d’un taux d’intérêt bas, mais Law est très conscient qu’on ne peut pas fixer un taux d’intérêt bas, ni le souverain ni personne ne peut l’édicter. La seule façon, dit-il, d’obtenir un taux d’intérêt bas, c’est d’avoir un système monétaire élastique. Et quand il crée la Banque générale puis la banque Royale, c’est vraiment dans cet esprit. Le malheur, c’est que l’élasticité de la masse monétaire n’a pas été faite pour le développement du commerce et de l’industrie, ça a été fait pour souscrire des actions de la Compagnie des Inde. C’est là que le bât blesse.
Emmanuel Laurentin : Quand tout le système s’effondre, il y a des gens qui ont retiré leurs bénéfices avant les autres. Ceux-là vont devenir riches et vont ensuite créer des fortunes qui serviront à leurs descendants. Puis, il y a ceux qui perdent tout dans cette affaire, Guy Lemarchand, et il y a tout de suite des libelles, des caricatures qui circulent dans l’Europe entière d’ailleurs contre Law. On invente, je ne sais pas si c’est par lui mais en tout cas ça date de l’époque, le terme de bulle. Il est représenté à ce moment-là comme étant une sorte d’outre pleine d’air puisqu’il a crée un système où il n’y a rien dedans d’une certaine façon, c’est comme ça qu’il est représenté par les caricatures. On invente le terme de millionnaires, à cette occasion-là aussi, puisque c’est la première fois qu’il fait son apparition dans le dictionnaire français, en 1740. Ça aura un impact, cet échec-là, à long terme sur l’économie du XVIIIe, voire du XIXe siècle, Guy Lemarchand ?
Guy Lemarchand : Je crois que l’on peut dire quand même que la base d’économie réelle de l’entreprise Law était quand même trop étroite par rapport à la masse du papier émise, par rapport à la masse du crédit. En effet, Paris pour le drainage des capitaux est quand même très inférieure à Amsterdam, Londres à la même époque. D’autre part, l’Empire colonial français est quand même faible, très limité, la Louisiane, ce n’est pas les Indes orientales, ce n’est pas les Antilles, c’est quand même finalement très peu de choses sur le plan économique. Et évidemment, l’aspect négatif, l faut attendre 1776 pour qu’une banque, un peu du même type, un grand organisme, et encore il est très limité, soit recréer en France, qui va émettre des billets, je fais allusion à la Caisse d’escompte, puis ensuite la Banque de France en 1800, auxquels, l’un et l’autre, on reprochera justement la modération, l’étroitesse de leur activité.
Emmanuel Laurentin : Chat échaudé, craint l’eau froide. Joël Félix, c’est le compatriote de Law, qui s’appelle David Diem, qui dit : « C’est le médecin qui a engendré la mort », d’une certaine façon, avec ce jugement très sévère sur son compatriote.
Joël Félix : Ce qui est certain, c’est que l’une des grandes conséquences, - et là, tout le monde est d’accord parmi les historiens- c’est qu’il y a eu la possibilité de créer une banque qui intervient sur le marché financier au XVIIIe siècle, qui diminue les taux d’intérêt, se fera sentir. Et lorsque Necker, par exemple, vers la fin du XVIIIe siècle essayera de travailler sur le marché financier, il sera aussi comparé à Law, un étranger, un protestant. Donc, là, il y a tous les aspects culturels, religieux et politiques importants.
Emmanuel Laurentin : Et qui perdurent bien au-delà de la mort de Law. Il est mort en 1728, c’est ça ?
Joël Félix : Oui.
Emmanuel Laurentin : Jean Cartelier, sur le poids de l’échec de ce modèle dans la conception que se faisaient les Français de ce que devait être une économie bancaire moderne, telle qu’elle verra le jour un peu plus tard.
Jean Cartelier : Moi, je serais assez mesuré sur ce point parce que j’ai l’impression que c’est peut-être une causalité inverse. Je crois que l’échec de Law est dû au côté peut-être retardataire des mentalités. Il ne faut pas oublier que les gens qui se sont enrichis grâce au système de Law, il y en a bien évidemment, qu’est-ce qu’ils ont fait ? Ils ont acheté des terres. Et ça sera encore ça plus tard. On aura toujours ça. En revanche, l’aspect positif de Law, qui n’a pas été assez souligné, encore qu’Edgar Faure en parle, ça a été le désendettement des agents économiques car au moment du déclin du système, beaucoup de gens qui étaient endettés ont profité de la situation pour se désendetter à bon compte. Ils ont profité de la hausse des prix qui a allégé évidemment la charge réelle de l’endettement. Et de ce point de vue, le système de Law a au moins deux aspects positifs : Un premier qui est la diminution de l’endettement et un second qui a été la familiarisation des Français avec un certain type de raisonnement économique et une certaine cupidité, il faut bien le dire.
Séverine Liatard : D’un point de vue plus global, d’un point de vue européen, qu’est-ce qu’on peutdire ? La France, par rapport à cette proposition de Law, l’Angleterre…
Joël Félix : L’Angleterre a imité le même schéma, un peu plus tard, en 1719. C’est connu sous la « South Sea bubble »…
Emmanuel Laurentin : La Bulle financière.
Joël Félix : Qui s’est effondrée. Ce qui est amusant peut-être…
Emmanuel Laurentin : Il y avait une compagnie, qui s’appelait la Compagnie des mers du Sud (South Sea Company), qui était fondé sur les mêmes principes que la Compagnie d’Occident, devenu rapidement la Compagnie du Mississippi puis Compagnie des Indes.
Joël Félix : Exactement. Les Anglais étaient très inquiets précisément du système de Law. Au début il marchait très bien en effet. Au plus haut de la crise, un correspondant Anglais, d’un banquier à Londres, lui a demandé : qu’est-ce que je fais ? Il lui a dit : Le monde est fou, il faut le suivre. Il y avait un effet d’entraînement terrible et bien évidemment, ça a eu des conséquences en Angleterre comme en France.
Emmanuel Laurentin : Alors, si on avance dans ce XVIIIe siècle, pour arriver jusqu’à la Révolution française, je voulais évoquer avec vous, - avec vous deux puisqu’on a la chance de vous avoir tous les deux - Guy Lemarchand, vous êtes l’auteur de « L’économie en France de 1770 à 1830 : de la crise de l’Ancien Régime à la révolution industrielle », chez Armand Colin et Joël Félix, vous venez d’écrire un article sur les origines financières de la Révolution française, vous pensez, vous, -évidemment sur la Révolution française on a tout écrit depuis deux siècles à peu près – qu’il y a dans la question financière une des raisons, des racines potentielle de la Révolution ?
Joël Félix : C’est même la cause directe de la Révolution, l’origine même. D’abord, il y a des guerres qui sont perdues au milieu du XVIIIe siècle…
Emmanuel Laurentin : Vous insistez beaucoup sur l’endettement dû aux guerres.
Joël Félix : Exactement. Puis la guerre d’Amérique…
Emmanuel Laurentin : Vous dites qu’il y a 22 années de guerre pour 20 années de paix. On pense effectivement généralement à Louis XIV pour les guerres mais on pense rarement à ce milieu du XVIIIe siècle.
Joël Félix : En réalité, si vous voulez, l’affaire de Law a une conséquence considérable dans les années 1720. C’est que la situation est considérablement bloquée. Il n’y a plus d’argent, plus personne ne veut prêter, c’est le discrédit, on ne peut pas faire de guerre. Donc, pendant 40 ans, il n’y aura pas de guerre. La fiscalité sera relativement faible, il y a l’essor du commerce, la démographie va mieux. Dans ce contexte là, plus les endettements, ça permet d’une certaine façon de soutenir l’économie. Mais, du point de vue financier, ça n’a pas permis à la monarchie française de développer les outils dont elle avait besoin. En 1787, lorsqu’elle se trouve face à un endettement considérable, qui n’est pas connu du public, qui est caché en général, et qu’il découvre ça, il est abasourdi. La somme est si considérable qu’on sera obligé d’appeler les états-généraux pour essayer de trouver une solution à cet endettement. Le roi perdra le contrôle de ses finances et bientôt le contrôle de son armée.
Emmanuel Laurentin : Guy Lemarchand, vous êtes d’accord avec cette interprétation ?
Guy Lemarchand : Oui, tout à fait. Il est évident que la cause immédiate de la Révolution, c’est le problème financier et l’impossibilité pour l’État, sans réforme fiscale profonde, de trouver les moyens de couvrir son énorme déficit à la suite de la guerre d’indépendance américaine. Évidemment, la Révolution ne se résume pas à cette unique cause.
Emmanuel Laurentin : On l’a bien compris.
Guy Lemarchand : 1789, c’est la coïncidence entre diverses crises. Cette crise financière, la crise de subsistance classique, la mauvaise récolte de 1788, la crise industrielle, les effets du traité de commerce de 1786 avec l’Angleterre et puis la crise politique et idéologique de remise en cause du système de monarchie absolutiste ou qui se voudrait absolutiste et qui, de plus en plus, a des difficultés pour avoir prégnance justement sur la réalité sociale et économique.
Emmanuel Laurentin : Jean Cartelier, on s’aperçoit, on avançant dans cette semaine, en discutant avec des historiens de l’économie de l’Antiquité, du Moyen-âge et maintenant de l’époque moderne, qu’il y a toujours quelque chose de commun à cette période, sans faire d’analogie, c’est la question de la relation de l’État à la société de marché, ou de pré-marché selon qu’on analyse telle ou telle société antique ou médiévale, la question de la confiance, on l’a dit, dans la structure étatique par rapport à ces biens privés qui sont généralement les banques, l’installation du marché financier. C’est une des permanences, au XVIIIe siècle, justement que cette question-là ?
Jean Cartelier : Il le semble. Enfin, je ne suis pas un historien donc je ne voudrais donc pas me lancer dans cette discussion, mais il semble bien que…
Emmanuel Laurentin : Vous êtes un spécialiste de la monnaie.
Jean Cartelier : Pour ce qui concerne la monnaie, je vais renvoyer à un ouvrage collectif, La monnaie souveraine, où nous avons longuement développé cette question de la confiance, mais pour ce qui concerne la période XVIIIe siècle et plus précisément le système de Law, clairement, la position du Régent était un élément fondamental de confiance. Que le Régent n’ait pas su lui-même ou n’ait pas pu arbitrer entre les intérêts opposés, parce que quand même il faut être très clair, c’est toujours une question d’intérêts opposés, et si l’État peut avoir cette influence c’est précisément lorsqu’il est capable d’arbitrer de façon claire entre des intérêts opposés. Je ne suis pas certain que le Régent ait eu cette capacité.
Emmanuel Laurentin : Joël Félix, cette question de la relation de l’État au marché ?
Joël Félix : C’est une question très importante évidemment. Nous sommes dans une monarchie absolue qu’on essaye un peu de limiter. Il y a deux éléments qui sont importants au XVIIIe siècle : c’est le monde du commerce, le monde du grand négoce international et puis d’autre part le monde agricole intérieur en France et ce sont deux mondes qui fonctionnent différemment. Le grand commerce se développe, il y a pas de problème, il y a des banquiers qui ne sont pas forcément les fournisseurs du gouvernement mais à partir du milieu du XVIIIe siècle ils vont prêter de l’argent. Puis, le monde intérieur, qui est celui de la terre et celui de l’impôt, et là ce sont les financiers qui utilisent l’impôt qui prêtent l’impôt au roi, qui avancent la perception de l’impôt au roi, et là il est très difficile de faire de l’argent puisqu’il y a ce problème du privilège fiscal qui fait qu’il est pratiquent impossible d’établir un système fiscal, je dirais honnête.
Emmanuel Laurentin : Le privilège de la ferme et des fermiers généraux.
Joël Félix : Exactement. Et qui paralysent dans une certaine mesure l’économie intérieur du pays.
Emmanuel Laurentin : Merci à tous d’avoir accepter de venir pour évoquer le XVIIIe siècle et plus exactement la question du système de Law. Il faut citer vos livres : « La monnaie », Jean Cartelier, chez Flammarion, collection Dominos. Guy Lemarchand, ça vient tout juste de sortir, chez Armand Colin, « L’économie en France de 1770 à 1830 ». Vous êtes auteur, Joël Félix, d’un Louis XVI, mais vous êtes également l’auteur d’un travail sur Le ministère L’Averdy, c’est au Comité d’histoire économique et financier de la France. Comité d’histoire économique et financier de la France qui a soutenu également la traduction, chez Peter Lang, d’une biographie, une réflexion, par celui ou un de ceux qui le connaissent le mieux, c’est Antoin Murphy, John Law, économiste et homme d’État, un très bon livre dans la collection Économie et histoire chez Peter Lang. Même si vous n’êtes pas toujours d’accord, Jean Cartelier, avec les interprétations qu’a Antoin Murphy sur le personnage de John Law.
Jean Cartelier : Oui, mais nous devons à Antoin Murphy pour tous les travaux sur John Law bien sûr.
Emmanuel Laurentin : Merci à tous. Et demain, nous nous arrêterons sur le XXe siècle en évoquant la crise, ben connue, de 1929.
Comme d’habitude, cette émission a été préparée par Maryvonne Abolivier et Aurélie Marsset. Le site Internet, sur lequel vous pouvez écouter notre émission, pendant un mois, la télécharger pendant une semaine, trouver des bibliographies complémentaires, est tenu par Antoine Lachand. À la technique aujourd’hui, Jean Frédérix, à la réalisation Gislaine David. Vous pouvez également nous écrire sur notre site : www.franceculture.com, rubrique : les émissions, La Fabrique de l’Histoire, réagir à cette émission ou toutes les autres. Vous pouvez nous écrire également par la poste : Pièce 6123 à la Maison de Radio France, 7520 Paris CEDEX 16, ou nous téléphoner au : 01 56 40 25 78.
Puis, je rappelle qu’une des auditrices de La Fabrique de l’histoire a désormais mis sur son site, qui s’appelle fabriquedesens.net, certaines des émissions en script, pour qu’une fois que l’on ne peut plus les écouter on puisse les trouver sur Internet. Certaines émissions, pas toutes évidemment, sont scriptées par cette auditrice que nous remercions.
.
[Des livres à découvrir et des sites à consulter, recommandés sur le site de l’émission]
– Guy Lemarchand, « L’économie en France de 1770 à 1830 : de la crise de l’Ancien Régime à la révolution industrielle », Ed. Armand Colin, 27 août 2008.
Présentation de l’éditeur : Le passage d’une économie d’Ancien Régime, encore largement dominée par l’agriculture, à une économie de type moderne se dessine en France entre 1770 et 1830. La Révolution française et l’Empire sont des étapes essentielles et décisives dans cette transformation. Au modèle aristocratique de société va se substituer un modèle fondé sur l’utilité matérielle, le travail productif et l’échange.
Cet ouvrage, à partir de nombreux exemples tirés d’études portant sur l’agriculture, le commerce et l’industrie, propose de faire le récit de l’enchaînement de ces modifications.
Divisée en quatre parties, associant la démarche chronologique et thématique, cette synthèse permet d’appréhender les structures et les pratiques économiques d’Ancien Régime et leurs modifications sous les effets de la Révolution française.
– Jean Cartelier, « La monnaie », Ed. Dominos Flammarion, 5 janvier 1996.
Présentation de l’éditeur : La théorie économique actuelle rend compte du marché par les lois de l’offre et de la demande et n’accorde à la monnaie qu’un rôle mineur. Pour Jean Cartelier, professeur de sciences économiques à l’université de Nanterre, une réflexion sur la monnaie en tant que système d’échange révèle le lien profond entre économie et société.
– Antoin E. Murphy, « John Law : économiste et homme d’État », Ed. PIE Peter Lang, 7 mars 2008.
Présentation de l’éditeur : Antoin E. Murphy nous livre ici la biographie intellectuelle d’une des personnalités les plus fascinantes de l’Europe de l’Ancien Régime, John Law (1671-1729). John Law chercha fortune à Londres, dont il s’enfuit en 1695. On le retrouve ensuite aux plus belles tables de jeu de l’Europe. Tout autre que lui se serait satisfait de cette vie de luxe et d’oisiveté, mais John Law avait une vision. Il croyait que l’économie basée sur les pièces d’or et d’argent allait irrémédiablement s’effacer devant un monde nouveau où les billets émis par les banques et les papiers de crédit seraient désormais la seule monnaie en circulation.
Cette vision, il voulut tout d’abord la partager avec le parlement écossais, sans succès. Il la proposa ensuite au duc de Savoie, puis une première fois au roi de France, en vain. La mort de ce dernier, en 1715, et la situation financière exécrable dans laquelle il laissait la France allait toutefois offrir à Law une nouvelle opportunité. Avec l’amitié et la confiance de Philippe d’Orléans, le Régent, John Law bâtit son système qui allait révolutionner son époque en créant une nouvelle monnaie et en provoquant les premiers booms et krachs boursiers en Europe.
En resituant l’homme dans le contexte de son époque, en expliquant ses théories économiques au regard de celles de notre temps, Antoin E. Murphy nous invite à redécouvrir cet auteur essentiel pour comprendre l’origine et les risques des instruments financiers modernes.
– Olivier Bleys, « Semper Augustus », Ed. Folio Gallimard, 2008 (1ère éd. 2007).
Présentation de l’éditeur : Haarlem, années 1630. Cornelis Van Deruick, un marchand de tissus veuf et sans le sou, décide de quitter la Hollande pour chercher fortune en Amérique. Il laisse ses quatre enfants à la garde de l’aîné, Wilhem, et leur assure la protection de Paulus van Bereysten, haut personnage de la ville, négociant en fleurs puissant et redouté.
La Hollande est alors la proie d’une étrange folie : la passion des tulipes. Les variétés rares atteignent des prix extravagants et font l’objet de spéculations intenses, au point d’inquiéter les autorités. Des fortunes se font et se défont en quelques heures sur ce marché volatil où un seul bulbe de Semper Augustus - une tulipe légendaire à l’éclat sans pareil - vaut autant qu’un palais. Livrés à eux-mêmes, les enfants Deruick vont affronter un monde cynique et implacable...
Basé sur un épisode historique méconnu, la « tulipomanie », où certains économistes voient une préfiguration des bulles spéculatives modernes, le roman d’Olivier Bleys restitue avec brio l’atmosphère fiévreuse des Pays-Bas de l’âge d’or. Ce récit d’une formidable vitalité est aussi un plaidoyer contre l’injustice sociale, l’asservissement des faibles par les nantis. Il se révèle alors d’une troublante actualité.
– Bruno Latour et Vincent Antonin Lépinay, « L’économie, science des intérêts passionnés : introduction à l’anthropologie économique de Gabriel Tarde », Ed. La découverte, Paris, 9 octobre 2008.
Présentation de l’éditeur : Et si la science économique avait tout mis à l’envers ? C’est la proposition que font les auteurs de ce petit livre en se situant explicitement dans la voie ouverte par Gabriel Tarde (1843-1904). Ils proposent une complète inversion de nos habitudes : rien dans l’économie n’est objectif, tout est subjectif ou, plutôt, intersubjectif. Les idées mènent le monde ; la superstructure détermine « en première et en dernière instance » les infrastructures, lesquelles, d’ailleurs, n’existent pas...
L’économie récente, celle que Tarde observe depuis sa chaire au Collège de France, celle de la lutte des classes, de la première grande globalisation, de la migration massive du genre humain, celle des innovations frénétiques ponctuées par les grandes expositions universelles, du découpage des empires coloniaux, n’offre en aucune manière le spectacle d’un avènement de la raison. Mais plutôt le spectacle de passions d’une intensité inouïe.
Qu’est-ce alors que l’économie ? C’est la science des intérêts passionnés, expliquent les auteurs. C’est cet entrecroisement, au cœur de la science économique, que les économistes ont à la fois entrevu et, chose étonnante, aussitôt fui avec horreur comme s’ils y avaient vu la tête de Gorgone.
– La crise jusqu’où ? Dossier de franceculture.com Analyses, reportages, réactions et sélection de livres et de liens au sujet de la semaine qui a bouleversé la finance mondiale. Avec aussi les explications d’Olivier Pastré sur quelques mots clés de cette crise.