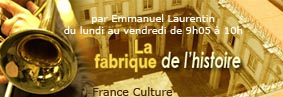Emmanuel Laurentin : Premier temps d’une semaine spéciale de La Fabrique de l’Histoire consacrée à l’imaginaire historique d’écrivains, de créateurs, d’artistes et de cinéastes contemporains. Qu’ont donc dans la tête ceux qui à un moment ou un autre de leur œuvre ont recours au passé ? Que cherchent-ils dans ce vaste réservoir de personnages et d’événements ? C’est ce que nous tenterons de comprendre, avec cinq auteurs, jusqu’à la fin de cette semaine. Demain, le metteur-en-scène de théâtre et cinéaste, Patrice Chéreau, (cf. transcription, ici) ; mercredi, le cinéaste Arnaud Desplechin ; jeudi l’auteur de bande dessinée, Jacques Tardi et vendredi, le peintre, Bernard Rancillac. Et aujourd’hui, me direz-vous ? Eh bien, l’écrivain Pierre Guyotat, va nous parler de ce passé dans lequel en tant « fictionneur », comme il se qualifie, il va chercher personnages et situations. Il va nous parler d’empires et de conquérants, de Michelet et de vies des saints, de la France et de sa langue. Pendant une heure, donc, l’auteur de Tombeau pour cinq cent mille soldats, de Coma et de Vivre, et très récemment de Formation, chez Gallimard, Formation dans lequel il raconte et tente de restitue le climat dans lequel il a grandi, dans les années 40 et 50, et constitué son savoir historique. Eh bien, Pierre Guyotat va nous raconter pendant une heure son passé, son passé rêvé, ses références en histoire, dans une réalisation de Marie-Christine Clauzet.
Pierre Guyotat : Je dois avoir eu, très tôt, un esprit, comme dirais-je, de « fictionneur », si je puis dire. Donc, l’histoire est très vite, pour moi, mélangée avec ce qui fait la force de la fiction, la fiction dans les grands romans etc. et c’est pour ça que tous les personnages d’histoire m’intéressent, parce que je les vois comme des êtres humains, les personnages de fiction, ce qui fait qu’il y a peu d’individus, de grands personnages historiques, que j’ai abandonnés après. Parce qu’ils m’intéressent toujours, différemment, disons, leurs actions. Lénine, par exemple, c’est évident que c’est l’action, mais le personnage reste de toute façon extrêmement intéressant. On n’en a pas fini avec ce personnage. Le mélange de cette simplicité, quasiment petite bourgeoise, et puis cette énergie, cette conviction, cette énergie ahurissante, c’est tout de même très impressionnant. Et c’est toujours, très habilement, un peu comme Robespierre mais plus que Robespierre encore, il s’est mis toujours en retrait de l’histoire, c’est-à-dire de l’action, du massacre, de l’emprisonnement, de la terreur, de tout ça. « Ne me parlez pas de ce qui se passe », c’est ce qu’il disait, Lénine. Il faut aussi beaucoup d’énergie pour vivre un truc pareil. Oui, il faut essayer de voir les gens par le haut, comme on dit, aujourd’hui. Le bas, oui, bien sûr, mais moi, c’est absolument condamnable, bien entendu, les méthodes sont atroces etc. mais le personnage c’est un être humain. Il reste un être humain.
Emmanuel Laurentin : Cette gourmandise que vous avez, dès votre enfance, Pierre Guyotat, pour l’histoire, pour le passé, pour les personnages qui la peuplent, vous l’exercez au hasard de vos lectures, ou est-ce que qu’il y a quelque chose de systématique ? Vous découvrirez, dites-vous, avec le latin par exemple progressivement l’histoire de l’Empire romain, c’est ce que vous expliquez dans Formation, mais est-ce que vous défrichez un territoire et une fois que vous avez défriché ce territoire historique, ce territoire géographique, ce territoire du passé, vous passez à un autre ? Comment ça se passe ? Ou est-ce que c’est un peu au hasard des lectures ?
Pierre Guyotat : Tout à fait au hasard des lectures. C’est lier à mon travail aussi. Si j’ai besoin de savoir des choses sur la mise en psychose etc., je vais évidemment relire des livres sur l’Inde ou sur…, bien entendu. Quand j’étais adolescent, quand j’ai commencé à aimer la musique, en dehors de ma mère, si je puis dire, je me suis intéressé aux périodes où naissent les musiciens. Pour moi, il n’y a pas l’histoire, si vous voulez. L’histoire est un élément, ou peut-être l’élément qui rassemble le tout, mais c’est l’art, les mœurs, les vêtements, la nourriture, les lieux – très importants les lieux…
Emmanuel Laurentin : Ce qu’on appelle l’histoire totale.
Pierre Guyotat : Oui. C’est absolument lier. Quand je prends un musicien comme Robert Schumann, je prends toute la période et l’Allemagne avec. Il n’est pas isolé, comme on essaye de beaucoup isoler aujourd’hui.
Emmanuel Laurentin : Ce n’est pas le génie qui viendrait comme cela au milieu de nul part qui vous intéresse, c’est effectivement la personne qui grandit dans un milieu et qui raconte aussi l’histoire qui l’a précédée.
Pierre Guyotat : Je ne suis pas non plus marxiste au point de penser qu’untel est le produit de, non. D’abord, untel n’est pas le produit. Moi, j’ai une vision, vous l’avez bien vue, un peu plus, comme dirais-je, métaphysique, mythologique, disons. Cette idée que l’homme est un produit, la production de je ne sais quoi, non. C’est faux. Il faut essayer d’imaginer les choses, je le fais tout le temps, je le fais depuis que je suis enfant, mettre une image sur des mots abstraits. Qu’est-ce que c’est qu’un produit ? Un produit, c’est une production. C’est quelque chose qui sort de quelque chose, peut-être, la terre produit des tas de trucs, ou la production d’une boîte de conserve, ou un appareil, un objet, comme ce lapin mécanique que l’on m’a rapporté de Chine - il n’est pas très mécanique du reste-, voilà un produit. Mais imaginer que l’homme est une de ces images-là c’est impensable, ce n’est pas possible.
Emmanuel Laurentin : Cette histoire que vous racontez dans Formation, que vous dites qu’elle est, par exemple, votre histoire mais il faut s’imaginer l’histoire d’avant soi-même, c’est-à-dire de sa famille, de sa mère, de ceux qui vous ont précédés aussi, et d’une certaine façon s’inscrire dans une lignée et s’imaginer comme un maillon d’une sorte de chaîne qui se poursuivra après vous, d’une certaine façon.
Pierre Guyotat : Oui. Je reste sur cette sensation-là si j’avais moi-même des enfants mais je n’en ai pas, hélas mais c’est comme ça. Oui, j’ai cette sensation-là, bien entendu. Bien sûr que je suis un maillon de la chaîne mais moi, je n’ai jamais voulu tellement me considérer comme un maillon de la chaîne à vrai dire, depuis enfant. Parce que je le dis, là aussi, un maillon de la chaîne c’est quelque chose qui n’est pas très éloigné de l’homme produit de…
Emmanuel Laurentin : Mécanique.
Pierre Guyotat : Non, non, moi, je suis né et j’ai grandit avec cette idée que c’est Dieu qui vous programme - là aussi un mot horrible – et après qui vous suit, en quelque sorte. Après on s’aperçoit que ce n’est pas forcément Dieu, que c’est une conscience très, très forte, très affirmée, une conscience au sens hégélien du terme, qui est là. Cette conscience, c’est vous. Et alors, ça pose la question morale, le sens moral d’où me vient-il ? Parce qu’au fond, les parents ce n’est pas suffisant. C’est très nécessaire, le sens moral. Ce qui est bien, ce qui n’est pas bien, ce qui laid, ce qui est beau, ça aussi c’est important. Dans le sens moral, il y a tout ça. Donc, ça vient. D’où ça vient ?
Emmanuel Laurentin : Justement, cette histoire telle qu’on vous l’a racontée quand vous étiez enfant, Pierre Guyotat, avait aussi pour mission de donner un sens moral aux événements du passé, c’est-à-dire de montrer ce qui était bien, ce qui n’était pas bien, ce qu’il fallait faire, ce qu’il ne fallait pas faire, de servir d’exemple pour certains des personnages du passé, d’autres qui servaient de repoussoir, ça participait à cette création d’un sens moral.
Pierre Guyotat : Moi, j’ai toujours été attiré, même quand j’étais enfant, en bon chrétien, et allais plus facilement vers les réprouvés, si vous voulez, que vers ceux qui étaient parés de toutes les qualités.
Emmanuel Laurentin : Les figures de la sainteté…
Pierre Guyotat : Si, les figures de la sainteté, c’est autre chose. Les figures de la sainteté c’est des gens qui sont au bord, quand même, ils sont entre les deux, il faut grandir beaucoup pour le ressentir. Un martyre, un grand saint, c’est quelqu’un qui est au bord de l’enfer quand même, au bord de l’orgueil d’une certaine façon, au bord de l’orgueil de soi-même. Moi, j’allais beaucoup vers ces gens-là. J’ai assez vite saisi l’ambigüité de la sainteté, le sentiment de sainteté pour le saint. Donc, moi, voilà, le mouvement vers ceux qu’on rejette, par exemple. Richard III, c’est une pièce qui m’a hanté quand j’étais adolescent. Je dois dire que ma sympathie allait plutôt vers Richard III. J’ai horreur de tout ce qui s’apparente à du lynchage.
Emmanuel Laurentin : J’ai apporté avec moi La légende dorée de Jacques De Voragine, avec un extrait du martyre de Sainte Catherine. « Alors un préfet conseilla au roi furieux de faire préparer, dans les trois jours, 4 roues entourées de scies de fer et de clous très pointus, en sorte que ce terrible supplice découpe la vierge et que l’exemple de cette mort atroce effraye les autres chrétiens. » Dans ces lectures d’enfance ou d’adolescence, Pierre Guyotat, il y a aussi cette vision de la sainteté, du martyre qui vous poursuit dans votre œuvre, qui est toujours présente dans votre œuvre. Ce martyre par le sang, par le massacre, ces massacres organisés, pourrait-on dire, et qui sont légitimés par cette histoire sainte parce que tout compte fait on voit des horreurs parce que justement ces saints ont péris sous le glaive des empereurs en particulier.
Pierre Guyotat : Oui, mais je ne suis plus très sensible à cette question des martyres.
Emmanuel Laurentin : Mais, vous l’avez été, sensible à la question des martyres ?
Pierre Guyotat : Oui, beaucoup, énormément, bien sûr. Tout enfant normalement constitué à l’époque, vivant dans un pensionnat religieux avec des prêtres ( ?) bien, n’avait qu’une envie, c’était de mourir martyre, parce qu’un enfant n’a pas le sens de la mort. Il peut avoir le sens de la douleur mais le fait d’être martyre dans l’arène, par exemple, l’éclat, c’est tellement plus fort pour un enfant que la souffrance, que les crocs des lions. Le fait d’être là désigné comme témoins d’une foi c’est absolument extraordinaire. Le récit des martyres, c’était dans les textes aussi. C’était dans les textes à traduire. Non seulement on lisait mais on traduisait le texte qui racontait l’horreur, qui racontait le supplice ou le massacre, etc. La traduction joue un rôle considérable, pour ceux qui ont fait du latin et du grec. Évidemment.
Emmanuel Laurentin : Sans compter, Pierre Guyotat, qu’il y a chez vous cette particularité de grandir dans une famille dont la plupart des membres ont participé, sinon la totalité des membres, à la Résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale : Un de vos oncles est mort aux camps, une de vos tantes est revenue extrêmement affaiblie par son séjour en camp, et que le jeune enfant que vous êtes, vous avez 4 ou 5 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la sortie de la guerre peut faire la relation entre ses lectures et mélange parfois d’ailleurs ses lectures et ses références historiques avec le véritable martyre qu’ont vécu certains de votre famille à un certain moment j’imagine.
Pierre Guyotat : Tout à fait. Il faut dire une chose sur la Résistance qui est un petit peu oubliée. Enfin, ce n’est pas la Résistance qui est oubliée, c’est ça qui est oublié, c’est-à-dire qu’à cette époque où il faut tout mettre sous les projecteurs : les individualités, pour ce qu’ils ont fait, ce qu’untel a fait, ce qu’untel n’a pas fait mais voudra faire, etc. On oubli une chose c’est que les Résistants se sont engagés non pas seulement comme on le croit pour qu’on puisse dire après, c’est un peu nos chers intellectuels qui disaient ça : « prendre date », moi aussi j’étais comme ça, pour qu’on puisse après dire : « il a signé ça, il n’a pas signé ça ». Ce n’était pas du tout ça, eux., ils voulaient tout simplement chasser l’Allemand, chasser le nazi. Ils s’inscrivaient dans une logique militaire de Résistance. Ce n’était pas pour témoigner. Ils ne savaient pas du tout ce que le monde serait après. C’était un engagement individuel pour une action collective. Qu’est-ce qu’on est naïfs aujourd’hui à penser… Alors évidemment il y a l’exemple de de Gaulle, l’homme qui dit non tout seul, nous dit-on. Attention, il n’était évidemment pas tout seul, l’homme qui dit « Non », toutes ces fadaises, etc. On ne se pose même pas la question de savoir si par exemple il n’était pas possible que de Gaulle aille ailleurs qu’à Londres. Il y avait des endroits du territoire français qui étaient encore libres. On pouvait aussi s’installer sur une montagne ou sur un pic, je ne sais pas, pourquoi pas dans des grottes, dans les Pyrénées. Il faut se poser toutes ces questions-là aussi, ne pas accepter, même si c’est magnifique bien sûr de Gaulle, ce n’est pas moi qui avait mettre en question quoi ce soit, mais il faut se poser des questions et surtout cette idée que la Résistance c’est vraiment pour aider les autres, aider les alliés, s’aider soi-même à chasser les gens qui sont là. C’est très simple.
Emmanuel Laurentin : Cette expérience que vous avez du retour des camps de votre tante, du combat de la Résistance, du fait que votre oncle meurt dans un des ces camps, vous conduit à penser, Pierre Guyotat, comme vous l’écrivez dans Formation, que l’histoire est comme une alternance d’asservissement et de délivrance, c’est-à-dire une sorte de respiration qui passe de l’un à l’autre, un moment de délivrance, puis une nouvelle alternance provoquera un nouvel asservissement.
Pierre Guyotat : On le sent bien quand on est enfant, ça. On a des moments d’extraordinaire libération, de délivrance et des moments d’extraordinaire assujettissement, et au fond c’est ça qu’on vit toute la vie.
Emmanuel Laurentin : Il y a un personnage dont on n’a pas parlé encore, qui est un personnage fondamental dans votre formation intellectuelle, et qui revient tout le temps, c’est un mot, un mot de France. La France, comme personnage, comme figure, comme chez Michelet, par exemple. La France, comme personne ?
Pierre Guyotat : Oui, la France est importante pour moi, bien sûr. Parce que je trouve que c’est une histoire politique absolument extraordinaire. Peut de pays de cet âge-là, qui aient une histoire pareille, qui soit d’une richesse pareille. Quand on connaît l’histoire des autres pays, c’est évident.
Emmanuel Laurentin : Vous avez grandi en lisant l’histoire de France…
Pierre Guyotat : C’est évident, je ne vais tout de même pas renier ce pays, qui est le pays qui a secrété, si je puis dire, petit à petit, cette langue dont je me sers, dont nous nous servons tous. C’est tout de même étrange de la part d’écrivains d’un certain intérêt aujourd’hui, ce rejet de la France. La langue a été secrétée par les Français, des Français de toutes classes, toutes classes confondues. Donc, il faut quand même y penser à ça.
Emmanuel Laurentin : Et cette France dont vous parlez, vous en avait toujours parlée, selon les mêmes termes ? Lorsque vous étiez enfant, adolescent, jeune adulte, maintenant, c’est la même France que vous portez à chaque fois avec vous ? Ou, est-ce qu’elle a subi, sous les aléas de l’histoire, la Guerre d’Algérie que vous avez vécue, ou d’autres moments comme cela, des altérations, des disparitions comme un astre qui subirait une éclipse ?
Pierre Guyotat : Bien sûr. Oui, bien sûr. J’ai eu un moment très long qui correspondait au moment où j’étais en Algérie, pendant la Guerre d’Algérie, on ne pouvait que détester son pays. Je l’ai expliqué dans d’autres textes, le dégoût de la langue. La langue que j’avais entendue, ça fait un drôle d’effet quand vous entendez votre langue maternelle utilisée à des fins, même d’ordre déjà. Quand vous entrez à l’armée et qu’on vous donne des ordres dans cette langue, c’est très extraordinaire. Cette langue qui n’est pas du tout faite, assez peu faite, pour ce genre d’injonctions. C’est important la langue qu’on entend. Ce n’est pas un dévoiement, c’est cette langue-là, et quand la langue est criée et qu’elle est déformée, comme elle l’était autant par les appelés que par les officiers, qu’elle devenait en quelque sorte utilitaire, utilitaire guerrière, c’est horrible.
Emmanuel Laurentin : Mais il y a d’autres exemples, qui sont antérieurs, pendant lesquels cette langue a été utilitaire, c’est l’esclavage par exemple…
Pierre Guyotat : Je ne la connais pas cette langue puisqu’il n’y avait pas d’enregistrements. On peut l’imaginer. C’est vrai qu’il faut imaginer la parole, l’accent des gens de l’époque, l’accent de Louis XIV, par exemple, l’accent de Bossuet, prononçant ses…, l’accent de Louis XVI prononçant son discours à l’Hôtel de Ville en 89, je crois, le premier discours non préparé, ou d’autres.
Emmanuel Laurentin : Il faut imaginer Simon Montfort à Béziers devant l’armée…
Pierre Guyotat : Comment, par exemple, cette fameuse phrase de l’évêque, Foulques, dans le Nord, je crois, « Tuez-les tous, dieux reconnaîtra les siens ». A l’époque il faut déjà rétablir le très ancien français, imaginer l’accent… justement en Algérie, j’avais ça.
Emmanuel Laurentin : En direct.
Pierre Guyotat : Oui, j’avais ça en direct. J’avais l’accent, le ton de Galliffet, par exemple, le général Galliffet commandant les massacreurs des Communards, par exemple.
Emmanuel Laurentin : Ou de Saint Arnaud…
Pierre Guyotat : Ou de Saint Arnaud, par exemple, en Algérie, voilà. Mais ce n’est pas beau. La langue est très laide quand elle est utilisée pour un ordre militaire. L’histoire ça s’imagine beaucoup plus que ça ne se lit. Il faut imaginer que jusqu’à l’électricité, tout se fait aux chandelles. Et avant le gaz même, tout se fait aux chandelles, au flambeau, à la bougie. Tous les grands textes s’écrivent à la bougie. Les peintres peut être non, ils travaillent le jour mais peut-être que Rembrandt le soir… Vous imaginez ça. Les traités, toutes ces choses qu’on imagine en pleine lumière dans la nuit des temps, comme on dit, c’est vraiment dans la nuit avec très peu d’éclairage. Il y avait très, très peu d’éclairage quand même. Il faut penser au très peu d’éclairage qu’il y avait dans les fermes. Il faut imaginer les odeurs aussi. L’odeur, ce n’est pas des périodes où l’on se lavait beaucoup quand même. Il y avait beaucoup de parfums, beaucoup d’ingrédients. C’est un monde qui sentait beaucoup plus fort que maintenant, à tout point de vue, pas seulement les gens…
Emmanuel Laurentin : Les fumées des viandes…
Pierre Guyotat : Il faut imaginer le XVIe siècle, un siècle de violence, d’extrême violence et d’extrême grandeur littéraire, artistique, musicale phénoménale. La deuxième moitié du XVIe siècle, c’est un moment terrible, vous imaginez ces gens se battant sans arrêt, suant, puant. On le sait pour Henri IV, mais il faut l’imaginer pour tout le monde. Donc, il y avait le peu de lumière, pas forcément la puanteur mais la senteur, les champs sentent beaucoup plus, les villes sentent beaucoup plus, les appartements sentent beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de bois. Ça sent beaucoup. C’est ça l’histoire, il faut imaginer ça, comme ça.
Emmanuel Laurentin : On a l’impression qu’il y a une véritable gourmandise dans ce voyage dans le temps que vous faites. Un voyage qui mélange d’ailleurs l’espace et le temps parce que, comme toujours en France, on ne sépare pas l’histoire de la géographie…
Pierre Guyotat : Heureusement. Parce que ça va de soi. Oui, Montesquieu etc. Renardez 40, 1940, la débâcle française s’explique beaucoup par toutes sortes de choses, l’impéritie de l’État-major etc. mais il y a aussi le fait que l’Angleterre est séparée du continent. Ça compte énormément encore à l’époque. Ça compte toujours du reste. Et ça comptera toujours. Il y a des obstacles naturels qui comptent toujours.
Emmanuel Laurentin : C’est Hannibal passant les Alpes ?
Pierre Guyotat : Une grande partie de l’histoire, l’histoire militaire en tous les cas, et même tout simplement de l’histoire, c’est non seulement le climat mais la géographie, bien entendu. Ce qui fait que l’on peut quand même émettre quelques doutes sur la capacité par exemple des Etats-Unis à mettre l’Iran au pas. C’est très loin quand même. Ça reste très loin.
Emmanuel Laurentin : Vous êtes un enfant de cette fusion de l’espace et du temps qui est issue justement de cette vision historique qui fait que Michelet fait un tableau de la France, en même temps qu’il fait l’histoire de France, et l’ouverture de la grande Histoire de France de Lavisse, c’est Vidal de la Blache, avec le tableau de la France de Vidal de la Blache, donc c’est ce mélange de…
Pierre Guyotat : Mais Michelet avait un très grand sens de la géographie. On le voit dans ce tableau de la France, admirable texte du début mais en même temps dans toute l’œuvre.
Emmanuel Laurentin : Je vous lis un extrait justement de ce tableau de la France de Michelet : « Les fils d’Eléonore, - Aliénor, donc - Henri, Richard-Cœur –de-Lion et Jean ne surent jamais s’ils étaient Poitevins ou Anglais, Angevins ou Normands. Cette lutte intérieure de deux natures contradictoires se représenta dans leur vie mobile et orageuse. Henri III, fils de Jean, fit gouverner par les Poitevins ; on sait quelles guerres civiles il en coûta à l’Angleterre. Une fois réuni à la monarchie, le Poitou du marais et de la plaine se laissa aller au mouvement général de la France. Fontenai fournit de grandes listes, les Tiraqueau, les Besly, les Brissons. La noblesse du Poitou donna forces courtisans habiles (Thouars, Mortemar, Meilleraie, Mauléon). Le plus grand politique et l’écrivain le plus populaire de France, appartiennent au Poitou oriental : Richelieu et Voltaire ; ce dernier, né à Paris, était d’une famille de Parthenai. ».
Pierre Guyotat : Oui, c’est un passage célèbre. Il va peut-être un peu loin. On est souvent tenté, bien sûr. Il y a presque un côté journaliste dans cette chose-là…
Emmanuel Laurentin : Ramasser comme cela dans un grand espace, les grands hommes pour pouvoir…
Pierre Guyotat : Vous savez, Michelet a beaucoup voyagé. Du reste, la vie de Michelet est extraordinaire. Non seulement l’œuvre est magnifique mais l’homme est extraordinaire. Il était un peu barbant, je crois, d’après ce qu’on sait des réceptions, des dîners qu’il donnait chez lui, qui étaient d’un ennuie terrible paraît-il, mais bon, je ne sais pas. Mais c’est un homme qui voyageait tout le temps, qui a passé les frontières, qui a escaladé des montagnes, qui a passé des fleuves et tout, tout le temps, en diligence, en calèche, avec tout le monde, en bateau, en coche d’eau et puis en train. Il a pris le train. On revient dans le journal, c’est formidable. Il voyage sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il va dans les lieux, non seulement pour voir les lieux mais pour voir les archives du lieu.
Emmanuel Laurentin : On l’impression que vous, vous voyagez dans l’espace mais que vous voyagez beaucoup dans le temps, que ça vous sert aussi de véhicule justement que de repartir dans le passé, d’en revenir, d’en ramener quelque chose.
Pierre Guyotat : Pour moi, c’est une habitude. C’est peut-être pour ça que j’ai aimé l’histoire très tôt. C’est une habitude de romancier, j’ai horreur du terme, disons d’un « fictionneur ». Un « fictionneur » est obligé de tenir compte, pour faire avancer l’action, de tout : d’où on vient, où on va, qu’est-ce qu’il y a à droite, à gauche, devant, au-dessus, dessous, qu’est-ce que ça sent, quelle lumière etc. Donc, l’imagination de l’histoire est tout à fait logique. C’est pour ça que tous les personnages de l’histoire me sont proches, pour les personnages de l’histoire. Certains sont trop monstrueux, toute une vie d’homme ne suffirait pas pour essayer de comprendre le pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire.
Emmanuel Laurentin : Lesquels, par exemple ?
Pierre Guyotat : Staline, Hitler, il faut plus qu’une vie pour saisir le pourquoi et le comment. Ce qui est phénoménal, quand même, c’est la capacité… alors on dit que c’est le manque de scrupule, l’absence de morale mais c’est un mot faible. Comment quelqu’un peut-il tenir autant de temps, avec autant d’énergie ? Alors, évidemment avec Hitler on sait que les moments terrifiants, les moments de terreur, de dégoût etc. mais ce n’est pas forcément de dégoût de lui-même. On ne le sait pas ça aussi. Comment un cerveau humain peut-il tenir un pareil déchet moral ? C’est extraordinaire. Staline, c’est pareil.
Emmanuel Laurentin : Et vous n’avez pas trouvé la solution, encore ?
Pierre Guyotat : Moi, si vous voulez, étant donné que je fais de la fiction, depuis très longtemps quand même, depuis maintenant bientôt 50 ans, rien ne m’étonne si vous voulez. Mais ce que je n’arrive pas à saisir, c’est que le fameux réflexe moral, dont je vous parlais au début, là, ne joue pas. C’est un mystère.
Emmanuel Laurentin : Ce n’est pas le seul cas.
Pierre Guyotat : Ce n’est pas le seul cas, bien sûr. Mao Tse Tung, c’est quand même pas mal non plus, et tant d’autres !
Emmanuel Laurentin : Oui, parce que vous prenez des exemples du XXe siècle mais on pourrait prendre des exemples dans les siècles passés, j’imagine ?
Pierre Guyotat : Oui, oui. Sauf que dans les siècles passés, il y avait moins de monde si je puis dire, moins de possibilités de massacrer beaucoup de monde, il y en avait beaucoup hein, ou alors c’était les Mongols dont la rapidité permettait les massacres en longueur et en largeur, si je puis dire. Et puis, chez eux, c’était une nature, ils expliquaient ça. Les Empereurs romains, les Empereurs hindous, indiens qui sont des terreurs, les Empereurs musulmans et persiques qui terrorisent des États entiers pendant des dizaines et des dizaines d’années, sur quoi du reste les musulmans devraient du reste se tourner. Il faut se retourner enfin vers leurs propres turpitudes. Des turpitudes commises au nom de leur religion, ça serait salutaire.
Emmanuel Laurentin : Dans votre travail, vous avez longtemps considéré qu’une des choses les plus abominables que l’humanité ait pu créer, c’est la question de l’esclavage. Bien évidemment l’esclavage aussi bien sous l’Empire romain, l’esclavage tel qu’il s’est développé avec la traite atlantique, par exemple, mais cette question de l’esclavage qui redevient d’actualité aujourd’hui, qui se réchauffe alors qu’en pensait qu’elle était derrière nous, historiquement parlant, n’empêcherait pas , selon vous, les peuples d’Afrique, ou les peuples musulmans qui ont pratiqué aussi l’esclavage d’y réfléchir aussi. C’est-à-dire de ne pas toujours renvoyer à l’Europe occidentale la responsabilité.
Pierre Guyotat : Moi, depuis longtemps, je pense qu’il faut même que les jeunes ici, issus, comme on dit, de l’immigration etc. se tournent, s’ils veulent se tourner, s’ils veulent se trouver, comme on dit maintenant, des racines ou des appuis, ils devraient se tourner maintenant, si je puis dire, d’une façon plus héroïque au fond sur leur passée. C’est ce que j’ai écrit et toujours dit, à savoir que les peuples colonisés ont résisté d’abord. Ils ont résisté très fortement. L’Algérie, c’est quelque chose d’incroyable quand même. Ça a duré très longtemps. Et aussi les peuples noirs. Au Dahomey, tout ça, moi, j’ai appris ça. A l’école on apprenait la résistance de Béhanzin, par exemple.
Emmanuel Laurentin : Ou à Madagascar.
Pierre Guyotat : A Madagascar… mais ça je le savais depuis très longtemps. Aujourd’hui on fait comme si on ne savait pas. La torture en Algérie, on ne savait pas… Il y a des gens qui ont perdu leur travail à l’époque, il y a des journaux qui étaient caviardés sans arrêt parce qu’il faisait état de la torture, à l’époque où ça se faisait. Je pense que ce n’est pas spécifiquement français, mais c’est insupportable pour quelqu’un qui a vécu un certain nombre d’années perpétuellement dans le discours : « c’est la première fois », « il aura fallu attendre 60 ans », « il aura fallu attendre 100 ans », « il aura fallu attendre 200 ans », comme si cela n’avait pas été déjà fait par les générations antérieures dont certains éléments l’ont oublié, moi je n’oublie pas. Donc, cette question-là, tous ces jeunes il faut que tous ces jeunes se retournent vers un passé plutôt glorieux et aussi un passé moins glorieux.
Emmanuel Laurentin : Et l’assumer.
Pierre Guyotat : Et l’assumer. Il faut que ça finisse par s’équilibrer, si vous voulez. Que la connaissance de leur passé propre, à savoir la résistance des acteurs et aussi les turpitudes, la complexité dans l’esclavage, complicité incluant des masses, l’Est africain c’est effarant et c’est resté très longtemps et ça reste d’une certaine façon. Donc, il faudrait peut-être un petit peu en rabattre là-dessus aussi. L’Est est très coupable aussi, très coupable. De l’autre côté c’est monstrueux parce que l’enseignement chrétien interdit absolument, totalement ce genre de pratiques. Non seulement ce genre de pratiques mais ce n’est même pas envisageable. L’être humain est un être humain absolument irremplaçable, on ne le vend pas. De l’autre côté, ce n’est pas aussi net. Enfin, le registre scandale pour nous est plus fort mais il ne faut pas non plus que par orgueil encore on revendique la part la plus maudite en occident.
Emmanuel Laurentin : Parce que vous sentez une sorte d’orgueil dans cette façon de se battre la coulpe ?
Pierre Guyotat : Je n’ai pas fini, tout à l’heure, quand je parlais de l’Algérie, la langue etc. Là, j’ai détesté la France vraiment pendant des années, des années et des années. Mais c’était la période où on était presque tous tiers-mondistes, où il n’y avait pas de pays, plus de pays, plus de patrie. Il y avait un vaste univers, c’était une vie universelle dont il faut regretter qu’elle n’existe vraiment plus, parce qu’effectivement c’était possible encore à l’époque, le monde qui est maintenant solide sur ses pieds, la Chine, l’Inde, le Brésil et même les pays arabes sortaient de la colonisation, étaient fragilisés, l’occidentale avait encore la main sur l’épaule du tiers-mondisé. Là, c’est fini. On ne peut plus. Le monde est fragmenté parce qu’il y a des puissances.
Emmanuel Laurentin : Ce qui est étonnant, quand on vous lit, quand on lit votre œuvre avec un peu de précision, c’est que la Chine ne vous est pas étrangère, l’Inde ne vous est pas étrangère, l’histoire de l’Afrique-du-sud, de la guerre des grands bourgs non plus, des grands empires africains non plus, peut-être, je ne sais pas, l’Amérique des Incas ou des Aztèques, il y a toujours quelque chose à prendre dans cet espace géographique infinie qu’est le monde et dans cette profondeur historique de cet espace géographique pour vous, Pierre Guyotat.
Pierre Guyotat : Oui, avec une constante que j’ajoute, qui est très importante quand même, chez moi, c’est la constante animale. Pour moi, l’animal, c’est l’être témoin aussi. C’est une possibilité de mesurer aussi, de mesurer l’histoire, de mesurer l’homme, aussi. L’animal même le plus petit, le plus microscopique, vous savez le papillon, les mouches, les cancrelats, les capricornes…
Emmanuel Laurentin : Et de ces migrations animales qui accompagnent l’homme, du rat qui conquière petit à petit la planète, des souris, des musaraignes et de tout cela.
Pierre Guyotat : Puis, il y a aussi le végétal. Les arbres, par exemple, les arbres témoins. Nous, on faisait, pendant les vacances, toujours une promenade à l’arbre d’Henri IV qui était dans la montagne, dans un petit village, très joli, qui s’appelle Burdigne. Un petit peu à l’écart du village, près d’un lavoir, il y avait un chêne, complètement biscornu, assez malade, et c’est un chêne qui datait d’Henri IV. Ce qui ne voulait pas dire qu’il ne datait pas d’avant. C’était très important, pour un enfant, pour mesurer l’histoire. On tournait autour de cet arbre et évidemment on ne découpait pas son écorce comme on découpait celle des autres, plus jeunes, pour faire des bateaux qui naviguaient sur des mers etc. Là, c’est un arbre qu’on respectait. On tournait autour, peut-être même avec l’idée d’entendre quelque chose, comme une conque, se mettre dans l’arbre, parce que c’est un arbre creux, pour entendre quelque chose de l’histoire, comme on met une conque à son oreille.
Emmanuel Laurentin : On parlait de la France toute à l’heure, Pierre Guyotat. Vous dites dans Formation, cette phrase très courte mais très belle : « La France, c’est d’abord le mot France, une lumière, un lien, ceux qui n’ont rien en ce monde, ni bien, ni passé archivé, ni considération publique, ont ce bien là, commun aux obscures comme aux illustres. » Là, vous vous mettez dans la lignée de Michelet, d’une certaine façon.
Pierre Guyotat : Je ne sais, mais en tout cas c’est vrai. C’est vrai, parce que je l’ai constaté.
Emmanuel Laurentin : Le mot France suffit ?
Pierre Guyotat : Le mot France, l’appartenance, le mot France suffit, oui. Regardez les gens, on a même l’impression aujourd’hui que ce sont les français les plus modestes qui rappellent aux politiques que la France existe, ou qu’elle a existé en tout cas, qu’elle existe.
Emmanuel Laurentin : Et qu’elle est porteuse d’une histoire.
Pierre Guyotat : Beaucoup plus que ce qu’on appelle l’élite qui est beaucoup plus occupée à l’anéantir d’une certaine façon, soit pour de bonnes raisons soit pour de très mauvaises. Vous savez, c’est une figure, c’est même une rhétorique, c’est un genre littéraire depuis, je pense, Montesquieu. Depuis que Montesquieu a fait son éloge de l’Angleterre, une Angleterre très imaginaire elle aussi, c’est fini, toute l’intellectualité française, sauf au XIXe où curieusement avec Hugo, Michelet et quelques autres peut-être dans l’élan encore napoléonien, on cesse ce dénigrement, mais ça n’a pas cessé tout le long du XVIIIe, et ça a beaucoup repris ces dernières années. Ça a repris beaucoup avant la guerre. L’extrême droite était absolument occupée à ça, à dénigrer ce pays qu’elle voulait par ailleurs mettre en péril. On a vu le peu de courage qu’elle a quand il était attaqué par la monstruosité en plus.
Emmanuel Laurentin : Ce qui est intéressant, c’est que c’est le même Pierre Guyotat qui, dans les années 60 justement critique cette même France pour ce qu’elle dit, déteste cette France et qui aujourd’hui dit que la France est une lumière…
Pierre Guyotat : Non, non, attention, je ne le dis pas. Là, c’est l’enfant qui le dit. Je l’ai bien expliqué au départ. Alors si l’enfant a duré, je n’en sais rien.
Emmanuel Laurentin : Mais est-ce qu’il a duré justement ?
Pierre Guyotat : C’est possible, oui. C’est vague, une lumière, mais c’est une chose indéniable. J’en ai simplement après ceux qui font comme si ce pays avait existé de tout temps, comme si c’était une marque de fabrique. Moi, j’ai conscience que c’est une longue, très longue histoire impliquant des gens très modestes et pas seulement les rois. Les rois ce sont appuyés sur quoi ? Les rois, surtout au Moyen-âge se sont beaucoup plus appuyés qu’on ne le croit sur le peuple, beaucoup plus appuyés que dans la République qui elle plutôt les a convaincus qu’il fallait aller se battre en 14-18, par exemple. Extraordinaire scandale 14-18 quand même. Une République qui décrète la mobilisation. Décrète, qui a décrété la mobilisation générale ? Est-ce que le peuple a été appelé à donner son avis ? Est-ce qu’il y a eu des élections ? Rien, rien du tout. Ça a été décidé et on a envoyé des gens se faire tuer, pendant 4 ans quand même, dans des conditions atroces, épouvantables. Si les gens résistaient, ils étaient fusillés quand même. Il ne faut pas l’oublier. La conscription, moi, j’ai connu cela en Algérie. C’était très violent aussi. Si vous ne rejoignez pas votre corps, vous étiez pourchassé, poursuivi. C’est une chose qui est oubliée dans tout le discours lignifiant sur la Guerre d’Algérie aujourd’hui. On était considéré comme déserteur et tout à fait tuable. C’est un problème tout de même. Et on se posera de plus en plus cette question-là.
Emmanuel Laurentin : La question de la Première guerre mondiale ?
Pierre Guyotat : Bien sûr. Tant qu’on découvre des corps, et on en découvre sans arrêt dans l’Est et dans le Nord, en Argonne et partout. J’ai été, il n’y a pas très longtemps, l’année dernière, avec mon frère, c’est très bouleversant, les gens découvrent toujours des corps. Il y a, si je puis dire, des archéologues amateurs qui découvrent tous les jours des corps, plusieurs corps et qui sont identifiables par une médaille, par quelque chose. Tant qu’on découvrira des corps, ça ne sera pas fini et on réfléchira sur l’horreur de cette guerre. Mais on ne réfléchi pas assez sur la justification de cette guerre, d’une part et d’autre part sur ce que je viens de vous dire, à savoir que la République, qui est le gouvernement de tous, de tous en principe, là ça devient quoi ? Qu’est-ce que c’est ? C’est une élite politico-militaire qui décide, et on décide la guerre avec un vieux parlement, je crois, si ma mémoire est bonne. On appelle, les gens, aux armes mais on ne les a pas appelés aux urnes auparavant.
Emmanuel Laurentin : Et il n’y a que quelques êtres particuliers qui sont retenus dans l’histoire et qui sont, entre guillemets, ces héros, je citerai un extrait de Formation où vous dites, à propos de votre famille justement de cette famille de résistants, de déportés : « Des héros, ceux qui ont payé le prix fort et qui savent dans leur chaire d’esprit, ce que l’on court à résister, regardent avec une indulgence fraternelle le peuple laborieux dont ils ont sauvé l’honneur. »
Pierre Guyotat : Je dis bien laborieux, qui a continué de travailler, qui n’a pas été très héroïque. C’est aussi une chose dont j’aimerais parler, ça.
Emmanuel Laurentin : C’est ça qui fait une société ?
Pierre Guyotat : Non, je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais, j’ai remarqué que c’était les gens qui avaient le plus souffert qui étaient les plus indulgents envers ceux qui avaient un peu attendu et pas seulement collaboré. Aujourd’hui, il y a une ignorance quand même de ce qu’on appelait autrefois l’exil intérieur, la résistance intérieure, ça compte dans l’histoire humaine. Puis il y a un moment donné où ça éclate physiquement. Tout ne peut pas être physique du premier coup. C’est une illusion et c’est une façon dangereuse parce que ça fait apparaître ceux qui énoncent ce genre de sottises, ou qui ignorent ce que je dis de la résistance intérieure, dans une situation de ridicule totale.
Emmanuel Laurentin : Ça veut dire qu’il n’y a pas de jugement de valeurs entre ce peuple laborieux que vous décrivez, Pierre Guyotat, et ces héros. Ils se complètent, d’une certaine façon. Ils font la France en même temps.
Pierre Guyotat : C’est la réalité de l’histoire. C’est comme ça. Vous savez, pour condamner une peuple, le peuple français bien entendu c’est beaucoup d’ignorants qui se livrent à ce genre de rhétorique, c’est un genre littéraire en France même, ce sont des gens qui ont un amour-propre, un certain sens de l’humour, pour dire des choses de ce genre. Pour accuser un peuple de lâcheté, il faut avoir une certaine morale soi-même. La morale existe aussi dans le jugement historique, dans le jugement intellectuel. On peut parler bien entendu, on peut parler, il faut toujours parler à partir de soi : « Qu’est-ce que je fais, moi ? », « Qu’est-ce que j’aurais fait ? » et aussi se mettre dans les conditions historiques. La guerre de 14 a été une chose effarante pour tous les peuples, les belges, les anglais, les allemands etc. et pour la France, ça a été particulièrement effroyable car c’est en grande partie sur son territoire que s’est fait cette guerre. Il faudrait emmener, les remmener là-bas à Argonne à Douaumont, etc. jusque dans le Nord, leur faire voir les destructions etc.
Emmanuel Laurentin : Une des particularités de l’histoire, Pierre Guyotat, c’est de savoir si elle nous offre des leçons ou si au contraire elle nous prévient que l’avenir est imprévisible. Si on regardant le passé, on s’aperçoit tout compte fait que l’on ne peut rien prévoir et qu’au bout du compte, ce qui nous arrive est l’imprévu et qu’il faut s’attendre à cet imprévu ? Quand on va sur le côté de ce qui est devenue la Cité nationale de l’immigration, mais qui était à l’époque, en 1931, le Palais des Colonie, il y a cette plus grande France, que vous avez connue, puisque c’était dans cette plus grande France que vous avez grandi, avant que les décolonisations n’interviennent, et il y a la liste de ceux qui ont forgé la plus grande France. Une liste qui s’arrête à mi hauteur d’une colonne, gravée dans la pierre et avec d’autres colonnes qui sont laissées en blanc parce qu’on s’imagine que cela ne va pas s’arrêter là. C’est cela aussi l’histoire. Ça nous dit que celui qui vivait l’exposition coloniale de 1931 ne pouvait pas s’imaginer que cette expansion coloniale s’interrompit, que ça s’arrête.
Pierre Guyotat : Oui, je trouve du reste qu’on peut imaginer, tout le monde peut le faire, le monde futur, le monde immédiatement futur ou lointainement futur, et c’est toujours les mêmes qui à mon avis qui se tromperont, ce sont les prévisionnistes, ceux qui calculent : « nous avons tant maintenant, dans 50 ans… », vous avez des gens qui sont des chefs là-dessus, qui passent à la télévision, qui sont d’un comique extraordinaire. Ceux-là se trompent toujours de toute façon, parce que pour eux il n’y a pas de guerres, pas de catastrophes, il n’y a pas de changements même inopinés, il n’y a pas de religion, pas de fanatisme, il n’y a rien. C’est des purs, si vous voulez. Ce sont des clowns, des comiques. Il en faut. Par contre toutes sortes de gens, de gens très modestes peuvent imaginer tout à fait la suite des choses. C’est un peu difficile à imaginer aujourd’hui parce que maintenant enfin le monde commence un peu à s’équilibrer car nous, on vit une chose que j’aurais pu pouvoir commencer à imaginer quand j’étais seulement adolescent, car j’ai vécu dans la plus grande France, l’installation –même un peu contestée- mais l’installation quand même relativement solide tout de même. J’avais 14 ans en 54, quand vraiment ça craquer beaucoup. Or, c’est le moment où l’on rêve le plus, entre un an et 9 ans. On vous dit, la plus grande France, vous imaginez la puissance absolument aux pieds de silex. Il faut vivre, dans une vie, ce rétablissement-là. Ce n’est pas mal non plus toutes ces générations-là qui ont commencé dans la plus grande France ne soient pas toutes passées au FN, par exemple. Elles arrivent à 60 à 70 ans et elles sont relativement générales. La société française, elle est quoi ? On dit qu’elle est raciste, qu’est-ce que s’est toutes ces histoires-là ? Elle est grosso modo devant le fait accompli. Tout le monde est là, le monde entier est là, on se mélange et pis voilà, ce n’est pas une catastrophe. En général, la grande majorité des gens, si vous évitez de les blesser en les traitant de racistes tout de suite, si vous creusez un petit peu, vous trouvez de l’acceptation, de l’acceptation du fait accompli. Fait accompli qui est un fait mondial de toute façon. Et puis une certaine fierté aussi que le monde entier se retrouve chez nous, entre guillemets. On fait très peu de cas de l’effort des gens au cours des siècles. Moi, c’est cet effort magnifique, formidable, formidable vivacité, que je ne veux pas voir disparaître.
Emmanuel Laurentin : Pas oublier.
Pierre Guyotat : Ne pas avoir oublier, même disparaître, parce que là c’est la barbarie…
Emmanuel Laurentin : L’effort pour vivre ensemble, c’est ça que vous voulez dire.
Pierre Guyotat : Aussi, vivre en semble, oui.
Emmanuel Laurentin : Pour fabriquer quelque chose ensemble.
Pierre Guyotat : Produire, absolument. Échanger, faire du commerce, se battre même, tout. Produire, cultiver, créer, construire, c’est formidable, le patrimoine de ce pays.
Emmanuel Laurentin : Suite, demain de cette série de portraits de créateurs, d’artistes, de cinéastes autour de l’histoire, avec le portrait de Patrice Chéreau, interrogé par Antoine Lachand, dans une réalisation de Renaud Dalmar. Patrice Chéreau, cinéaste, homme de théâtre qui n’est pas si éloigné d’ailleurs de celui que nous venons d’entendre, puisque sollicité pour lire le 11 avril prochain à Thessalonique, en Grèce, un texte, lui donner sa voix, eh bien il a choisi le texte Coma de Pierre Guyotat, que nous venons d’entendre.
Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres : 01 56 40 25 78 ou encore sur le site internet : www.franceculture, rubrique : les émissions : La Fabrique de l’Histoire.
– Pierre Guyotat, Formation, Ed. Gallimard, 27 septembre 2007.
Quatrième de couverture : Ce récit raconte la formation sensorielle, affective, intellectuelle et métaphysique d’un enfant né au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, en France, dans un village du Sud-Est, dans une famille ancienne, catholique, et sans fortune. Je l’ai écrit comme la plupart de mes textes, à l’indicatif présent : à très peu près. Les sentiments, les interrogations, les pensées sont d’un enfant - qui ne cesse de questionner ses aînés - puis d’un adolescent - qui, à quatorze ans, décide d’écrire -, les idées, les convictions, les tourments qui s’y manifestent sont ceux de son entourage, de son temps, dans ses lieux. P. G.
– Pierre Guyotat, Explications, Ed. Léo Scheer, 2000.
Quatrième de couverture : Tombeau pour cinq cent mille soldats (1967), Eden, Eden, Eden (1970), Prostitution (1975), Le Livre (1984), Bivouac (Festival d’Automne, 1987), maintenant Progénitures (2000) : un monde sans équivalent, et une langue à chaque fois plus profondément reconstruite, plus rythmée.
Comment un tel monde est-il né ? Comment ses représentations se sont-elles imposées ? Quelles significations conviendrait-il enfin de leur donner ? Et comment la langue la mieux faite pour dire ce monde et le chanter, celle de Progénitures, s’est-elle, livre après livre, composée ? Enfance, formation, références, Histoire, engagements, création, l’écriture revendiquée comme art et comme métaphysique...
De ses entretiens avec Marianne Alphant en 1999 - un film de Jacques Kébadian sera disponible prochainement -, Pierre Guyotat a tiré Explications, qui est aussi le plus autobiographique de ses livres.