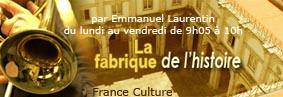Introduction par Emmanuel Laurentin : Semaine spéciale de débats, sans documentaire, de La fabrique de l’histoire, à l’occasion de la crise bancaire mondiale que nous connaissons. Nous avons choisi, assez classiquement, de revenir sur quatre périodes historiques en nous demandant ce que signifiait, en chacune d’entre elles, le terme de crise bancaire ou de crise économique. Hier, nous nous sommes demandés, avec Jean Pébarthe et Jean Andreau, si la notion de crise monétaire puis économique était valide dans les sociétés antiques, et d’ailleurs les étudiants, qui préparent la question de CAPES et d’agrégation sur l’économie des sociétés de Grèce ancienne, peuvent encore la télécharger, cette émission d’hier, pendant 6 jours et l’écouter pendant un mois, sur notre site. Demain, nous traiterons du XVIIIe siècle, en particulier de la banqueroute de Law, ou de Law’s, je ne sais comment on dit. Jeudi, du XXe siècle, avec la fameuse crise de 29 à laquelle on compare celle que nous vivons actuellement. Et, aujourd’hui, nous nous intéresserons au Moyen-Age. Nous parlerons de banques, d’échanges commerciaux entre l’Italie, les Flandres et le reste de la Méditerranée de l’époque, entre le XIIe, le XIIIe et le XVIe siècle. Nous évoquerons des faillites de banques et nous montrerons que l’économie peut-être aussi peut nous conduire sur des chemins lointains, puisque nous parlerons sûrement de chemins commerciaux vers l’Asie et la Mer noire de l’époque, avec Claire Judde de Larivière, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Toulouse Le Mirail, Jean-Marie Yante, professeur à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et Mathieu Arnoux, professeur à Paris VII et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.
« A l’époque de cette guerre, entre le roi de France et le roi d’Angleterre, la compagnie des Pardi et celle de Peruzzi de Florence, brassaient les affaires du roi d’Angleterre. Toutes ses recettes, les laines et autres sources de revenu, parvenaient entre les mains de ces marchands, en contrepartie, ils pourvoyaient à ses dépenses, gages et autres besoins. Les dépenses et besoins du roi excédèrent à tel point ses revenus et la valeur des marchandises reçues en son nom, que lorsque le roi revint de Leost, compte tenu du capital versé, des rémunérations et des intérêts échus, les Pardi se trouvèrent être ses créditeurs pour une somme de 180 000 Mark de Sterling et les Peruzzi pour une somme de 135 000 Mark de Sterling. Un Mark valant plus de 3 florins d’or un tiers, cela faisait 1 365 000 florins d’or, l’équivalent d’un royaume. »
Vous connaissez bien évidemment ce texte, Mathieu Arnoux ?
Mathieu Arnoux : Oui, c’est un des classiques lié à la faillite des deux plus grandes banques de l’époque. Faillite qui vient à la suite d’ailleurs de quasiment un demi-siècle de faillites continues puisque ça commence en 1294 et ça va s’échelonner jusqu’à la peste noire qui a un peu changé les choses…
Emmanuel Laurentin : En 1348.
Mathieu Arnoux : En 1348, qui change les conditions de l’économie et les conditions de la société. Donc, là, on a…
Emmanuel Laurentin : C’est un texte de Giovanni Villani, la Nuova Cronica. C’est un historien florentin, il travaille lui-même dans une banque, qui va d’ailleurs aussi faire faillite, Bonaccorsi. C’est ce qui se passe au même moment, il y a cette ambiance de 1320 à 1340, que vous décrivez. Il écrit, les Nuova Cronica en treize livres qui racontent l’histoire de Florence, jusqu’à sa mort puisqu’il est mort justement de cette peste noire, en 1348, entre 1300 et 1348, c’est un témoignage très intéressant sur la vie de cette ville de Florence et également ses relations avec le reste du monde à ce moment-là.
Mathieu Arnoux : Oui. Les Florentins sont à ce moment-là à la tête du premier réseau européen de banques et ce dont témoigne Giovanni Villani c’est une économie extraordinairement extravertie puisque c’est dans le financement des États au nord des Alpes que s’engagent - c’est ce qu’il décrit avec une très grande précision - ces banques, pas seulement d’ailleurs les banques florentines.
Emmanuel Laurentin : Le financement de la construction des États. Donc, effectivement, il faut se rappeler qu’on est au milieu de la première moitié du XIVe siècle, qu’effectivement ces États se construisent depuis la fin du XIIIe, ils commencent à avoir une structure étatique vraiment installée à partir de ce moment-là, et qu’il faut financer l’administration, la façon dont on gère cet État, et que ce sont les banquiers florentins qui viennent au secours justement, la plupart du temps, du roi d’Angleterre ou du roi de France.
Mathieu Arnoux : Alors, dans des modalités différentes. Ça a commencé dans les années 1290, les Anglais ont besoin de châteaux forts, les châteaux forts demandent des masses de salaires, donc d’argent liquide, tout à fait considérable, le royaume d’Angleterre a virtuellement énormément de laine, c’est le premier producteur de laine de toute l’Europe, tous les draps de luxe sont faits avec de la laine d’Angleterre, et c’est les droits de laine sur la laine et puis la deuxième ressource qu’est l’étain qui vont financer ça. Pour des raisons d’expertise, ce sont les banques italiennes - Génois, Siennois, Florentins - qui vont s’occuper de ça et fournir en échange la monnaie qui permet au roi d’Angleterre de solder ses dépenses.
Emmanuel Laurentin : C’est ce que raconte justement ce texte de Villani, c’est que justement, à un moment, le roi d’Angleterre ne va plus rembourser ces banquiers, il va les conduire à la faillite.
Mathieu Arnoux : C’est le type même de liaisons dangereuses. Les Pardi et les Peruzzi ne peuvent pas plaider l’ignorance. Les faillites se sont succédées, ça fait partie quasiment des procédures normales dans la vie d’un financier que de faire faillite à un moment ou à un autre, en particulier parce que le roi d’Angleterre ne paye plus ses dettes, se déclare en cessation de paiement, et éventuellement quelques malversations ou quelques spéculations sur l’arrivée des vins d’Aquitaine va permettre d’aggraver la situation. Quand on essaye de faire la liste, c’est une liste infinie.
Emmanuel Laurentin : Justement, il faut peut-être, pour nos auditeurs, repartir de ce qu’ils connaissent auparavant, c’est-à-dire de ce qu’on a plus ou moins appris. On a peu appris, quand on n’est pas étudiant italien ou quand on n’est pas élève à l’école italienne, sur les créations bancaires en Italie. En revanche, on a beaucoup entendu parler, parce que nos histoires sont nationales, des fameuses foires de Champagne. Nous avons avec nous, Jean-Marie Yante. Jean-Marie Yante, vous êtes professeur d’histoire médiévale à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, je l’ai dit, vous êtes un des spécialistes de ces foires de Champagne. Ce n’est pas la même période dont on est en train de parler. Là, on commence par la faillite des banquiers Pardi, Peruzzi et des autres Florentins, disons dans la fin de la première moitié du XIVe siècle. La période des foires de Champagne, c’est le siècle précédent et c’est l’enrichissement, par les routes commerciales qui passent par la Champagne justement, par toutes sortes de voies qui passent par la Champagne et qui rejoignent les pays d’Europe du Nord. C’est cela, Jean-Marie Yante ?
Jean-Marie Yante : Oui, les Italiens apparaissent aux foires de Champagne à la fin du XIIe siècle, à l’extrême fin du XIIe siècle alors que les Flamands sont déjà bien présents dans les villes des foires. Et les foires de Champagne connaissent aussi une évolution, parce que si elles ont été dans un premier temps un lieu de commerce de marchandises, d’étoffes notamment, de produits de luxe, au milieu du XIIIe siècle, elles changent, elles tentent de prendre le pas sur le commerce, les foires deviennent alors le marché international des espèces et du change et là, les Italiens, les Siennois, les Florentins, d’autres encore jouent un rôle fondamental. Il y a même un moment où les Italiens vont eux-mêmes acheter en Flandre les draps qu’ils revendent en Champagne. Ce n’est plus les Flamands qui les amènent à Troyes, Lagny, Provins ou Bar-sur-Aube.
Emmanuel Laurentin : C’est donc un lieu de conjonction, disons, entre une économie du Sud de l’Europe et une économie du Nord de l’Europe, et on se rencontre à peu près à mi-chemin justement dans ces foires de Champagne. C’est cela, Jean-Marie Yante ?
Jean-Marie Yante : Oui, c’est un lieu de rencontre mais les Italiens sont également présents notamment dans les Pays-Bas. Ils ne font pas simplement que rencontrer les Flamands aux foires de Champagne. Ils sont présents dans les Pays-Bas, vers la fin du XIIIe siècle au moment du reste où les foires de Champagne connaissent des difficultés parce que la marine italienne, les galères génoises sont présentent en mer du Nord, les routes menant par la Champagne et les Andelys vers l’Italie déclinent pour des raisons d’ordre politique. Les établissements lombards, toute une série de casanes, d’établissements de prêts se créent dans les Pays-Bas, le pays de Liège. Donc il y a une présence, dès la fin du XIIIe siècle, très marquée des Italiens dans les Pays-Bas, une présence qui va se concrétiser par des colonies à Bruges d’abord, à Anvers par la suite et qui va se maintenir durablement. Certaines colonies sont encore attestées au XVIIe siècle.
Emmanuel Laurentin : Ce qu’on est en train de raconter, tout de même, Mathieu Arnoux, ce sont des chemins, des routes, des routes commerciales pourrait-on dire, au long desquelles s’installent justement le commerce, bien évidemment, par l’intermédiaire des foires, les draperies, on l’a appris lorsqu’on faisait des études dans notre prime jeunesse, mais également, et on l’explique, le change et à partir du change les banques et à partir de cela une économie marchande et bancaire qui se développe et qui change au fur et à mesure que ces routes commerciales changent. Là, on parle des foires de Champagne, jusqu’à la fin du XIIIe siècle parce qu’on passe par la terre, mais ensuite on va ouvrir des voies maritimes qui vont changer la donne. C’est un peu cela Mathieu Arnoux ?
Mathieu Arnoux : Ce qui se passe, c’est la sédentarisation du commerce et la création de choses qui sont des places. Les foires de Champagne, ce sont des lieux temporaires, pendant lesquels, 6 semaines, six fois par an, on se rencontre et on va trafiquer des choses diverses et en particulier des crédits. Je crois qu’il faut se souvenir aussi, que l’une des foires de Champagne, qui est Lagny, était aux portes de Paris même si c’était dans le Comté de Champagne, on est là quasiment dans le domaine du roi de France et la place parisienne va jouer un rôle tout à fait important aussi parce que c’est un endroit où il y a en permanence et besoin d’argent, et de l’argent disponible.
Emmanuel Laurentin : Ce que vous dites, c’est que passant, d’une sorte d’occupation temporaire de ces territoires à une occupation définitive, on va installer progressivement des lieux, qui vont devenir des banques, on va installer aussi des lieux qui vont devenir des bourses, à quelques endroits, comme à Bruges, par exemple, et là, dans ces lieux, spécifiquement, il va y avoir une activité économique et non plus commerciale simplement, le change qui va se mettre en place. C’est un peu cela Mathieu Arnoux ?
Mathieu Arnoux : Alors, le mécanisme est très intéressant. Jean-Marie Yante vient de parler des navires génois qui sont à Bruges depuis le XIIIe siècle, à un moment, au cours du XVe siècle, vont arriver les Vénitiens puis les Florentins. Donc, là, on a affaire à un phénomène absolument passionnant puisque l’arrivée régulière de ces navires va stabiliser, va établir des rythmes qui sont comparables aux rythmes des foires mais plus importants.
Emmanuel Laurentin : Plus resserrés.
Mathieu Arnoux : Plus resserrés. L’attente des navires va mobiliser les capitaux, leur arrivée va les stimuler puisque ces navires arrivent avec des produits extrêmement intéressants et désirables : de la soie, des épices,… Du coup, il y a en permanence un va et vient d’argent disponible, d’argent demandé et qui fait que l’on peut désormais prévoir, on peut planifier, on peut spéculer, on peut faire cette économie dématérialisée qu’on voit apparaître dès ce moment-là.
Emmanuel Laurentin : Dont on parle aujourd’hui. Jean-Marie Yante, sur ce que vient de dire Mathieu Arnoux.
Jean-Marie Yante : Il y a l’importance bien sûr accrue des voies maritimes mais il ne faut pas penser pour autant que les voies terrestres sont abandonnées. Au XVIe siècle encore les routes terrestres entre les Pays-Bas et l’Italie l’emportent très largement, en volume de trafic, sur les voies maritimes. Il y a évidemment l’établissement de toute une série de filiales italiennes à Bruges ou Anvers. Des filiales qui subissent parfois les contrecoups de mauvaises affaires, de faillites ou d’entreprises hasardeuses. On connaît des exemples, mais là, on est déjà dans la seconde moitié du XVe siècle, le cas d’une maison brugeoise, des tenanciers qui sont originaires du Piémont, des tables de prêts lombardes qui se sont engagées dans des opérations spéculatives avec d’autres marchands italiens, une certaine solidarité dans ce marché, ils ont acheté des laines, des laines anglaises qu’ils n’arrivent pas à vendre parce que la conjoncture n’est pas favorable, et l’affaire se termine par la fuite, un scandale financier de l’époque, de ce tenancier brugeois de la table de prêt.
Emmanuel Laurentin : Alors, nous avons avec nous, Claire Judde de Larivière. Bonjour, Claire Judde de Larivière. Vous êtes à Londres pour votre part mais vous enseignez à Toulouse et vous êtes spécialiste de la toute fin du Moyen-Age, et de Venise en particulier, à partir du moment où ces routes commencent à être bouleversées, on y reviendra tout à l’heure, par l’arrivée de nouvelles possibilités à partir de la découverte du Nouveau monde, ou encore de la circumnavigation autour de l’Afrique, mais vous vous êtes forcément intéressée à la création de ces fameuses routes maritimes, dont on parle, et qui sont le moteur, pourrait-on dire, de l’invention italienne des banques, un des moteurs de l’invention italienne des banques. Quand vous vous intéressez à ce qui se passe, mettons deux siècles plus tôt, fin XIIIe – début XIVe, par rapport à ce que vous connaissez au XVIe siècle, par exemple, qu’est-ce qui vous intéresse dans ce moment de naissance de ce mouvement ?
Claire Judde de Larivière : Ce qui est très intéressant, c’est de constater comment, dans le cas de l’économie vénitienne, il va y avoir une intervention de ce qu’on peut appeler l’État, des institutions publiques qui vont chercher justement à réguler ces échanges entre le Nord de l’Europe et le bassin méditerranéen dans son ensemble, et comment dès la fin du XIIIe siècle et surtout début du XIVe siècle, l’État vénitien va créer de véritables lignes de navigation qui vont permettre justement ce que Mathieu Arnoux, appelait des foires, c’est-à-dire une espèce de propagation de ces foires sur l’ensemble du bassin méditerranéen. Donc, en fait, ce que fait Venise c’est reprendre des lignes qui existent déjà, il faut imaginer des dizaines et des dizaines de navires privés qui quittent Venise très régulièrement…
Emmanuel Laurentin : Ils les quittent généralement accompagnés, armés pour éviter le piratage, surtout à la fin de cette période-là, néanmoins ils les quittent en bon ordre, pourrait-on dire, et avec ce mélange effectivement de capitaux publics et de capitaux privés ou du moins d’intentions publiques et de capitaux privés. C’est ça, la particularité de…
Claire Judde de Larivière : Dans un premier temps, les navires sont privés et partent séparément et puis l’État justement a cette idée, pas seulement l’État vénitien d’ailleurs, Florence ou Gêne vont procéder à la même organisation, de faire partir les navires ensemble, en convoi. Il s’agit de grandes galères marchandes, qui partent en général à trois, quatre ou cinq. Ils sont armés, donc, ils peuvent se défendre contre les attaques des pirates ou éventuellement contre des puissances ennemies. Ils vont sillonner la Méditerranée selon des lignes préétablies, et ces voyages sont effectivement financés et par l’État et par les investisseurs privés, dans une économie semi publique, pourrait-on dire. Ensuite au retour de ces galères, les bénéfices sont partagés par moitié entre l’État et les investisseurs.
Emmanuel Laurentin : Alors, Mathieu Arnoux, on peut dire qu’on voit, et c’est ce qui a intéressé Fernand Braudel et tous les historiens de l’Italie de la fin du Moyen-âge, naître, s’inventer certains modes de ce qu’on peut appeler le précapitalisme, en tout cas s’inventer certains modes, dans cette Italie XIIIe, XIVe, XVe siècle qui sont assez formidables. Ces inventions, on l’a dit, des banques, du contrat de change, de la compensation en fin de foire, ça c’était un plus tôt, la banqueroute même, on peut dire que c’est inventé à ce moment-là, tout cela s’invente en quelques décennies fin XIIIe début XIVe. C’est ça ?
Mathieu Arnoux : Fin XIIIe début XIVe, effectivement, c’est là qu’on voit naître ces instruments qui montrent une réflexion autour de ce qu’est l’argent. Le problème est simple. Les pièces d’argent ça pèse lourd, quand on a près de 5 ou 6 000 Mark de sterlings c’est des coffres et des coffres, il vaut mieux à ce moment-là essayer de le transformer en intention de paiement d’un côté, intention de paiement de l’autre, une lettre au milieu et on va de cette manière-là faire voyager sans risques, par des phénomènes de compensation, entre les foires et les villes de départ qui peuvent être Sienne, Florence… et on va avoir de cette manière-là circulation de valeur. Donc, ça, c’est un premier point qui se fait dans une ambiance, qui est pour nous compliquée parce que nous ignorons exactement quelle conscience ces gens-là avaient de ce qu’ils étaient en train de faire.
Emmanuel Laurentin : Il y a sûrement des gens qui ont conscience de cela. Il y a en particulier les hommes d’Église. On peut penser par exemple, qu’il faut, auprès des autorités ecclésiastiques, justifier ces prêts qui nécessitent évidemment ensuite de récupérer quelques intérêts, qu’il faut justifier la question du change. J’ai l’impression que la norme ecclésiastique est plus sympathique par rapport à la question du change que par rapport aux prêts à intérêts. En tout cas, il y a tout de même des gens qui doivent penser cela. Il y a un livre qui vient de sortir, qui est tout à fait passionnant, que je n’ai pas eu le temps de finir parce qu’on me l’a mentionné hier, de Giacomo Todeschini, qui vient de sortir en Verdier poche, qui s’appelle, « Richesse franciscaine / De la pauvreté volontaire à la société de marché », dans lequel cet historien italien explique comment, dans cette société du XIIIe siècle qui voit naître aussi l’ordre Franciscain, la notion de pauvreté, la relation entre pauvreté et richesse s’inversant d’une certaine façon, on laisse peut-être la possibilité, le champ libre par ces idées du franciscanisme et de la pauvreté, à un tier secteurs marchand de se développer à côté de la société traditionnelle, pourrait-on dire, et religieuse.
Mathieu Arnoux : Alors, de ce point de vue-là, je crois qu’il y a en ce moment une révision d’idées qu’on a, qui circulent encore, selon laquelle le christianisme et spécifiquement le catholicisme, avec quelque conscience économique que ce soit, de ce point de vue-là, le livre de Giacomo Todeschini qui vient faire le point sur des décennies de recherche personnelles et puis bien d’autres interrogations, montre d’abord, par une constatation simple, qu’une religion qui a comme mot d’ordre « Bienheureux les pauvres » est obligée de se poser le problème de ce qu’elle va faire des riches et comment elle va leur trouver une sauvegarde et un passeport vers le paradis. Donc, il y a cette première chose. Deuxième chose, il est absolument évident que l’Église est une institution ayant un rôle économique absolument fondamental. L’institution pontificale a besoin d’argent et utilise les réseaux bancaires très, très tôt pour faire arriver à Rome ou Avignon, des sommes tout à fait considérables d’argent et ne peut pas ignorer qu’elle le fait avec des lettres de change et en utilisant du crédit. Troisième élément, Giacomo Todeschini le rappelle, c’est dans les villes italiennes, c’est-à-dire dans ces populations de banquiers que naît le franciscanisme.
Emmanuel Laurentin : Évidemment, il rappelle une chose toute simple, pour vouloir être pauvre, il ne faut pas l’être auparavant. Ce sont des gens riches qui d’un seul coup découvrent les vertus de la pauvreté, pour la plupart d’entre eux.
Mathieu Arnoux : Voilà, la révolution faite par Saint-François, dont il faut dire qu’il est né sous la francigena ( ?). Il est fils de commerçant, son nom même parle du commerce avec la France, et en même temps il y a ce problème de comment lorsqu’on s’enrichit pouvoir devenir effectivement un pauvre et gagner son salut. Toute la réflexion franciscaine va être en permanence de convertir de la richesse en pauvreté.
Emmanuel Laurentin : Jean-Marie Yante, sur ce rapport entre les marchands et les normes pourrait-on dire qui seraient édictées par l’Église de l’époque ?
Jean-Marie Yante : Oui, il y a dans les Pays-Bas, l’action des évêques qui, dans un premier temps, condamnent violemment tous ceux qui pratiquent le prêt à intérêts mais au fil des décennies on voit que les positions, l’évêque de Liège par exemple, s’assouplissent parce que l’Église est à la fois, selon les circonstances, soucieuse elle-même d’obtenir des emprunts, soit à d’autres moments de trouver des placements rentables pour les liquidités dont elle dispose. Mais il y a aussi l’attitude des princes. Les princes qui souhaitent mettre leur âme en conformité avec l’exigence de l’Église. Les princes eux-mêmes qui sont constamment endettés, qui ont besoin de recourir aux crédits pour financer leur politique et qui après des mesures, parfois drastiques, radicales, d’expulsion de financiers, qu’ils soient juifs ou qu’ils soient lombards, rapidement leur octroient de nouveaux privilèges pour s’établir. La nécessité fait loi.
Emmanuel Laurentin : Sur ce même point, Claire Judde de Larivière ?
Claire Judde de Larivière : Venise est dans une situation un peu spécifique. On a souvent insisté sur le fait que les Vénitiens se disaient avant tout Vénitiens et ensuite chrétiens. Alors, sans en rajouter, il ne faut pas tomber dans la caricature, les Vénitiens étaient chrétiens, ils respectaient les dogmes de l’Église. On voit très clairement, à mon avis, mais un peu plus tard, au XVe siècle, les acteurs savent très, très bien s’adapter et adapter leurs pratiques. Il y a un discours officiel de l’Église, qui est bien évidemment soutenu par les institutions publiques, qui est soutenu en général par les patriciens qui gouvernent, mais on voit très bien comment les pratiques s’accommodent de ces discours et qu’en réalité, effectivement, dans les pratiques bancaires, dans les pratiques commerciales, il y a de plus en plus fréquemment un usage du crédit, du prêt dans la pratique quotidienne.
[Chant, désolée il m’est impossible de le transcrire, ou de le traduire]
Emmanuel Laurentin : Chant italien du XIIIe et XIVe siècle, interprété par le groupe vocal de Giovanna Marini. Nous sommes dans cette Italie du XIIIe –XIVe siècle, nous voyons bien que les liaisons commerciales sont nombreuses avec le Nord de l’Europe en particulier, c’est ce que nous avons expliqué dans la première moitié de notre émission avec vous et avec Jean-Marie Yante ainsi qu’avec Claire Judde de Larivière, Mathieu Arnoux, ensuite, si on vient justement à ces questions des crises, puisqu’évidemment on disait hier, à propos de l’Antiquité, avec nos deux invités, Christophe Pébarthe et Jean Andreau, que la crise avait au moins ce mérite d’être un moment révélateur parce qu’elle produit généralement un peu plus de documents, elle permet à l’historien quelquefois d’avoir accès à des documents qui ont disparu dans d’autres cas. Alors, si l’on vient à cette question de crises dans cette Italie ou dans cette Europe des XIVe siècle par exemple, ces crises des banques dont on a parlé tout à l’heure en ouverture, les Pardi, les Peruzzi, 1320-1343, 1346, quelques années avant la peste noire, comment expliquer, historiquement parlant, ce qui se passe à ce moment-là ?
Mathieu Arnoux : C’est un problème qui est un des grands classiques sur lequel on n’a pas fini de travailler, c’est le moins que l’on puisse dire. D’abord, les médiévistes ont un usage un peu particulier du mot crise parce qu’il est d’usage de parler de LA CRISE des XIVe –XVe siècle, de dire que tout ce qui se passe à partir de 1300 rentre plus ou moins dans la catégorie crise.
Emmanuel Laurentin : Que cela soit culturel, social, médical, etc., etc.
Mathieu Arnoux : On a de quoi faire. Je dirais que d’abord on a la crise substantielle, comme dirait Polanyi, c’est-à-dire qu’à partir du moment où l’on a en 1315-1317 un retour général de la famine dans le Nord de l’Europe, qui va suivre dans les années 1329 en Italie et dans tout le bassin méditerranéen, c’est une vraie crise. La peste noire, bien évidemment, qui a en quelques mois tué la moitié de la population européenne est une crise dont nous avons plus que de difficultés à comprendre…
Emmanuel Laurentin : Aucun équivalent aujourd’hui.
Mathieu Arnoux : Pour nous, c’est incompréhensible. Comment une société peut-elle survivre à un choc pareil ? Cela reste absolument mystérieux. Donc, il y a ces choses-là…
Emmanuel Laurentin : Évidemment, les petites crises bancaires au milieu de tout cela ça paraît un tout petit peu ridicule, pourrait-on dire.
Mathieu Arnoux : Elles ne sont pas ridicules dans la mesure où elles nous obligent à penser quelque chose que l’on découvre quand même à ce moment-là, que les gens découvrent à ce moment-là, qui est la conjoncture. C’est-à-dire qu’il y a effectivement des régularités, on les a découvertes au cours du XIIIe siècle, il y a des moments où les marchés sont hauts, des moments où les marchés sont bas, et un bon financier, qui a de bonnes informations, peut arriver à anticiper. Puis, il y a des moments où ça se dérègle. Puis, il y a des dérèglements que l’on ne contrôle pas.
Emmanuel Laurentin : Par exemple, la guerre entre la France et l’Angleterre, qui va devenir Guerre de Cent ans au bout du compte. Puis à partir de ce moment-là tout s’emballe, il y a des besoins d’argent qui ne peuvent plus être pourvus et puis voilà.
Mathieu Arnoux : Il est sûr que la guerre joue un très, très grand rôle. Édouard Ier à la fin du XIIIe siècle a désespérément besoin d’argent pour maintenir l’ordre dans le pays de Galles, c’est pour ça qu’il va aller s’endetter auprès des banquiers. Le roi d’Angleterre emprunte aux banquiers, le roi de France a une autre tactique, lui, il dévalue. Il dévalue, rappelle les monnaies et va percevoir une partie de ce qu’on appelle les monnaies décriées qui vont faire rentrer de l’argent dans les caisses.
Emmanuel Laurentin : Deux stratégies.
Mathieu Arnoux : Deux stratégies. Dans un cas le roi d’Angleterre met en péril tout le système économique européen. Le roi de France, quand il dévalue d’un seul coup, fait sauter les contrats de travail dans les villes du royaume de France. Donc, l’inflation mène vers une crise sociale. On a deux gestions du besoin d’argent de la construction de l’État par la crise qui sont tout à fait pleines d’enseignements qu’on découvre à ce moment-là.
Emmanuel Laurentin : Jean-Marie Yante, sur cette question.
Jean-Marie Yante : La situation est différente dans les Pays-Bas parce que là, nous n’avons pas des dynasties comparables au roi d’Angleterre ou au roi de France. Il y a encore - jusqu’au moment où les Bourguignons vont agréger les différentes principautés dans une sorte d’État - des princes autonomes, comte de Hainaut, duc de Brandon, comte de Namur, qui mènent leur politique mais qui, pour mener cette politique, du point de vue financier, assez tôt font appel à des financiers italiens, à des lombards - terme générique, ils ne sont pas nécessairement originaires du nord de l’Italie - qui interviennent comme maîtres des monnaies, comme receveurs généraux et qui, là, encore que ce soit très difficile à percevoir, jettent les bases d’une première politique économique ou politique monétaire dans les états.
Emmanuel Laurentin : Ça veut dire tout de même qu’il y a des normes qui doivent s’établir, Jean-Marie Yante, parmi toutes ces personnes qui à un moment ou un autre ont décidé de servir des puissances princières du Nord de l’Europe ? J’imagine qu’ils ont des pratiques qu’ils vont peut-être établir petit à petit en normes ?
Jean-Marie Yante : Oui, il y a des pratiques. Étant donné parmi ces Lombards, ceux qui deviennent des conseillers des princes appartiennent à des familles qui ont des connexions entre elles, des lieux d’origine communs, qu’ils ont été associés dans une même entreprise, il est clair qu’il y a des règles, peut-être petit à petit, qui ne sont pas formulées mais qui sont appliquées. C’est tout le problème, pour l’historien, d’aller déterminer cela. Parce qu’on ne peut pas réellement parler de politique économique dans ce dernier siècle du Moyen-âge, il y a incontestablement, il y avait déjà bien avant des préoccupations économiques des princes, il faudra l’extrême fin du XVe siècle, du XVIe pour que les théoriciens apparaissent dans les entourages princiers et définissent un peu de règles de gestion économique.
Emmanuel Laurentin : Mais un peu avant la création de théoriciens, il y a tout de même l’invention, par exemple, de livre de comptes. Et la comptabilité telle qu’on la tient aujourd’hui encore, toutes les personnes qui s’occupent de la comptabilité, naît. Le premier livre de comptes connu je crois que c’est aux environs de 1340, la date dont on parle depuis tout à l’heure, on tourne autour de ces dates de 1300-1340, Mathieu Arnoux, mais enfin, c’est le premier connu, mais il y en a peut-être un peu avant, en tout cas la première moitié du XIVe siècle, voit naître le livre de comptes.
Mathieu Arnoux : Alors, voit naître, le livre de comptes…
Emmanuel Laurentin : A partie double.
Mathieu Arnoux : Voilà. Compter, beaucoup de gens le font. Les rois de France, les rois d’Angleterre comptent depuis la fin du XIIe siècle, et même depuis le début du XIIe siècle pour les rois d’Angleterre. Donc, ce n’est pas le fait de compter l’argent qui est important. C’est cette innovation, alors sur laquelle on se bagarre, parce que quand on né au XIVe siècle, il y a des choses qui nous paraissent bizarres, qui sont tenues en latin, dont on ne comprend pas très bien s’ils ont ou s’ils n’ont pas un système de double entrée. La comptabilité en partie double, va permettre à un marchand de savoir à chaque moment ce qui est rentré et ce qui est sorti et de pouvoir en plus communiquer à son client qu’elle est sa situation comptable. L’objectif est celui-là.
Emmanuel Laurentin : Et ça joue sur la confiance évidement ? La confiance de celui qui va avoir affaire à ce marchand.
Mathieu Arnoux : C’est une question considérable. Il semble que très tôt, le livre de comptes puisse être présenté en justice comme preuve dans un procès, ce qui indique qu’il y a une espèce de déontologie supposée du marchand qui doit mettre dans sa comptabilité que des choses rigoureusement exactes.
Emmanuel Laurentin : Donc, des comptes qui sont francs, comme on peut dire aujourd’hui. Claire Judde de Larivière, sur tout ce qu’on vient de dire.
Claire Judde de Larivière : Je pense que vous avez soulevé une des questions essentielles, c’est celle de la confiance. Jean-Marie Yante parlait des conventions tacites qui passent à travers ces outils économiques et je crois justement que c’est là un des grands enjeux de l’histoire économique aujourd’hui. Comment va-t-on faire pour renouveler les problématiques de l’histoire économique ? C’est justement en essayant de comprendre, en dépassant cette étude des outils que nous connaissons,…
Emmanuel Laurentin : Qui ont déjà été travaillés par d’autres historiens des générations précédentes.
Claire Judde de Larivière : Voilà, il y a eu quand même un formidable développement de ces recherches depuis les années 60. Aujourd’hui, ce qui nous intéresse, c’est davantage cette question de la confiance, puisque ne l’oublions pas le prêt à la base même du crédit, il y a cette notion de confiance, qui est bien évidemment extrêmement difficile à percevoir dans les sources mais c’est bien tout l’enjeu d’une recherche qui deviendrait beaucoup plus anthropologique, sociologique et qui va maintenant essayer de percevoir qu’elles sont ces conventions économiques qui lient les acteurs économiques et politiques entre eux.
Emmanuel Laurentin : C’est pour ça que les ouvrages comme celui de Todeschini sont utiles, parce qu’effectivement on peut dire tout cela, c’est une réflexion, entre guillemets, franciscaine sur le monde et est-ce que ça a eu des applications ? Mais évidemment on sait bien que dans le domaine des idées, quand les idées circulent, elles finissent par avoir des applications dans le monde réel, pourrait-on dire. Mathieu Arnoux ?
Mathieu Arnoux : Je crois que là, il faut surtout éviter l’anachronisme qui consisterait à dire que d’un côté il y a ce que les gens pensent et d’un côté ce que les gens font. Ça, ce n’est pas vrai. Ces gens pensent ce qu’ils font et font ce qu’ils pensent. De ce point de vue là, je crois qu’à côté de l’œuvre de Giacomo Todeschini, il faudrait mettre les recherches tout à fait fondamentales de Reinhold Mueller qui a précisément montré comment se constituent ces réseaux, ces pratiques, et en particulier comment à l’intérieur des sources d’entreprise, et là à partir des années 1380 nous en avons beaucoup, qui permettent de montrer qu’il y a une continuité entre les attitudes religieuses, je pense aux dizaines de milliers de lettres que nous a laissées l’agence bancaire et commerciale de Francesco di Marco Datini, où nous avons des lettres religieuses à côté de lettres purement commerciales.
Emmanuel Laurentin : Donc, il y a coexistence, cohabitation, interpénétration d’une pensée dans l’autre, la pensée économique ne peut pas se penser sans la pensée religieuse, vous voulez dire ?
Mathieu Arnoux : C’est même plus que ça. Il y a verbalement une pensée, nous nous disons religieuse, elle est en même temps éthique de l’action. C’est-à-dire qu’on voit très bien, ce qui ne veut absolument pas dire qu’on ne trouve pas parmi les marchand des filous purs et simples, il y en a beaucoup et une partie des faillites du début du XIVe siècle sont liées véritablement à des escroqueries, mais en même temps, par exemple cette littérature qu’on voit naître en 1320 avec le manuscrit de Pegolotti, La Pratica della mercatura, vont expliquer que quand même le marchand doit être attentif à une éthique de son métier et que ce n’est pas simplement une question de faire son salut, sinon il y a pas de réseau. Donc, la confiance, c’est la fidès, c’est la foi, les deux sont liées, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de désaccord très profond avec l’Église sur ce point-là.
Emmanuel Laurentin : Alors, est-ce qu’il faut, Claire Judde de Larivière, individualiser ce monde italien que l’on imagine un peu avec une sorte d’unité, même si l’on sait qu’il est constitué de cités très différentes les unes des autres ? Vous êtes spécialiste de Venise, est-ce que Venise, le destin de Venise, la façon dont on pratique justement ces relations commerciales et ces relations bancaires à Venise est différente de ce qu’on peut connaître à Bruges, à Florence, à Gêne à la même époque ?
Claire Judde de Larivière : Sans doute qu’on trouverait des mécanismes communs, en particulier dans ce qui concerne les pratiques économiques, néanmoins, je pense qu’il y a des spécificités qui sont liées en particuliers à l’organisation des États. Les économies médiévales restent des économies très contrôlées, et de ce point de vue là par exemple, l’économie vénitienne ne peut être conçue en dehors d’une politique publique de l’économie. Alors, bon, ça peut paraître anachronique mais…
Emmanuel Laurentin : Vous dites qu’une législation économique efficace donne des conditions favorables à la pratique commerciale, à la pratique bancaire, par exemple. Donc, effectivement, il faut légiférer d’abord pour pouvoir savoir dans quel cadre on opère et puis ensuite ces opérations peuvent se développer.
Claire Judde de Larivière : Oui, je pense qu’elles se développent également dans des cadres idéologiques. Dans le cas de Venise où il y a une très forte confusion entre les sphères publiques et privées, où les patriciens gouvernent l’État mais dans le même temps investissent justement, sont les propriétaires de ces banques, sont les investisseurs des galères marchandes…
Emmanuel Laurentin : Il faut peut-être s’arrêter sur ce point, parce que c’est ce qui m’a le plus surpris en vous lisant. Effectivement, aujourd’hui il y aurait confusion d’intérêts, si on pratiquait, comme à l’époque à Venise. On poursuivrait ces gens-là devant les tribunaux puisque les familles patriciennes dirigent la ville de Venise décrètent des lois, donnent des normes selon lesquelles il faut faire en particulier cette navigation des lignes dans toute la Méditerranée jusqu’à l’Angleterre et Bruges, mais également ils investissent sur les bateaux qui partent sur cette navigation de ligne, c’est ça cette particularité. Ils sont propriétaires de parts et en même temps ils donnent les normes.
Claire Judde de Larivière : Voilà, ils légifèrent, ils le font exactement dans le domaine bancaire ou industriel au moins jusqu’à la fin du XVIe siècle. À partir de cette époque ça va légèrement changer puisqu’il va y avoir une ouverture beaucoup plus large des activités économiques aux non-nobles, aux non-patriciens mais jusque là effectivement ils sont tout autant les législateurs que les acteurs économiques, ce qui crée des confusions. Alors, vous dites qu’aujourd’hui, ça nous paraît choquant. Je crois qu’il faut concevoir que ça a été très souvent le cas, à Florence…
Emmanuel Laurentin : C’est pour ça qu’il ne faut pas pratiquer d’anachronisme, mais quand on voit ce qu’on appellerait le mélange des genres, ça veut dire qu’effectivement ces notions ont évolué au cours du temps.
Claire Judde de Larivière : Oui, à l’époque effectivement on est dans une conception où le patricien est considéré comme une classe dirigeante naturellement parce que les nobles sont les meilleurs, donc ce sont les plus aptes à diriger l’État, et ce sont de ce fait également les plus aptes à pratiquer les activités économiques.
Emmanuel Laurentin : Par ailleurs on considère qu’on peut servir l’État tout en servant ses intérêts personnels. C’est-à-dire que la meilleure façon de servir Venise, c’est d’investir dans ces convois, d’investir dans cette navigation en ligne, parce que l’intérêt sera mélangé et on servira à la fois la puissance et la gloire de Venise en même temps qu’on sert ses intérêts de famille.
Claire Judde de Larivière : Oui, parce que, je pense que ce qu’on appelle le bien commun, assez classiquement, dans les cités médiévales ou dans les États médiévaux, c’est ni plus ni moins que le bien, avant tout, de la classe dirigeante.
Emmanuel Laurentin : Mathieu Arnoux ?
Mathieu Arnoux : Oui, je crois que c’est un point important et ça nous incite à ne pas faire un deuxième anachronisme qui serait de séparer une économie des instruments monétaires d’une économie réelle. L’économie réelle existe, je crois qu’elle existe sous une forme à laquelle il faut réfléchir un peu. C’est une société, j’oserais dire, à la différence de la nôtre, mais avec un peu d’ironie, extraordinairement inégalitaire mais qui sait que pour maintenir en paix une société inégalitaire, il faut absolument fournir à la classe populaire le moyen de survivre. À partir de ce moment-là, il appartient aux riches, au haut de la société de bien vouloir, en période de crise, fournir ce qu’il faut pour sortir de la crise. On peut en donner un exemple. Les banquiers ne se mêlent pas d’acheter du blé. Pegolotti, dit, au début du XIVe siècle : C’est trop dangereux.
Emmanuel Laurentin : C’est trop risqué.
Mathieu Arnoux : C’est trop risqué. C’est trop politique et on risque de très gros ennuis. Mais, quand la famine guette, il n’y a absolument aucun doute que les financiers de l’extérieur vont être mis à contribution pour faire parvenir du blé dans leur ville. Ça se passe aussi bien à Venise qu’à Florence et même, ça va se passer aussi dans les villes du Nord.
Emmanuel Laurentin : Si on avance un peu dans le temps, vers ce qu’on appelle la fin du Moyen-âge et le début du monde moderne, vers la fin du XVe siècle, avec vous, Claire Judde de Larivière, vous êtes spécialiste de cette période-là, en particulier pour ce qui concerne Venise. Tout à l’heure, Mathieu Arnoux nous disait : « Il ne faut jamais oublier la conjoncture », à propos des guerres entre la France et l’Angleterre, de ce qui se passe, de la peste en particulier, à la fin du XVe siècle, c’est-à-dire la circumnavigation autour de l’Afrique, le changement des routes commerciales. Avant de commencer cette émission, nous discutions, avec Mathieu Arnoux, du cas de la banque florentine des Médicis, qui a dominé la banque florentine pendant tout le XVe siècle, qui explose à la fin du XVe siècle, en 1494, pas très loin d’autres dates très connues. En explosant, en même temps, elle va s’installer dans toute l’Europe, elle va finir par créer un réseau. Les anciens de la banque Médicis vont finir par créer un réseau. Vous pouvez nous raconter cette crise du tournant, de la fin du XVe – début du XVIe siècle, Claire Judde de Larivière ?
Claire Judde de Larivière : Dans ce cadre-là, il ne faut pas oublier que les grandes découvertes auront des conséquences réelles, beaucoup plus tardivement. La découverte, par les Portugais, de la circumnavigation de l’Afrique va considérablement transformer les marchés européens dans les 2 ou 3 premières décennies du siècle. Puis, il va y avoir une pause, les marchés méditerranéens vont se réorganiser. La découverte de l’Amérique quant à elle aura des conséquences seulement dans la seconde moitié du XVIe siècle. Alors, ce qui se joue à la fin du XVe siècle, en réalité à Venise, par exemple, on a à nouveau une grande période de panique bancaire, de crise bancaire et de panique, qui sont davantage…
Emmanuel Laurentin : Qui se traduisent comment ? Cette panique bancaire se traduit comment, dans cette Venise de la fin du XVe ?
Claire Judde de Larivière : Venise est en guerre à cette époque, non seulement dans le Nord de l’Italie, puisqu’elle doit maintenir une armée en Lombardie, contre les envahisseurs français en particulier, mais elle est également en guerre en mer Égée contre les Turcs. Donc, pour financer la guerre, l’État vénitien va relancer l’emprunt forcé, c’est classique à Venise, il ne faut pas oublier l’importance de la dette publique dans les villes italiennes, et pour financer les guerres…
Emmanuel Laurentin : C’est une particularité par rapport à l’émission d’hier sur l’Antiquité. Nous disions, hier, dans l’émission qu’il n’y avait pas de dettes dans les cités antiques même à Rome, c’était une idée qui était totalement impossible et même inimaginable, en revanche au Moyen-âge, en Italie, la dette publique, est connue.
Claire Judde de Larivière : L’économie repose en partie sur la dette publique. Les dépenses ordinaires sont couvertes par les taxes sur les marchandises, les taxes commerciales douanières, mais toutes les dépenses extraordinaires, liées à la guerre, sont généralement financées par les emprunts forcés. Et dans le cas de ces deux guerres, au tournant du XVe-XVIe siècle, Venise relance l’emprunt forcé et de très nombreux patriciens et citoyens se retrouvent dans l’impossibilité d’acheter ces titres et donc doivent retirer des banques des liquidités pour pouvoir acheter les nouveaux ( ? Manque un mot) émis. Et on voit plusieurs banques vénitiennes de l’époque faire faillite puisqu’elles ne peuvent pas…
Emmanuel Laurentin : Conserver ce qui a été déposé dans leur coffre.
Claire Judde de Larivière : Voilà. Soit elles veulent satisfaire la demande et donc elles sont obligées ensuite de fermer, soit elles se retrouvent dans l’impossibilité et dans ce cas-là, c’est intéressant, il y a une intervention de l’État justement pour couvrir ce besoin de liquidité. Donc, là, c’est une crise très rapide en fait. C’est ça qui est important à mon avis. C’est une crise bancaire mais qui va, au bout de 3-4 années, être dépassée, de nouvelles banques vont être créées à Venise.
Emmanuel Laurentin : Ce n’est pas une crise durable, vous voulez dire. La crise durable s’installera plus tard, avec les conséquences de la découverte du Nouveau monde, plutôt dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Mathieu Arnoux ?
Mathieu Arnoux : Je crois qu’il faut bien voir qu’il y a cette succession de faillites qui sont très souvent conçues comme des accidents. C’est-à-dire qu’à un moment, une créance qui devait rentrer et qui aurait permis d’équilibrer ne rentre pas parce qu’un bateau a du retard, parce que les pirates, parce que la tempête, et à ce moment-là une banque va faire faillite. À partir du moment où…
Emmanuel Laurentin : Est-ce qu’il y a un discours sur le risque ? Pas pour faire un parallèle avec ce que nous vivons aujourd’hui. Y-a-t-il un discours sur le risque à ce moment-là ?
Mathieu Arnoux : Absolument. Il n’y a pas de hasard. C’est chez les Franciscains qu’on va essayer de réfléchir sur « est-ce que le risque est quelque chose qui pourrait légitimer l’intérêt ? » Il en est question dès la fin du XIIe siècle. On dit que les paysans doivent payer 10% de la récolte. Par contre les marchands, pour la dime, payent 10% de leurs bénéfices parce qu’ils doivent intégrer le risque. Ça pose des problèmes philosophiques tout à fait compliqués d’arriver à cette définition.
Emmanuel Laurentin : Claire Judde de Larivière, sur cette même question, la réflexion sur le risque dans ce que vous avez pu voir dans les archives que vous avez parcourues pour votre travail.
Claire Judde de Larivière : Oui, il y a évidemment surtout dans le domaine du commerce maritime puisque les naufrages sont de plus en plus fréquents au XVIe siècle, pour des raisons techniques. Les navires, en particulier les navires publics, les galères publiques sont en mauvais état, l’État ne prend pas le soin de les réparer donc on a de très nombreux naufrages. Et on voit comment effectivement les investisseurs cherchent à prévoir les éventuels risques et à transformer leurs pratiques commerciales et leurs pratiques d’investissement en fonction de ces dangers probables, en fonction des éventuelles attaques pirates qu’ils peuvent supposer possibles dans certaines régions de la Méditerranée.
Emmanuel Laurentin : Est-ce que je me trompe si je dis que le système d’investissement sur ces navires marchands, avec le système des carats, que certains considèrent comme une sorte d’ancêtre des sociétés par action, c’est de partager le risque d’une certaine façon ?
Claire Judde de Larivière : On investit effectivement collectivement en achetant des parts de capital et à hauteur de l’investissement on sera récompensé ou au contraire on aura à partager des déficits.
Emmanuel Laurentin : On risque moins d’une certaine façon. On risque de gagner moins mais on risque de perdre moins en même temps.
Claire Judde de Larivière : Oui, il y a une grande solidarité entre ceux qu’on pourrait appeler actionnaires. En plus, il ne faut pas oublier la garantie de l’État vénitien. Il aide les marchands. Lorsqu’un navire fait naufrage, on voit très souvent les marchands faire des demandes auprès du Sénat, soit pour être aidé financièrement soit pour que leurs dettes soient justement gelées pendant un an le temps qu’ils puissent refaire de nouvelles affaires et pouvoir rembourser leurs dettes.
Emmanuel Laurentin : On voit, Mathieu Arnoux, que c’est absolument passionnant. Je dois dire que je n’ai jamais fait d’histoire économique et c’est absolument passionnant de vous écouter les uns et les autres. Qu’est-ce qui explique le peu de succès ou le peu d’intérêt que cette histoire économique au Moyen-Age en particulier mais toutes les autres périodes, tous les autres historiens que nous avons invités nous ont dit la même chose, sauf peut-être pour le XXe siècle, suscite chez les étudiants ou dans les centres de recherche ? Qu’est-ce qui fait qu’on ne veut pas parler de ça ? Qu’est-ce qui se passe ? Parce que c’est extraordinaire d’entendre parler de ces créations bancaires et de ces lignes de commerce au Moyen-âge.
Mathieu Arnoux : Il y a plusieurs choses. D’abord, je confirme, nous savons tous que si nous marquons histoire économique en titre d’un de nos enseignements, nous n’aurons pas un seul étudiant. Donc, on va utiliser des périphrases.
Emmanuel Laurentin : Il faut ruser.
Mathieu Arnoux : Voilà. Et quand on révèle que ce dont il vient d’être question, c’est de l’histoire économique, on a en général une bonne surprise : « Si j’avais su que c’était ça, j’aurais volontiers accepté de faire de l’histoire économique. » Il y a des raisons précises, surtout pour les périodes anciennes, nous n’avons pas été aidés, pendant longtemps, par les économistes simplement parce que nous n’avons pas les instruments statistiques qu’il faut pour répondre à leurs critères. C’est seulement, comme le disait Claire Judde de Larivière, depuis que se sont répandues les méthodes de sociologie économiques, des théories des conventions qu’on commence à pouvoir parler avec des économistes.
Emmanuel Laurentin : À égal avec les économistes.
Mathieu Arnoux : Mais j’aurais tendance à penser que la peur de l’histoire économique a valeur de symptôme de peur de l’économie tout court.
Emmanuel Laurentin : La même question, Claire Judde de Larivière, pour conclure.
Claire Judde de Larivière : Peut-être qu’en France, on paye le fait que l’histoire économique se fait dans les départements d’histoire, ce qui est très intéressant parce que du coup ça nous ouvre à des perspectives très historiques. N’oublions pas qu’en Angleterre ou en Italie, l’histoire économique est rattachée au département d’économie. C’est vrai que les étudiants et les enseignants ont une formation beaucoup plus technique qui leur permet peut-être d’affronter des problématiques qui peuvent faire peur. Ils ont des outils méthodologiques qui leur permettent justement de mieux comprendre les mécanismes qui, on le sait, sont relativement difficiles.
Emmanuel Laurentin : Merci, Claire Judde de Larivière. Un conseil de lecture, pour ceux qui auraient été intéressés, appâtés par vos discussions, soit sur votre propre travail ou celui d’autres historiens qui travaillent la même période ou le même sujet que vous ?
Claire Judde de Larivière : Je viens juste de publier un ouvrage sur ces questions-là, relatif justement à la question du public et du privé à Venise, « Naviguer, commercer, gouverner ». Je mentionnerais beaucoup des travaux des Anglo-Saxons. C’est vrai que pour ceux qui lisent l’anglais, je pense que des ouvrages comme ceux de Christopher Alan Bayly sont particulièrement stimulants et que justement ils nous montrent des perspectives de recherche, ou de Stephan Epstein, qui montre comment on peut, de façon tout à fait intéressante, renouveler les problématiques d’histoire économique.
Emmanuel Laurentin : Même chose pour vous Mathieu Arnoux.
Mathieu Arnoux : Pour les lecteurs en français il faut se précipiter sur Giacomo Todeschini…
Emmanuel Laurentin : Ça vient juste de sortir. C’est chez Verdier poche, « Richesse franciscaine : de la pauvreté volontaire à la société de marché ».
Mathieu Arnoux : Et ça coûte très peu cher.
Emmanuel Laurentin : Voilà, parce que c’est un poche.
Mathieu Arnoux : Sinon, je crois qu’il y avait l’an dernier un numéro de la revue de Synthèse sur les marchés.
Emmanuel Laurentin : On en a parlé hier.
Mathieu Arnoux : Qui donnait un certain nombre de points. Et puis, je concorde pleinement avec Claire Judde de Larivière pour dire que nos collègues en particulier anglais font un travail tout à fait extraordinaire mais malheureusement pas disponible en français.
Emmanuel Laurentin : Merci à tous les deux, puis remercions Jean-Marie Yante qui a dû nous quitter un peu plus tôt. Merci à tous les trois d’avoir participé à cette émission un peu au pied levé. Demain, nous traiterons des XVIIe et XVIIIe siècle. Mêmes questions : Qu’est-ce que la crise économique, dans ce contexte de l’époque moderne d’avant la Révolution française ?
Comme d’habitude, cette émission a été préparée par Maryvonne Abolivier et Aurélie Marsset. Le site Internet sur lequel vous pouvez écouter notre émission, pendant un mois, la télécharger pendant une semaine, trouver des bibliographies complémentaires, est tenu par Antoine Lachand. À la technique aujourd’hui, Jean Frédérix, à la réalisation Gislaine David.
Un numéro de téléphone : 01 56 40 25 78. Une adresse : Pièce 6123 à la Maison de Radio France, 7520 Paris CEDEX 16. Puis, le site Internet www.franceculture.com, rubrique : les émissions, La Fabrique de l’Histoire.
.
Des livres à découvrir et des sites à consulter, recommandés sur le site de l’émission
– Giacomo Todeschini, « Richesse franciscaine : de la pauvreté volontaire à la société de marché », Ed. Verdier poche, 25 septembre 2008.
4ème de couverture : Adeptes d’une pauvreté rigoureuse et évangélique, les franciscains sont paradoxalement amenés, du fait précisément de ce choix « scandaleux », à examiner toutes les formes de la vie économique qui se tiennent entre la pauvreté extrême et la richesse excessive en posant la distinction entre propriété, possession temporaire et usage des biens économiques.
Selon quelles modalités les chrétiens doivent-ils s’approprier l’usage des biens terrestres ? Pour répondre à cette question, les franciscains furent nombreux, depuis le treizième siècle, à écrire sur la circulation de l’argent, la formation des prix, le contrat et les règles du marché.
Dans ce cadre, la figure du marchand actif, qui sait faire fructifier par son travail et son commerce un capital - en soi dépourvu de valeur - s’affirme positivement dans la mesure où elle contribue à la croissance d’un « bonheur citadin ». À l’opposé, la figure du propriétaire foncier, du châtelain, de l’aristocrate qui conserve pour lui-même, thésaurise et ne multiplie pas la richesse apparaît comme stérile et sous un jour négatif.
La réflexion franciscaine est donc à l’origine, avant même l’éthique protestante étudiée par Max Weber, d’une grande partie de la théorie économique européenne et, en particulier, de l’économie politique qui considère que les richesses de ceux qui forment la communauté civile sont une prémisse fondamentale du bien être collectif.
– Claire Judde de Larivière, « Naviguer, commercer, gouverner : économie maritime et pouvoirs à Venise (XVe-XVIe siècles) », Ed. Brill, 2008.
Présentation de l’éditeur : Les convois de galères publiques, forme typique de la navigation médiévale vénitienne, disparurent progressivement à la veille de la bataille de Lépante. Loin de signifier une crise générale de l’économie dans son ensemble, cet abandon fut néanmoins le corollaire de mutations politiques, économiques et sociales essentielles qui marquèrent l’histoire de Venise au XVIe siècle. À travers l’étude des acteurs économiques, leur identité, leurs pratiques et leurs fonctions, cet ouvrage met en perspective les transformations de la navigation commerciale publique et privée avec les évolutions des formes et des fonctions de l’État vénitien, dans un contexte général de redéfinition de la relation entre bien public et intérêts privés.
– La crise jusqu’où ? Dossier de franceculture.com Analyses, reportages, réactions et sélection de livres et de liens au sujet de la semaine qui a bouleversé la finance mondiale. Avec aussi les explications d’Olivier Pastré sur quelques mots clés de cette crise.