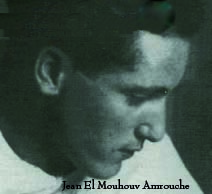
Introduction : Une vie une œuvre, merci de nous retrouver, notre portrait aujourd’hui et celui du poète, écrivain et homme de radio, Jean Amrouche, 1906-1962.
La mémoire de la Guerre d’Algérie, longtemps oubliée, refait surface ces dernières années à la faveur des commémorations accompagnant les cinquantenaires successifs des différents épisodes de cette guerre. Il y a quelques jours c’était la manifestation du 17 Octobre et dans quelques mois ce seront les Accords d’Évian qui concentreront l’attention. Autant d’occasions pour les deux pays de se repencher sur une histoire particulièrement douloureuse et sur laquelle l’omerta a longtemps régné.
Nous avons choisi, ici, à Une vie une œuvre d’accompagner ce mouvement de mémoire avec le portrait d’un Algérien amoureux à la fois de l’Algérie et de la France. Jean Amrouche, qui discutait d’égal à égal avec les plus grands écrivains de l’hexagone, n’a jamais renié ses origines. Et c’est sans renier son amour pour la France universaliste, la France des Lumières, qu’il a dénoncé dans le même temps la France meurtrière, la France de la colonisation. Amrouche s’identifiait alors à Jugurtha, ce héros Nord africain qui su résister à l’Empire romain. Par là même, il dessinait un autoportrait déguisé, car Jugurtha est rusé, généreux mais aussi passionné, violent et rebelle, comme vous le donne à entendre aujourd’hui Fanny Jaffray et Pascale Rayet.
Jean Amrouche : Je suis d’origine kabyle, je suis de père et mère kabyles, c’est-à-dire berbères. Je suis né il y a une cinquantaine d’années, dans la vallée de la Soummam, de père et mère chrétiens. Mon père et ma mère sont les seuls chrétiens dans une famille très étendue, qui est demeurée une famille musulmane. J’ai donc vécu dans une double ambiance, celle de ma famille la plus proche, catholique, religion dans laquelle j’ai été élevé, et celle de ma famille, au sens extensif du mot, musulmane. »
Pierre Amrouche : C’est un de ses premiers passeports, sinon le premier. En fait il n’a qu’un prénom, je parle au sens de l’État civil, c’est Maïhoub, qui peut s’écrire aussi El Mouhouv, c’est son prénom de l’État civil kabyle, puisque lorsqu’il naît en 1906, il est sous le statut de l’indigénat, il n’est pas citoyen français, il est sujet français, comme mon grand père Belkacem et ma grand-mère Fadhma. Ils n’ont pas le droit à l’époque, bien qu’ils soient tous les deux chrétiens, convertis, de donner des prénoms chrétiens à leurs enfants, du moins ne peuvent-ils pas les officialiser. On ne voulait pas que des indigènes puissent passer ou pour des Juifs naturalisés français ou pour des Méditerranéens français d’Algérie. Donc, son prénom, c’est Maïhoub. Son prénom de baptême, Jean, sera très vite accolé à ce prénom kabyle, et utilisé jusqu’à disparaître de la plupart des documents. Mais jusqu’à son mort, c’est son prénom et il le revendique comme tel très souvent, en même temps il revendique son prénom chrétien puisqu’il est chrétien et qu’il est même religieux, il croît, il a la foi.
Fanny Jaffray : En tant que Kabyle, Jean Amrouche se dit habité par l’esprit d’enfance, qui se définit, selon lui, par un double attachement à la terre natale et à la mère. Il écrit : « Nous portons en nous, avec la joie d’être vivants, de nous sentir animalement existants, l’amer regret du non-être. La mère qui nous a nourris de sa chaire, la terre maternelle qui nous recevra, sont les corps qui nos rattachent au non-être, ou si l’on veut à l’origine ineffable, au tout dont nous nous entons cruellement séparés. »
Toute sa vie Jean Amrouche verra dans la figure maternelle la poésie même, qui est tout à la fois, selon lui, regret de l’enfance et regret du pays perdu. Sa mère, Fadhma Aïth Mansour, est une femme exceptionnelle, dont l’existence a été dès l’origine sous le signe d’un destin singulier, comme nous le raconte Tassadit Yacine.
Tassadit Yacine : Fadhma Aïth Mansour, c’était une femme de Kabylie, qui a eu une histoire particulière. Cette histoire particulière, c’était qu’elle était, comme on disait alors, je mets des guillemets, « une enfant naturelle ». On peut imaginer ce qu’être « une enfant naturelle » dans un village Kabyle. Cette trajectoire qui sort de l’ordinaire par rapport à une société kabyle, paysanne, colonisée, va faire tout de suite de cette petite fille une marginale. Si Fadhma n’avait pas rencontré son mari Belkacem, le père de Jean Amrouche, peut-être qu’elle n’aurait-elle jamais pu se marier. Belkacem va se convertir à la mi-saison, il vient d’une autre région, il travaille à de menus travaux chez les pères-blancs, et ce sont les pères blancs qui vont organiser leur mariage. Fadhma va se convertir pour la nécessité du mariage. Le jour de son mariage, elle devient chrétienne pour sauver sa vie. Voilà donc le visage extraordinaire de cette femme, Fadhma. Elle va avoir plusieurs enfants, dont Jean Amrouche, sa fille, que l’on connaît, parce qu’elle a été une très grande cantatrice, Taos Amrouche, elle va perdre un certain nombre. Elle est à la fois Kabyle en même temps c’était quelqu’un qui savait lire et écrire, elle adorait la poésie française, elle va élever ses enfants dans une double culture, la culture française d’un côté et un enracinement extrêmement puissant dans la culture kabyle.
« Fadhma Aïth Mansour : Je sais qu’à l’âge de Dix-huit ans, quand il est revenu de Saint-Cloud, il avait attrapé froid. Il avait de la fièvre. Il est venu dans ma cambre et m’a dit : maman, chante-moi comme quand on était petit. Et je lui ai chanté. »
Jean Amrouche : Que dirais-je de cette enfance ? Beaucoup de choses sans doute qu’il n’est pas possible d’exprimer ici, au micro, et sous cette forme tout à fait improvisée. Je voudrais dire seulement qu’elle s’est déroulée sur deux plans : un plan purement imaginatif, presque mythologique. J’étais, comme dirais-je, comme engoncé dans une sorte de chape, de rêve, de mythe, d’histoires, celles que me racontait particulièrement mon grand oncle. Il y avait quelque chose de fabuleux dans ces récits. Et puis, la partie proprement réelle. J’étais un petit écolier chétif, j’étais aussi enfant de chœur, ayant été baptisé à l’âge de deux jours, tandis que la majeure partie de ma famille est musulmane. »
Pierre Amrouche : Pour moi, c’était avant tout mon père, un papa dirait-on. C’était un homme extrêmement attentif à ce que faisaient ses enfants, à ce que faisait la jeunesse en général d’ailleurs. Il était tendre. Il était câlin. On marchait main dans main dans les bois ou dans la rue. Il aimait chanter, il aimait rire, il aimait plaisanter. Tout cela c’étaient des moments de détente. Il avait une présence physique très forte. Il avait un physique imposant, des traits purs comme on en rencontre en Algérie. En même temps, je crois qu’il mettait autant de soin à exprimer sa pensée, par le verbe en français, qu’il mettait de soin à se mettre en valeur, à montrer son élégance. Les deux conjugués avaient certainement le don d’exaspérer beaucoup de gens, et surtout d’exaspérer les colons et tous les petits blancs qui disaient : mais qu’est-ce que c’est ce métèque qui veut nous donner des leçons aussi bien dans le port du tweed et de la cravate que dans l’usage de l’imparfait du subjonctif ?!
Fanny Jaffray : Il avait un usage de la langue française qui était parfait.
Pierre Amrouche : Oui, il parlait un français que seuls les étrangers peuvent parler. Les Français ne pratiquent pas cette perfection du français, en utilisant toutes les possibilités du vocabulaire, de la syntaxe. Ils en sont bien incapables, et aujourd’hui plus qu’hier où pourtant les gens parlaient mieux. Lui, il met un point d’honneur à être le meilleur. Et ça aussi ça agace.
Pour les Musulmans, arabes ou berbères, c’est une famille de « m’tournis », c’est-à-dire de renégats. Pour les Européens d’Algérie, ce sont de faux Français, des Français de seconde zone, qui seront toujours suspects de se retourner contre la France et d’avoir d’autres intérêts que ceux de la France. C’est une position extrêmement inconfortable dont il ne tirera que des problèmes, des malentendus toute sa vie.
Réjane Le Baut : Dès l’École normale de Tunis, où il est entré à quinze-ans, Jean Amrouche, pauvre, toute sa vie, il faut insister là-dessus, lisait la Nouvelle revue française, lisait Jacques Rivière, lisait les poèmes qui sont devenus se intercesseurs et son Panthéon. La poésie, c’était tout pour lui.
Fanny Jaffray : Il avait un usage de la langue française qui était parfait.
Pierre Amrouche : Oui, il rencontre un Arabe tunisien, qui s’appelle Mahmoud Reggui, qui sera vraiment son compagnon, et dont il deviendra le mentor. Reggui est fasciné par la personnalité de Jean Amrouche, à tel point qu’il finira lui-même par se convertir au christianisme. Ils échangent des lettres très souvent, ils parlent de religion mais ils parlent de sexe aussi, ils ont parfois des échanges assez crus. Ce sont deux jeunes gens engagés dans leur temps, qui de l’Amérique, etc., comme tous les gens rêvent. Mais Amrouche a certainement un ascendant sur lui.
Réjane Le Baut : Quand il est revenu à Sousse, il a eu la chance d’être nommé dans un collège ou un lycée, je ne sais pas, Armand Guibert, passionné comme lui de poésie. Ils ont pu échanger, ils se promettaient tous les deux d’écrire en poésie. La poésie était pour lui une réalisation.
Pierre Amrouche : Je pense qu’il a envie de composer une grande œuvre. Il se sent investi d’une mission. Il se sent déjà responsable de la culture berbère, il veut la faire briller. Il rencontre d’autres personnes à Tunis. Il y a Armand Guibert, bien sûr, qui sera son éditeur. Tous les intellectuels qui passent à Tunis viennent les voir, aussi bien des gens aussi curieux comme Robert Brasillach, qui rencontrent les jeunes poètes tunisiens, dont Jean Amrouche, il le cite dans Notre Avant-guerre [1]. C’est très éclectique, à cette époque-là, il n’a pas un engagement politique, il a un engagement littéraire.
Adieu tous mes amis vivants !Il n’est pas de minute qui m’aspire,Loin de vous.Celui que vous avez connu au temps de l’amourSe défaitComme la vague meurt au rivage désert.Assi longtemps que plonge le regardDans l’espace indolore,Aussi loin qu’il s’élance sur les dunes de sable,Il ne voit que la nuit dans un jour qui s’éteint :La nuit, la Mort en chacun instant donnéeEt la vie toute pareille.Celui que vous avez aimé aux jours vermeils,Quand le soleil dansait sur les plages,Celui-là même qui vous offrait son âmeEn un grand geste d’amour,S’effrite, chaux diluée, aux temps inexorable.Adieu, vous tous, enfants de mon âme violente !Je ne sais trop, aujourd’hui, que vous n’existiez pas.Mirages et tourbillons célestes au creux de mes entrailles,Vous fûtes un seul jour de gloire,Rayonnantes écailles !Tombées,Dissoutes, quand l’air cessa d’abreuver les chimèresQui fondirent ;Neiges splendidesRéduites à la boue uniforme de l’absence. [2]
Réjane Le Baut : Ce recueil exprime la déréliction, le malheur, la solitude - la solitude, c’est ce qui domine en tout - qu’il vivait en tant que jeune, et que vivent peut-être beaucoup d’autres adolescents, mais lui, ses conditions de vie expliquent ça : Algérien en Tunisie au milieu de Français. Ensuite, Étoile secrète, en 1937, il s’est retourné, - il est chrétien, profondément un esprit religieux, par le hasard de l’histoire il a été baptisé à deux jours, ses parents avaient été baptisés, c’est le problème du colonialisme qui explique cela – vers une poésie spirituelle. Il était très pratiquant. Quand il était par exemple à Versailles pendant sa préparation à l’École normale de Saint-Cloud, il allait à la messe le matin, il allait faire des retraites à Gentilly. Très profondément religieux, il a cru que cette poésie spirituelle tournée vers le religieux était son expression. Ces deux recueils-là marquent une évolution, un tournant, parce qu’il se rend compte que ses ambitions exprimaient l’amour : mon œuvre cela sera l’amour. D’autre part, exprimer l’Afrique, si je chante un jour ton poème, Afrique, il ne l’a jamais composé, et le tournant, cela a été le hasard de la radio. Je crois que, pour connaître Jean Amrouche, son itinéraire, c’est très important. Dès ses débuts, il y a les deux choses : il est poète peut-être, mais comme certains poètes, comme Victor Hugo ou René Char, les deux sont parallèles et conjoints.
Fanny Jaffray : Il y avait une dédicace, au début du recueil Cendres, il était écrit : « À ma mère, ce grand poète qui a eu la sagesse de ne pas écrire ». Pourquoi cette idée : est poète celui qui n’écrit pas ?
Beïda Chikhi : Il nomme là son attachement à la mère et à la source vocale de son expression. Il a voulu, selon moi, exprimer son attachement à l’expression orale, C’est l’oralité éminemment poétique qui a porté jusqu’à nous la langue berbère. C’est par l’oralité que la mémoire de l’histoire et de la culture berbères a résisté aux civilisations de l’écriture. Il a cherché plus tard à privilégier dans son travail l’oralité poétique qui demeure encore aujourd’hui une manière de résister, c’est une voix forte que l’on rend, par la poésie, de plus en plus performante. Il a su conserver, dans sa poésie écrite, les intonations et les rythmes qui avaient quelque chose à voir avec la voix, avec la musique de la voix. Il dit quelque part : « écrire est une perte de la voix ». Autrement dit, ce pays intérieur, tout en voix, tout en oralité, il avait envie de le préserver.
Fanny Jaffray : D’ailleurs cette dédicace a disparu dans la réédition de Cendres, à L’Harmattan en 1983. Pourquoi a-t-elle disparu cette dédicace ?
Beïda Chikhi : Je n’avais même pas enregistré cette disparition. J’avais été impressionnée par cette dédicace et je l’ai gardée en mémoire comme un élément décisif de la démarche de Jean Amrouche entre l’oral et l’écrit, entre la trace et l’effacement. On peut effacer des mots, une phrase, ça reparaît toujours si le sens en est fort. C’est tout le principe du palimpseste. Autrement dit, n’essayons pas de faire disparaître une idée, une pensée, une langue, parce qu’elle revit sous une forme ou sous une autre. Je n’avais pas moi-même fait attention à la disparition de cette dédicace, comme quoi on relit souvent le texte que l’on a dans la tête pour peu qu’on l’ait lu la toute première fois dans sa totalité et avec une certaine motivation. Cette dédicace s’est disséminée dans tous ses écrits ; elle explique la part importante que prend la voix dans ses discours politiques et ses entretiens radiophoniques. Évidemment, pour répondre à votre question, je ne suis pas dans le secret des éditeurs, je ne sais pas pourquoi cette dédicace a disparu, mais l’édition étant liée à l’écriture, cette dédicace a peut-être été jugée contraire aux intérêts de la diffusion. Autre hypothèse, l’effacement a été involontaire ou inconscient…
[Chant berbère : Taos Amrouche]
« Jean Amrouche : Toute mon enfance, a été en quelque sorte baignée par un double chant : le Plain-chant, que je pratiquais comme enfant de chœur, et puis le chant kabyle, le chant berbère, que j’entendais chanter chez moi, particulièrement par ma mère. Ces espèces de complaintes, de mélopées, profondément mélancoliques, ces poèmes très nus, qu’on ne peut pour ainsi dire supporter sans la musique qui en est à la fois la chair et l’âme, cette espèce de musique presque déchirante, où la joie même est chanté sur des thèmes qui a une oreille étrangère paraissent tristes, c’est cela qui m’a profondément baigné et qui peut-être a fait de moi un poète. »
[Chant berbère : Taos Amrouche]
Fanny Jaffray : Dans la préface de Chants berbères de Kabylie, il explique qu’il entre dans la tradition de ses ancêtres et qu’il respecte chez ses ancêtres ce qu’il appelle le don de Assefrou. Qu’est-ce que c’est que le don de Assefrou ?
Tassadit Yacine : Assefrou, cela veut dire le poème. Cela vient de frou, qui veut dire délier, dénouer, élucider, rendre clair. Donc, le poème est quelque chose que l’on peut ne pas comprendre. Les vrais poèmes, les vrais poètes, c’étaient des initiés. La poésie, c’est comme dans la tradition latine, cela tient du charme, au sens de l’enchantement, de l’envoûtement. Voilà ce qu’il entendait par Assefrou.
[Chant berbère : Taos Amrouche]
Beïda Chikhi : Les Chants berbères de Kabylie, c’est aussi une manière bien à lui d’être en littérature. C’est le traducteur qui se manifeste là, l’interprète de ce pays intérieur qu’il sent s’éloigner. Il se réalise dans la traduction comme personnage de sauveur et de passeur, répétant le geste de ses ancêtres : rattraper, presque par réflexe, ce qui est en train de se perdre. La transcription et la traduction des chants arrivent comme un prolongement de la fonction vitale de la culture. Il prétend ainsi capter : « la présence d’un pays intérieur, dont la beauté ne se révèle que dans la mesure où l’on sait qu’on l’a perdu ».
[Chant berbère : Taos Amrouche]
Fanny Jaffray : Donc, il y a d’abord une transcription, puisque c’est une tradition orale et une traduction ?
Tassadit Yacine : Oui, que Taos va compléter et chanter. Dans le même ordre d’idée chez lui, c’est comment montrer que dans l’Afrique du Nord il y avait des talents, il y avait une culture, une personnalité que l’on ne pouvait pas écraser. Donc, montrer que ces pièces-là reflétaient une identité, une culture. Il va d’ailleurs, je mets ça entre parenthèses, je le tiens de Mouloud Mammeri, montrer ça très jeune à Breton en disant : regardez comment est faite la poésie kabyle, et Breton aurait trouvé cela extraordinaire, je ne sais pas comment cela va être exploité, mais sa démarche était celle-là.
[Chant berbère : Taos Amrouche]
Réjane Le Baut : Il a tellement conscience de la valeur de ce patrimoine qu’il met ces chants berbères sur le même plan que des textes de Verlaine, de Rimbaud, ou des Lieders de Schubert. Il veut même il l’écrit dans sa préface - dans la préface écrite, ce n’est pas à la radio - fait un appel pour que le Musée de l’homme les enregistre parce qu’il voit qu’ils sont en passe d’être perdus. Ce que l’on appelait le folklore et qui était assez méprisé à ce moment-là, peut de personne s’y intéressait à ce moment-là, donc il fait cet appel.
[musique]
« Aux Algériens on a tout pris, la patrie avec le nom, le langage avec les divines sentences de sagesse qui règlent la marche de l’homme depuis le berceau jusqu’à la tombe, la terre avec les blés, les sources avec les jardins, le pain de bouche et le pain de l’âme, l’honneur, la grâce de vivre comme enfant de Dieu frère des hommes sous le soleil dans le vent la pluie et la neige. On a jeté les Algériens hors de toute patrie humaine, on les a faits orphelins, on les a faits prisonniers d’un présent sans mémoire et sans avenir, les exilant parmi leurs tombes de la terre des ancêtres de leur histoire de leur langage et de la liberté. »
Pierre Amrouche : Ce qui était frappant, sans doute, c’était la misère qui régnait en Afrique du Nord, en Algérie en particulier, la misère du peuple, non pas que les Français d’Algérie aient été tous des gens extrêmement riches et à l’aise financièrement, pas du tout, c’est une légende. Il y avait aussi un petit peuple Pied-noir extrêmement malheureux et c’est celui dont parle Camus ou Jules Roy. Mais lui finalement il ressentait avant tout les malheurs des sa communauté, dans les villages de Kabylie on pouvait mourir de faim sous la colonisation française. Très vite, il se sent directement concerné puisque quand il revient pour des vacances en Kabylie, - puisque comme vous le savez ils habitent en Tunisie, depuis environ 1909-1910 – il est confronté à ces problèmes permanents de nourriture. Plus grave encore, au moment de la guerre, tout le monde est soumis à des restrictions alimentaires les indigènes ont trois fois moins que les citoyens français, et ça il le voit et ça le met en colère en permanence.
« Jean Amrouche : Je suis profondément Français. Et en tant que Français, en tant que citoyen français, c’est mon droit et c’est mon devoir de prendre position sur les problèmes politiques français. Mais je suis en même temps et indivisément Algérien, et par conséquent ma solidarité avec le peuple algérien, en lutte pour la conquête de sa liberté et de son indépendance, est une solidarité entière. »
Pierre Amrouche : On peut dire qu’il est engagé politiquement vis-à-vis de l’Algérie. À partir de 43 à peu près, à partir du discours de Constantine de de Gaulle, et à partir de ses années algéroises, où il rencontre de Gaulle plusieurs fois, soit avec André Gide, soit Max-Pol Fouchet, où déjà il expose au général de Gaulle le problème des populations indigènes d’Algérie sous la domination coloniale, en lui expliquant que cela ne peut pas durer, qu’il y aura forcément un éclatement, des affrontements, ce que de Gaulle comprend très bien. Il le comprend pour deux raisons, d’abord sur le plan humain et aussi sur le plan économique. Il voit très bien qu’une population de quinze millions d’habitants, qui fait tant d’enfants par foyer, au bout de quelques années sera plus que majoritaire sur le territoire de l’Algérie et que la France perdra le contrôle de cette région et que cela compliquera amplement les choses. De Gaulle a plusieurs raisons de ne pas souhaiter au fond de lui-même que l’Algérie reste attachée à la France, en même temps, c’est un humaniste, il voudrait que les Algériens deviennent des citoyens à part entière, donc c’est conflictuel et compliqué.
Debout palmiersDans le vent d’ouest qui vous jette vers l’orientNous avons faim dans la têteEt nous lançons nos mains et nos regardsPar-dessus la mer étaleAux millions d’écailles d’orVers un rivage futurUne ligne indéciseUn contre-jour du soleil levant.Nous avons faim.Pas de blé, pas de chair, pas de fruits.L’eau qui gonfle vos barragesEt vos fleuves artificiels,Tous vos canaux dans les cotonniers,Nous n’en voulons plus.Nous avons faim et soifD’un amour humain.Ne nous parlez pas de Dieu,C’est inutile.Vous mentez.Pour parler de lui sans mensonges,Il faut d’abord être un homme.Et vous n’êtes plus des hommes,Mais des machines effroyables d’intelligenceAu service du meurtre.
Fanny Jaffray : Il y a un événement qui sonne comme un coup de tonnerre, le 8 mai 45, les émeutes qui ont lieu à Sétif mais aussi ailleurs en Algérie.
Pierre Amrouche : C’est un épouvantable massacre de femmes, d’enfants de vieillards, etc. Il se trouve qu’à Guelma, une ville de l’Est algérien, plusieurs qu’il connaissait, des proches, presque des gens de sa famille, à savoir les deux frères et la sœur de Marcel Mahmoud Reggui, sont pris dans la répression et fusillés d’une façon ignoble dans un commissariat de police ou une gendarmerie, et cet événement vient ruiner toute espérance, s’il en avait vraiment conservé, d’une paix et d’une unité des populations d’Algérie, population indigène et population française.
Fanny Jaffray : Est-ce qu’il croyait fondamentalement que de Gaulle allait être la personne qui allait permettre à l’Algérie indépendante ?
Pierre Amrouche : Je crois qu’il l’a cru dès le départ d’autant plus que de Gaulle l’avait chargé, officieusement, d’être un ambassadeur entre lui-même et le gouvernement français et le Gouvernement provisoire algérien. Il était chargé de mission, il faisait, je me souviens bien, des allers-retours entre Paris, Genève, l’Italie, Tunis, le Maroc, le Caire, pour rencontrer les dirigeants du FLN et essayer de trouver des solutions pour un accord. Finalement, indirectement il aura joué un certain rôle dans l’aboutissement des Accords d’Évian.
Tassadit Yacine : Je pense qu’effectivement c’est dans l’engagement qu’il va réellement se retrouver lui-même. C’est là qu’il va réaliser ce pour quoi finalement il avait fait tout ce cheminement, c’était se consacrer à dénoncer l’injustice, les inégalités sociales, politiques, économiques, etc. Ceci dit, ce n’est pas sans contrepartie, il va le payer très, très, très cher !
Pierre Amrouche : Évidemment, il y a déjà beaucoup d’articles qui sont refusés, à commencé par un des premiers qu’il écrit à la fin de la guerre, qui s’intitule L’Algérie restera-t-elle française ?, ça évidemment c’est un titre qui ne passe pas, même la presse de gauche a peur de publier un article pareil, ils ont peur de représailles de la part du grand colonat ou même du gouvernement. Donc, il a ce problème-là, qu’il rencontrera souvent. Au fil du temps beaucoup de ses articles seront refusés, même par Le Monde. Finalement cela sera parfois de tous petits hebdomadaires qui auront le courage de publier ses articles très engagés. Il aura aussi des problèmes avec le pouvoir politique puisqu’il sera exclu de la radio par Michel Debré. C’est permanent, je me souviens bien que dans mon enfance, à peu près chaque semaine, il y avait un vieil ami ou quelqu’un qui refusait de nous parler parce que l’engagement politique devenait trop fort, était beaucoup trop en conflit avec ce que les Français de France, a fortiori les Français d’Algérie pouvaient admettre de la part d’un Français, entre guillemets.
Fanny Jaffray : Au sein même de votre famille, l’engagement de Jean Amrouche a créé des tensions, pire que des tensons des conflits.
Pierre Amrouche : Il faut dire que pour ne rien simplifier, il avait épousé, à Tunis, une de ses collègues, professeur de lettres classiques, Suzanne Molber (incertitude sur l’orthographe du nom), qui était, elle, fille d’une vieille famille algéroise, une famille qui était arrivée en Algérie à la fin de 1840. Cette famille pied-noir, française d’Algérie, même si elle était libérale, l’idée de l’indépendance de l’Algérie, l’idée de livrer l’Algérie aux Musulmans leur était tout à fait insupportable. Les prises de positions de Jean Amrouche dans la presse vont faire que très vite cette famille, ma famille maternelle, refuse d’être en contact avec nous, on les verra plus à partir de 1956 jusqu’en 1962, date de la mort de mon père. Donc, il y avait déjà au sein de la famille ces grandes ruptures.
Tassadit Yacine : Je crois qu’à partir de la situation algérienne, et tunisienne parce que même à propos de la Tunisie il a écrit des textes, c’est comprendre la domination d’une part et la colonisation, qui n’est pas simplement le fait de la France, je trouve cela très fort. Et il va distinguer justement ce qu’il va appeler la France d’Afrique, la France colonisatrice, raciste, etc., de la France d’Europe, tout ce que la culture française, les lois de la République, ce qui représente les valeurs françaises, celles-là il les revendique et il les faits siennes. Et c’est au nom de ces valeurs qu’il va rejeter l’autre France.
Fanny Jaffray : Est-ce que cela correspond à la dichotomie entre la France réelle et la France idéale, rêvée comme l’article qu’il a écrit dans Le Monde en 1958 ?
Tassadit Yacine : La France comme mythe et comme réalité, bien sûr. Il va distinguer la France réelle de la France mythique. Tous les colonisés de cette époque, toute l’élite de cette époque s’est nourrie des valeurs de cette France mythique. Amrouche, comme toute cette génération, s’est senti en quelque sorte trahi par ce qu’il appelle la France d’Europe ou la France mythique.
Réjane Le Baut : Je me suis aperçue, au moment de la salle Wagram à Paris, de la réunion organisée par le Comité des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Algérie [3], il y avait à la tribune Robert Barrat, Aimé Césaire, Alioune Diop, André Mandouze, qui est arrivé tout excité d’Alger, Jean-Paul Sartre et Jean Amrouche. Jean Amrouche, je ne sais pas si j’ai remarqué son nom tout de suite, je le connais parce que j’avais entendu les entretiens Gide, Claudel, notamment et tout d’un coup j’ai fait le rapport avec ce Jean Amrouche que j’avais entendu en 51, une très belle voix, musicale, je dirais en premier, c’était le même homme, je n’en doutais pas du tout. Il a parlé, et là il y a quelque chose d’assez extraordinaire qui s’est produit, quand il a dit : « Je suis Kabyle et chrétien ». Il y a eu des hués dans la salle, moi, je n’ai pas compris du tout d’où venaient ces hués, la salle était comble. Il y avait eu des applaudissements, il y avait des hués, sa voix s’est arrêtée, je n’ai pas vu, j’étais trop loin placée pour voir s’il avait les yeux embués de larmes, mais sa voix était brisée, il s’est arrêté, et il a repris avec le (manque un mot) de l’angoisse, il a poursuivi son discours. À ce moment-là, j’ai compris que l’intellectuel que je connaissais par une quinzaine de références dans le Journal de Gide, je ne m’étais pas soucié de savoir qui il était, c’était le même homme.
Fanny Jaffray : Le même homme en effet est à la fois un poète, un militant et un ami fidèle. Pendant la guerre il noue une amitié très importante avec André Gide, qu’il admire par-dessus-tout depuis l’adolescence, et avec qui il travaillera à faire vivre la critique littéraire.
Pierre Amrouche : Il écrit très tôt à André Gide, je crois que les premières lettres qu’il lui envoie c’est dans les années 27-28. C’est son grand écrivain, c’est celui qui lui répond le plus. Il écrit aussi à Claudel et d’autres grands écrivains français, mais celui avec qui il a très vite une correspondance, celui qui est sans doute séduit par sa personnalité, c’était André Gide. Ils correspondent pendant des années. Lorsque Gide sent qu’il doit quitter la France occupée, parce qu’on commence à lui faire des problèmes politiques ou pour son homosexualité, mon père et ma mère lui propose de venir les rejoindre à Tunis où ils peuvent le loger ou lui trouver un point de chute. A ce moment-là ils ont un compagnonnage assez proche, et lorsqu’André Gide quitte Tunis pour aller à Alger, retrouver tout le milieu gaulliste, il appelle Jean Amrouche à Alger et il lui présentera le général de Gaulle.
Fanny Jaffray : Donc, Jean Amrouche a en la personne de Gide une sorte de père spirituel.
Pierre Amrouche : Il a certainement un père spirituel, en même temps pour André Gide, il sera aussi l’ami très proche des dernières années d’André Gide et une sorte d’aiguillon qui va le pousser à encore écrire, à encore faire des choses à un âge où Gide est souvent fatigué, souvent malade et n’a plus tellement envie de paraître. C’est avec André Gide qu’il va fonder à Alger la revue l’Arche, avec Jacques Lassaigne. L’Arche qui vivra quelques années, difficilement. L’Arche qui au départ était une revue qui voulait concurrencer la RNF collaborationniste puisqu’elle a été dirigée par Drieu La Rochelle.
Fanny Jaffray : À quoi correspond chez Jean Amrouche, la volonté par exemple de devenir interviewer, homme de radio, d’aller interviewer les grands noms de son époque qu’il admirait ?
Tassadit Yacine : Il ne faut pas oublier que Jean Amrouche a commencé à faire de la radio déjà en Tunisie, en 1937, son ambition était d’expliquer la France aux Nord-africains, éviter à tout prix l’affrontement entre les deux communautés. Ensuite, il va vraiment devenir chroniquer à partir du moment où Alger est devenue la capitale de la France libre, il va rendre compte de ce qui se passait sur le front. Il va défendre pieds et poings liés la France dominée par l’Allemagne. Pour lui, c’est une suite logique, il va défendre la France contre l’Allemagne et il va défendre après l’Algérie contre la France. La radio, il était très à l’aise, c’était une voix extraordinaire, on a encore des…
Fanny Jaffray : De magnifiques archives.
Tassadit Yacine : Et quand il va expliquer la France aux Français, comme il le disait bien, c’est-à-dire faire en sorte que la littérature soit à portée de main, que la population française qui sort de la guerre, qui ne peut pas avoir un livre, c’est ce qu’il dit, qui ne peut pas acheter de livres parce que c’est très cher, lui s’était donné pour objectif d’effacer ce fossé qui existe entre le savant et la population, comment essayer de les rapprocher si ce n’est par le biais de la radio. Il était vraiment habité par ce souci des pauvres Français complètement écrasés par la guerre pour leur restituer une partie de leur patrimoine. Comment le faire de façon massive, si ce n’est par la radio. C’est là qu’il dit : « je crois que je suis comme les riteurs africains », je trouve ça d’une beauté extraordinaire ! C’est là que le legs originel revient à la surface.
« Jean Amrouche : Ces impromptus, ces entretiens littéraires sont nés du hasard, d’un désir tout amical et d’une gageure qu’il fallait tenir, non pas moi mais Gide. C’était dans l’hiver de 1948, Gide était fatigué, et comme je jouais avec lui aux échecs à peu près tous les soirs, l’idée m’est venue de remplacer l’échiquier par un micro et de remplacer le déplacement des pions par un échange de paroles. Il y avait pour lui là l’occasion de faire quelque chose de neuf et d’user pour la première fois, dans un certain sens et d’une certaine manière, d’un certain instrument de communication. »
Pierre Amrouche : Ces grands entretiens radiophoniques, Gide n’y était pas favorable parce qu’il avait beaucoup de mal à parler, il était timide, le micro le déranger, il bafouillait beaucoup. Et de tous les grands entretiens radiophoniques, ceux avec Gide sont certainement les moins plaisants à écouter puisqu’il n’était pas un bon interlocuteur. Mais c’est en tout cas une découverte cette méthode d’interviewer les gens. Jean Amrouche avait une connaissance extrême des textes des gens qu’il allait interroger. Lors des entretiens on sourit parfois quand il dit à un auteur : « mais vous avez écrit ça », lui dit : « pas du tout » et lui, lui dit : « mais si, pardon, 1928, a tel endroit… », « ah, vous avez raison effectivement » Il connaissait très bien les textes, il était capable de lire dix fois Le soulier de satin pour pouvoir préparer un entretien parfait, tant avec Claudel, Gide, Ungaretti ou Mauriac, ce principe de l’entretien radiophonique il le maitrise parfaitement, on dit que c’était le maître en maïeutique pour accoucher les âmes des écrivains.
« Jean Amrouche : Les règles de ce jeu sont en apparence très simples. Il s’agit tout simplement de s’assoir de part et d’autre d’un micro, de bavarder quelques instants sur des sujets qui généralement sont forts éloignes du sujet qui ferra la matière de l’entretien, sujet que d’ailleurs on ne connaît pas puisque nous devons être toujours dans l’improvisation, avec les imites que ce genre peu comporter, non pas sur le plan de la forme mais sur le plan de la matière qui sera agitée par la suite, puis partir à l’aventure. »
Beïda Chikhi : Les entretiens littéraires radiophoniques sont intéressants justement par cette démarche entamée dans la poésie, consolidée dans l’essai, L’éternelle Jugurtha, et testée dans les entretiens. Dans ces entretiens, on voit bien comment Amrouche se construit à travers les autres, par l’écoute, par la connaissance des grands textes français, en collectant les moindres miettes de leur discours, en les capitalisant et en les utilisant à son propre bénéfice. C’est ainsi qu’il devient performant dans l’érudition, dans l’éclat de la voix, mais également dans la conduite de l’entretien ; il fertilise l’entretien à son propre profit. Ce qui va le servir, c’est sa vision personnelle de l’échiquier qui lui a donné l’idée des entretiens alors qu’il jouait aux échecs avec André Gide. Il écrit dans son Journal : « Il me faut constamment un public, un miroir sur quoi essayer ma pensée et mes phrases, où trouver les tremplins successifs que n’offre pas la solitude. » Á écouter les divers enregistrements, on s’apercevrait qu’Amrouche utilise à l’infini des virtualités d’énonciation, qui font entendre les voix de son désir ; mais on se pose encore la question : comment a-t-il vu cet échiquier comme une possibilité d’affirmation de soi et, dans le même temps, de sortie l’ombre des maîtres ?
« 1951, Speakerine : Le programme national vous prie d’écouter les mémoires improvisées de Paul Claudel, recueillies par Jean Amrouche. Jean Amrouche : Mesdames, messieurs, me voici bien intimidé, car si c’est un honneur insigne, ce n’est pas une petite épreuve que de se trouver face-à-face avec le plus grand poète vivant, et l’un des plus grands de notre histoire. Durant plus de vingt cinq ans, Paul Claudel, qui est ici, en face de moi, ne fut qu’un nom de trois syllabes et un personnage mythique, inaccessible que l’imagination s’épuisait à poursuivre à travers le temps, les continents et les océans. Et tout à coup, il est là et il faut lui poser des questions, non pas mes questions mais celles que chacun de vous aimerait lui poser. Et il faudra l’inciter, l’exciter, le provoquer, user avec lui de tous les moyens propres à forcer ses souvenirs. Il faudra se montrer insinuant, subtile, parfois même brutal ou indiscret, pour le contraindre à répondre sur le champ, sans avoir presque pris le temps de réfléchir. Comme vous voyez, il s’agit d’un jeu, certes, d’un jeu passionnant et difficile auquel nous voudrions vous associer, d’autant plus difficile que la règle en est simple. Rien ici n’est préparé ou peine. Les joueurs ne sont pas de mèche et Paul Claudel improvisera entièrement sa partie. Quant à moi, ce petit discours terminé, je pourrai certes me reporter à un canevas sommaire mais je sais bien que nous ne le suivrons pas. Et maintenant, c’est vers vous, Paul Claudel, que je me tourne. Paul Claudel : L’écrivain n’est qu’un intermédiaire entre l’œuvre et le public. Le public est une chose vague, n’est-ce pas, qu’appelle-t-on public ? Est-ce le public immédiat ? Est-ce celui qui aura dans l’avenir ? Est-ce des anges, comme dit Saint-Paul ? Enfin, tout ce qu’on voudra, c’est quelque chose de très vague. C’est simplement l’extérieur, c’est un appel à l’écoute, si vous voulez. »
Fanny Jaffray : Est-ce qu’il faut donc comprendre que les entretiens radiophoniques sont un prolongement de l’activité littéraire de Jean Amrouche ? Est-ce qu’il s’agit d’une création littéraire à deux voix, d’une performance, comme vous l’avez dit ?
Beïda Chikhi : Oui bien entendu, mais je crois que c’est surtout une autre façon, une de plus, de retrouver l’oralité, de retrouver cette aisance qu’il a acquise dans la pratique orale, quotidienne, pratique culturelle qui lui vient de sa famille mais également de ses ancêtres. L’entretien, c’est aussi une manière d’imposer sa propre voix comme l’expression de propre culture. Il y a dans sa conduite de l’entretien quelque chose qui relève d’une volonté de rendre audible et visible une culture orale qui a été dénigrée et dévalorisée. On en revient à chaque fois à cette idée que la civilisation de l’écrit a essayé de détruire l’oralité, et que cette oralité prend sa revanche. C’est valable d’ailleurs pour tout le continent africain. Il l’explicite ainsi « J’étais une voix collective. Rien de plus. Ma voix demeure cachée encore, inentendue. L’heure va sonner. Serait-ce mon heure ? Je ne sais. Je crois être autre chose que Rivière. Mais il va falloir sortir de l’ombre des maîtres ».
Fanny Jaffray : Quel est le critère de choix de ces écrivains ? Comment Jean Amrouche procédait-il ? Comment faisait-il ces entretiens ?
Beïda Chikhi : Le choix était déterminé d’abord par la disponibilité de ces écrivains, par la qualité de leur écoute, très certainement par leur ouverture intellectuelle, par exemple, l’ouverture d’un Claudel, de quelqu’un comme Ungaretti qui avait à peu près le même rapport à la terre natale et à l’exil, de Saint-Exupéry et d’Henri Bosco… Il fallait au commencement des affinités, une possibilité de dialogue, et le dialogue était important pour Amrouche parce qu’il a fondé sa stratégie de sortie de l’ombre ; il a conçu tous ces fragments d’œuvres comme des lieux de dialogue. Même la poésie mystique, ce soi-disant dialogue avec Dieu, était en fait un dialogue avec la parole dominante, Dieu c’est la parole dominante, l’autorité en quelque sorte. La compétence critique, la performance de la voix et de la conduite du dialogue littéraire, fertilisent l’entretien dans le sens d’une création verbale originale, immédiatement offerte au public et dans un instantané qu’il maîtrise déjà très bien.
« Speakerine : La radio diffusion télévision française, présente « Des idées et des hommes », une émission de Jean Amrouche. »
Fanny Jaffray : Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s’est déroulée l’exclusion de Jean Amrouche de la radio ?
Réjane Le Baut : Il a été renvoyé en 59. Sur interpellation à l’Assemblée nationale du député Legendre, sur ordre de Michel Debré, il a été renvoyé de la radio, alors qu’il avait déjà créé son émission hebdomadaire : « Des idées et des hommes », 200 à 300 sujets collectés. Il avait fait Les grands entretiens, il avait quand même un nom à la radio française. Il en a été renvoyé. Ce qui l’a fait le plus souffrir - c’était son gagne pain cette radio, le titre de directeur général adjoint, c’était un grade - c’est son émission « Des idées et des hommes », il dit : ils n’oseront pas, il revient de voyage, ils ont osé, on lui supprime cette émission.
« Taos Amrouche : Jean Amrouche mon frère, le chef de tribu, c’est à midi quinze, le lundi 16 avril, le lendemain des rameaux qu’il nous quitta. À midi quinze, heure à laquelle il aimait à rassembler les siens, à préparer de ses mains princières un couscous vermeil pour ses amis et ses proches, heure à laquelle il se mettait à l’écoute du monde avec une douloureuse attention. Il est mort en montant. D’autres que moi parleront de son rôle de médiateur dans cette lutte ardente devenue son champ de combat, il s’y est épuré, je le voyais de jour en jour se dépasser, il se magnifiait, il s’y est pleinement accompli, malgré son regret de n’avoir pu écrire se poèmes et récits qu’il eut aimé laisser à ses enfants. Il se savait la victime élue. »
Pierre Amrouche : Les Accords d’Évian doivent être signés en mars 62, de Gaulle lui envoi une lettre d’ailleurs à ce moment-là, lui disant : « je sais que vous êtes très, très malade mais au moins la signature des Accords d’Évian devraient vous apporter un peu de réconfort et un d’espoir. Il décède en avril 62.
« Taos Amrouche : L’ultime moment était venu. Mue par une force obscure, j’ai posé ma tête près de la sienne sur l’oreiller et je lui ai dit en kabyle, consciente de représenter les absents, la terre natale, les tombes ancestrales qui ne l’abriteraient pas, je lui ai dit : El Mouhouv bien aimé, avances sans crainte. Tu es dans ta maison, et ta maison est pleine. Ta femme est là, ta fille ainée est là, ta cadette est là, ton petit garçon est là. Ton frère René marche vers toi. Et moi, Taos, moi ta sœur, je suis là et notre mère est aussi là avec toi. Ne crains rien. Avance. Tout ton pays est avec toi, tout ton pays est derrière toi. »
Beïda Chikhi : Il a touché un peu à tous les genres et laissé transparaître ses véritables destinataires. Il y a eu un moment privilégié pour la poésie, le moment privilégié de l’autoportrait, et puis est arrivé celui des articles journalistiques et des discours politiques, et là je crois qu’il a montré sa puissance de lutteur politique. Ensuite, sont arrivés les réflexions diverses à travers les entretiens, les correspondances et le Journal. Il a eu des réflexions formidables sur le bilinguisme, sur le transfert d’une culture à une autre, sur la croyance et la foi religieuse, etc. Tout ce qu’il a écrit, tout ce qu’il a dit, est utilisé aujourd’hui par les jeunes penseurs, les jeunes romanciers, les jeunes enseignants maghrébins, (jeunes entre guillemets évidemment). Toutes les questions, toutes les problématiques qui sont traitées aujourd’hui en termes d’épistémologie par la critique spécialisée étaient déjà dans Jean Amrouche. Il a suivi le fil de l’histoire en adoptant les modes d’expression en fonction de l’urgence du moment. Il a su s’adapter et réagir très vite aux situations les plus complexes, et en cela il est moderne et contemporain, d’où l’intérêt de l’écoute telle qu’il a su la pratiquer.
Fanny Jaffray : C’était « Jean Amrouche cet inconnu »
« El hiva, el hiva, c’est de la que vient son nom, El Mouhov, c’est-à-dire le prestigieux. »
Fanny Jaffray : Avec Pierre Amrouche, Tassadit Yacine, maître de conférences à l’EHESS, éditrice du journal de Jean Amrouche, Réjane Le Baut, auteur de Jean El-Mouhoub Amrouche : algérien universel et Beïda Chikhi, professeur de littérature française et francophone à l’Université Paris IV-Sorbonne, auteur de Littérature algérienne. Désir d’histoire et esthétique. Lectures de : Laurence Bourdil. Musique originale : Tarik Ziour. Les voix de : Jean Amrouche, Fadhma Aïth Mansour, Paul Claudel et Taos Amrouche. Mixage, Jean-Michel Bernot. Attachée d’émission, Laurence Jennepin.
Bibliographie, signalée sur le site de l’émission :
– Accès à 4 fiches-œuvre
– Jean El-Mouhoub Amrouche 1906-1962 : mythe et réalité, Réjane Le Baut, Éditions du Tell, 2005
Entretiens avec Jean Amrouche (1949) /André Gide, Radio France - INA (Bry-sur-Marne) « Grandes Heures », 1997.
Présentation de l’éditeur : Face à un Amrouche questionnant, un écrivain désarmé et désarmant oscille entre ce qu’il appelle « le risque de fatuité », et une autocritique permanente d’une œuvre dans laquelle « la musique des pensées nait de l’harmonie des mots ».
Diffusé sur la chaîne Nationale en 1949.
François Mauriac. Souvenirs retrouvés : entretiens avec Jean Amrouche, sous la direction de Béatrice Avakian, édition Fayard - INA, 2001 Col. Vives voix, 314 p. ISBN-10 : 2213009929, ISBN-13 : 978-2213009926
4e de couverture : En 1952, lorsqu’il s’entretient avec Jean Amrouche sur les ondes de la R.T.F, François Mauriac a 67 ans. Il regarde la foule de personnages sortis de lui, et cependant derrière lui. Il regarde sa vie, évoque sa carrière, dont une part est cependant encore à venir. Où se trouve la vérité Mauriac ? Dans l’autobiographie qu’il n’a pas écrite ? Dans ses fictions ? Chez Thérèse Desqueyroux, dans Le nœud de vipère ? Dans ces entretiens, faits de souvenirs réels, retrouvés, de bribes de romans redécouverts. Souvenirs retrouvés : un livre pour trouver François Mauriac, le retrouver.
– Jean El-Mouhoub Amrouche : Algérien universel, Réjane Le Baut, Ed. Alteredit, 2006, Col. Ailleurs et ici, 514 p., ISBN-10 : 2846330956, ISBN-13 : 978-2846330954.
4ème de couverture : « Je suis Jean et El-Mouhoub, non pas successivement, tour à tour, mais simultanément, en même temps, comprenez-vous. ...Je voudrais essayer d’expliquer cela. Pourquoi, parce que c’est très important, pour moi d’abord, pour vous aussi. Car beaucoup d’autres sous le ciel sont en même temps Jean et El-Mouhoub. Il y en a des blancs, des noirs, des jaunes, petits, grands, larges ou étroits. ... Alors, si vous voulez bien admettre que les choses vraiment graves sont celles-là seulement qui peuvent donner la mort, vous comprendrez que cette question soit très grave, aujourd’hui et pour longtemps encore. »
Jean El-Mouhoub Amrouche (1906-1962), le Berbère, épousa la France mythique, celle des droits de l’Homme. Sa pensée et son action se firent l’écho de celles de Charles de Gaulle qui proposa « l’évangile de la fraternité des peuples et de l’égalité des chances ». Il avait l’âme d’un Jugurtha. Plus de quarante ans après sa mort, son chant profond résonne encore, et sa figure tutélaire est aujourd’hui emblématique pour tous ceux, exilés ou non, qui veulent être des « pierres vivantes » de la Cité des hommes.
– Jean-El Mouhoub Amrouche : Journal 1928-1962, Jean-El Mouhoub Amrouche, édition Non Lieu, 2009, édité et présenté par Tassadit Yacine Titouh
4ème de couverture : Né en 1906 à Ighil Ali, en Algérie, dans une famille kabyle de la vallée de la Soummam, Jean El Mouhoub Amrouche a passé sa jeunesse à Tunis. Ses parents s’étaient convertis au catholicisme avant sa naissance et avait adopté la langue française, langue qui serait celle du poète. Sa mère, Fadhma Aït Mansour a laissé des mémoires : Histoire de ma vie (Maspéro, 1968). Sa sœur, Taos Amrouche, a été la première romancière algérienne de langue française.
Après des études brillantes en Tunisie et en France, il fut successivement professeur, poète (Cendres, Étoile secrète, Chants berbères de Kabylie...), critique littéraire, animateur de revue (L’Arche, créée, avec le soutien d’André Gide et éditée par Edmond Chariot), écrivain engagé ( « L’Éternel Jugurtha » ), intervenant à Radio-France Alger pendant la guerre, puis à Radio-France Paris. Il eut alors l’occasion de s’entretenir avec tous les grands noms de la littérature et de la philosophie. Certains de ses entretiens (avec Mauriac, Gide, Claudel...) sont restés célèbres et édités sur disques. Il fut chassé de Radio-France par Michel Debré après avoir servi d’intermédiaire entre les instances du FLN algérien et le général de Gaulle dont il était un interlocuteur privilégié. Militant de l’indépendance algérienne, il est mort d’un cancer le 16 avril 1962, quelques jours après la signature des accords d’Évian.
Son Journal, écrit entre 1928 et 1962, et demeuré inédit, comporte une auto-analyse très sensible, un florilège des auteurs qu’il reconnaît comme ses inspirateurs ou ses intercesseurs. On y trouve aussi des croquis de personnages, des brouillons de lettres, des ébauches d’articles, l’évocation de ses amis (Jules Roy, Gide, Camus...). Il retrace la vie d’un homme, d’un poète, d’un intellectuel engagé dans un combat pour faire connaître et reconnaître les deux composantes, kabyle et française, d’une personnalité complexe, voire contradictoire. Trajectoire singulière d’un homme qui laisse derrière lui un précieux testament, celui de la justice, de la double culture et de la tolérance.

