Le bon plaisir d’Hubert Curien
Michèle Chouchan : Polytechnique ou Normale Sup’ ? Deux voies s’ouvraient à Hubert Curien [1]. Il a choisi la première, c’est donc avec ce polytechnicien à l’humour calme, sorti serein de son poste de ministre, que nous vous proposons de passer l’après-midi.
Hubert Curien : Un jour, mes parents, qui n’étaient pas riches, mais pas pauvres non plus, se sont dit, dans les débuts des années 30 ; on est moderne, on achète un poste de radio. L’électricien du village n’en croyait pas ses yeux, c’était le premier poste de radio qu’il vendait. Il y avait bien d’autres postes de radio dans le village, mais chez les gens riches, qui n’achetaient pas au village, quand même. L’électricien fait venir un poste, et vient nous l’installer. Alors, là, voir ce truc avec les lampes, ça m’a fasciné.
Michèle Chouchan : Vous aviez quel âge [2] en 30 ?
Hubert Curien : 7-8 ans. Deuxième événement, qui pour moi a été vraiment très marquant, nous étions villageois dans les Vosges, et mes parents ont décidé de nous amener, mon frère et moi, à l’Exposition de 1937. Et là, j’ai deux souvenirs essentiels, l’un, dont je vais dire un mot, mais qui n’a rien à voir avec ma vocation, c’est le choc d’un gamin de 13 ans devant les deux pavillons de l’Allemagne et de l’URSS qui se faisaient face, d’une façon tellement agressive, tellement insupportable, que j’ai compris à ce moment-là qu’il se passerait quelque chose, que quelques années plus tard nous en souffririons.
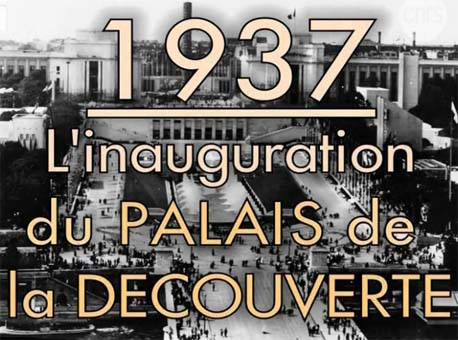
Puis, autre révélation, celle-ci beaucoup plus réjouissante, le Palais de la Découverte, qui ouvrait ses portes dans le Grand Palais. Alors, ça, c’était formidable ! C’était formidable ! Pouvoir toucher des trucs, regarder des étincelles terribles, lire le nombre Pi - ou faire semblant de le lire - qui tournait trois fois autour de la même salle, coupole, c’était vraiment pour moi la révélation, que la science existait, qu’on pouvait la toucher du doigt, qu’il y avait des gens qui savaient l’expliquer, et que ça valait le coup de s’y intéresser. On voyait des choses assez étonnantes, en particulier en mathématiques. On avait des appareils qui permettaient de tracer les courbes. En physiologie, en biologie, je me rappelle d’un déclic formidable dans l’esprit de mon père, parce que lui aussi a été très marqué par cette visite au Palais de la Découverte. Mon père avait remarqué dès sa plus tendre enfance, qu’il cueillait les fraises pas mûres et que tout le monde se foutait de lui, en lui disant : « Tu ne vois pas qu’elle est verte ? » _ « Comment, elle est verte ? » Il avait cette affection de la vue [3], qui ne lui permettait pas de distinguer le vert et le rouge, mais il distinguait plusieurs types de vert. Il arrive au Palais de la Découverte, il y avait une salle, qui était orientée vers les cinq sens, en particulier le sens de la vue, et il y avait des présentations avec des interrogations « de quelle couleur ? ». Lui, il répondait tout faux pour le normal, et tout juste pour cette affection, qui est parfaitement répertoriée. Alors, ça a été vraiment une révélation, et pour moi aussi, que les scientifiques soient capables d’expliquer des choses comme ça, toutes simples, mais de les expliquer.
-*-
Hubert Curien : Dans, la campagne il faut des animaux, et nous avons la chance d’être entourés par toutes sortes de bêtes. À côté, notre voisin a des poneys et des chevaux. C’est un peu bizarre, parce qu’il est boucher, et il élève des chevaux et les poneys pour le plaisir, il ne les monte même pas, je crois, mais pour se dédouaner, pour montrer qu’il aime les animaux, qu’il ne vend pas seulement de la viande. Puis, à côté, un voisin plus original a des paons, 30 paons. Ça fait un peu de bruit, mais c’est très joli.
Michèle Chouchan : Vous m’aviez dit que vous aviez un tout petit terrain autour de la maison, et que vous alliez en fait travailler chez le voisin, mais ce tout petit terrain, c’est plus le (manque un mot) parisien …
Hubert Curien : Oui, mais le voisin tolère que je travaille aussi chez lui.
Michèle Chouchan : Ça fait combien ?
Hubert Curien : Je ne sais pas, c’est un petit bois de quelques hectares, mais l’essentiel est que c’est un petit bois un peu sauvage, avec des oiseaux, des lapins, des écureuils de temps en temps.
Michèle Chouchan : Vous y venez tous les week-end ?
Hubert Curien : On essaye de venir tous les week-end.
Michèle Chouchan : Quand vous étiez ministre, vous veniez aussi ?
Hubert Curien : Oui, oui, oui. Quand j’étais ministre, j’avais la chance, je crois que c’est une chance, de ne pas avoir d’autres devoirs politiques que celui de ministre. La plupart de mes collègues, et c’est tout à fait naturel, étaient maire d’une ville ou conseiller général ou conseiller régional, voire président, et ils avaient naturellement un week-end extrêmement chargé, tandis que moi, je pouvais rester le week-end à la campagne, travailler à mes chères études, et couper un peu de bois, quand il était mort.
Voulez-vous que nous parcourions quelques allées de ce petit bois ?
Michèle Chouchan : Vous venez avec nous ?
Hubert Curien : Mais, la vie de ministre, moi je n’en ai pratiquement que de bons souvenirs. Alors, il y a des gens qui me disent : « Mais, tu as une vie épouvantable, tu n’avais pas un moment à toi … » D’abord, ce n’est pas vrai, il y a toujours moyen de garder le petit moment qui est nécessaire, ensuite, écoutez, je trouve que les gens de cette nature, qui se plaignent d’être sur-occupés sont des hypocrites, parce que, que je sache, dans ces professions-là, il n’y a que des volontaires.
Michèle Chouchan : Vous n’avez pas eu le sentiment, lorsque vous avez cessé vos fonctions de ministre, de retrouver subitement un terrain dans beaucoup de ministres se coupent ? Certains en ont beaucoup souffert, le suicide dramatique de Pierre Bérégovoy prouve quand même qu’on peut avoir des valeurs, sans couper, et peut-être se couper aussi de ceux qui ont fait votre carrière.
Hubert Curien : Absolument, c’est très, très important, et très souvent, quand j’étais ministre, et aussi après, j’ai pensé à tous mes collègues, en me disant : tiens Monsieur Untel Madame Untel, quand nous ne serons plus au gouvernement, comment retrouvera-t-elle ou retrouvera-t-il son équilibre ? Pour moi, il n’y avait jamais de difficultés, je ne me suis pas un instant fait de soucis. Je savais bien que de toute façon, je connaissais bien la communauté scientifique, qui continuerait à me demander un certain nombre de services, de présidence de ceci, de conseils de cela … Donc, je n’étais pas du tout coupé de mon milieu naturel. Mais, quelquefois, pour des ministres, qui sont amenés à prendre des portefeuilles un tout petit peu éloignés de leur vie antérieure, pour leur vie postérieure, ça peut poser problème.
Michèle Chouchan : Et puis, peut-être, y a-t-il ce besoin de retour narcissique, qui peut faire plaisir, mais subitement on passe de la première page du journal à peut-être un petit centre filet à la page 15
Hubert Curien : Il y a des gens qui sont très sensibles à la première page du journal, moi peut-être un peu moins que d’autres, par construction, par habitude de vie. Mais, ça fait quand même un petit quelque chose, c’est vrai, de voir que finalement l’homme dont la photo est en première ou deuxième page, ce n’est plus tout à fait vous, mais bon …
Michèle Chouchan : Le prochain Prix Nobel, ce ne sera pas vous qui irez à Stockholm.
Hubert Curien : Si c’est un copain, pourquoi pas ?
Michèle Chouchan : Vous savez assisté à la remise du prix Nobel à Pierre-Gilles de Gennes, à Georges Charpak ?
Hubert Curien : Pierre-Gilles de Gennes, non, les circonstances ont fait que je n’ai pas pu y aller, et je le regrette. Par contre, je suis allé à la remise du prix Nobel à Georges Charpak, et vraiment c’est une cérémonie superbe ! Une cérémonie superbe, d’abord parce que tout le monde est content, les récipiendaires naturellement, les invités aussi, la reine de Suède aussi. Tout le monde est content, et on se le dit, mais ça ne prend pas l’allure d’une espèce de cérémonie avec des paquets de fleurs, qu’on s’envoie ici, des paquets d’éloges un peu outrés qu’on donne en réponse, non, non, c’est tout à fait bon enfant, à la suédoise, très direct.
Et puis, il y a le banquet Nobel, ah le banquet Nobel ! Alors là, c’est une fête extraordinaire. Le banquet Nobel, ça se passe dans le grand hall de l’Hôtel de Ville de Stockholm. Un immense hall. Les gens qui apparaissent là, ce sont les étudiants suédois, qui vous introduisent, qui vous placent, qui vous appellent, quand il y a un petit discours à faire, et c’est tout à fait charmant. Des étudiants et des étudiantes, naturellement, dont on voit qu’ils sont aussi très contents de participer à cette cérémonie. Après on reçoit des photos, et alors là j’étais particulièrement content, du lot de photos que j’ai reçues, parce qu’il y a une photographie où la reine de Suède fait une révérence à mon épouse. Alors, là, on va l’afficher. Mais je me permets de recommander la reine de Suède, c’est une personne de très grande qualité.
Michèle Chouchan : Il faisait un soleil d’été, le jour où nous nous sommes rendus à Loury, en forêt d’Orléans, dans la maison où Hubert Curien passe ses fins de semaine, installé sur la terrasse, seulement distrait par les cris discordants des paons ou de rares bruits de moteur, il nous semblait presque incongru d’évoquer les politiques de la recherche ou les modes d’investigation scientifique. Le maître de céans n’avait pas manqué de nous faire les honneurs de son domaine, s’amusant, entre autres, de notre curiosité pour le mini-tracteur et tout l’équipement nécessaire à la coupe du bois. Une activité marquée par la jeunesse vosgienne, sans doute.
Hubert Curien : J’ai donc eu une jeunesse très heureuse, dans les Vosges, avec des parents très affectueux. Ma mère était institutrice, donc je suis allé en classe avec elle, mais pensez-vous, le village était assez étoffé, pour que ça ne soit pas la classe unique, et je n’ai pas fait qu’un an dans la classe de ma mère. Mais, c’est un an qui m’a laissé de très bons souvenirs, d’excellents souvenirs. C’était une institutrice remarquable, la preuve est qu’on amenait régulièrement, tous les ans, les élèves de l’École normale d’instituteurs d’Épinal, pour assister à un cours de ma mère. C’était la gloire ! Alors, là, vraiment ma mère faisait des efforts considérables. Je me rappelle d’une leçon en particulier, où les petits normaliens et normaliennes d’Épinal étaient venus et où ma mère avait voulu faire une leçon de choses, elle avait choisi comme sujet, le grillon. C’était à l’époque où les grillons chantent. Elle avait demandé à tous ses élèves d’aller capturer des grillons. C’est assez facile. Vous savez comment on capture des grillons ? Les grillons font des galeries dans les terrains en pente, vous prenez un fétu de paille, vous l’enfoncez dans la galerie, et puis doucement en tournant vous retirez le fétu, et le grillon bêtement suit le fétu. Elle m’avait un petit peu, le soir, donné une avant-première de la leçon, pour que, si aucun autre ne pouvait répondre, je puisse effectivement relancer le débat, sur les pattes des grillons. On avait compté les pattes, regardé le nombre d’articulations pour chaque patte, c’était très, très bien. Très bien.
Ensuite, toujours dans l’école primaire, lorsque je suis arrivé en dernière classe de l’école primaire, il y a eu un débat important dans la famille, et parmi les instituteurs. Le directeur de l’école pensait que j’étais capable d’être reçu premier du canton au Certificat d’études. Donc, je ne pouvais pas quitter l’école, pour aller au lycée, avant de passer le Certificat d’études, mais évidemment, si on n’avait rien fait, cela m’aurait mis en retard d’un an dans ma scolarité. Alors, il a été décidé que je resterais à l’école, mais que j’apprendrai un peu de latin avec le curé, et un peu d’allemand avec ma mère. Ma mère était une institutrice laïque, mais elle s’entendait bien avec le curé, il n’y avait pas de difficultés là-dessus. Voilà, nous avons fait ça, et je dois dire, très immodestement, que je n’ai pas déçu directeur d’école et le canton.
Michèle Chouchan : Vous avez été reçu premier à votre Certificat d’études.
Hubert Curien : Vous savez, c’est par le canton, ça a fait un drame avec le maître d’école du village voisin, qui lui aussi avait un très bon candidat, qui a été second.
Michèle Chouchan : Puis, vous vous êtes décidé, après l’internat au lycée, à poursuivre des études scientifiques, à faire les classes préparatoires aux grandes écoles.
Hubert Curien : Alors, ça, vous savez qu’il n’y a pas de mérite à prendre cette décision, parce que les professeurs et les parents les prennent pour vous. Si vous êtes régulièrement, je ne dirais pas premier, pour ne pas être immodeste, mais presque premier en maths et en physique, il est tout à fait naturel que à la fin de la classe terminale vos professeurs vous disent : « Tu ne peux pas ne pas faire ceci … » Alors, à ce moment-là, encore une scène de la vie villageoise, quand on a un enfant dont on aimerait qu’il prépare polytechnique, quoi de mieux que de demander à un ancien polytechnicien ce qu’il faut faire ? Je ne dirais pas que dans chaque village de France il y a un polytechnicien, mais dans chaque canton de France il y en a au moins un. On en avait un, nous, qui se trouvait avoir épousé une dame assez riche, propriétaire de scieries. Dans les Vosges il y a beaucoup de bois, donc beaucoup de scieries. Donc, on avait un polytechnicien, propriétaire de scieries, et mon papa lui a demandé : « Dites donc, Monsieur Bonin (orthographe du nom, pas sûre), qu’est-ce qu’il faut que je fasse pour ce gamin ? », « Oh, a-t-il dit, il n’y a que deux voies possibles, si vous voulez absolument qu’il soit reçu, c’est Sainte-Geneviève ou Saint-Louis. », « Ah, mais ce sont deux écoles religieuses », répond mon père, qui avait épousé une institutrice laïque. « Ah, non, dit le polytechnicien, Saint-Louis, ce n’est pas religieux ! » Bon, il ira à Saint-Louis, si on trouve de la place. Et Saint-Louis m’a accueilli gentiment.
Michèle Chouchan : Et puis, ça a marché.
Hubert Curien : Eh ben, oui, ça a marché, mais enfin, bon, quand on travaille …
Michèle Chouchan : Et vous étiez reçu à polytechnique aussi ?
Hubert Curien : Oui.
Michèle Chouchan : À polytechnique et à Normale Sup’ aussi.
Hubert Curien : Oui. Et j’ai choisi Normale Sup’, pour des raisons tout à fait contingentes. D’abord, mon professeur de maths en taupe [4], que j’ai le plaisir de rencontrer encore de temps en temps, qui s’appelle Lucien Thiberge, qui avait beaucoup d’esprit, m’avait dit : « Écoutez, si vous voulez devenir professeur, entrez plutôt à X, si vous voulez devenir ingénieur, entrez plutôt à l’École normale », ce n’était pas idiot. D’ailleurs, il ne s’était pas tout à fait trompé, parce que finalement, qu’est-ce que j’ai fait dans ma vie ? J’ai été essentiellement professeur, mais quand j’étais au CNES, je faisais aussi le travail d’ingénieur. Bon, ça n’a pas été l’affaire déterminante. L’affaire déterminante a été la suivante. Je suis entré donc dans une école scientifique, juste après la guerre, en 45, et en 44 j’avais fréquenté les maquis vosgiens. Les maquis vosgiens, c’était tout à fait exaltant, je dois le dire, mais ce n’était quand même pas d’un très grand confort, ni d’une très grande sécurité, vous vous en doutez. Pas d’un très grand confort et j’avais eu des difficultés avec un genou. Je m’étais imaginé que l’École polytechnique gardait un certain style militaire, et que celui qui ne serait pas bon en épreuve physique n’aurait pas de chance d’être bien considéré. Voyant quelques anciens normaliens, je me suis dit de ce côté-là, ça devrait s’arranger, donc, je suis entré à l’École normale.
À l’École normale, j’ai eu des professeurs magnifiques, Monsieur Kastler qui était un homme absolument délicieux, et puis Monsieur Rocard, le père de Michel, Yves Rocard. Je ne lui donnerai pas le qualificatif de délicieux, mais je lui accorderai volontiers celui d’extraordinaire. C’était vraiment un professeur extraordinaire, parce que justement il n’y avait dans sa démarche aucun sectarisme de discipline scientifique, il avait le souci d’éveiller les vocations là où elles étaient et aussi le souci de faire en sorte que la science française bénéficie au mieux des talents et des enthousiasmes des jeunes gens qui sortaient de l’École normale. Alors, ils nous orientaient ici et là, moi, un jour il m’a dit : « Ah, bah, tiens, vous avez l’air de bien aimer la physique du solide, je vous ai vu faire ceci, faire ça, j’ai un camarade, qui est minéralogiste à la Sorbonne, il cherche à un assistant, ça ne vous dirait pas de le rencontrer ? » Je suis allé rencontrer ce camarade de Monsieur Rocard, qui s’appelait Jean Wyart, j’ai été séduit, un bon monsieur, de beaux yeux bleus, un bon sourire, content d’accueillir un normalien, le coup de foudre.
Michèle Chouchan : Et, ça a été la cristallographie.
Hubert Curien : La cristallographie et la minéralogie.
Michèle Chouchan : À ce moment-là, vous aviez le sentiment qu’un jour ou l’autre, vous aimeriez diriger des grands laboratoires, de grands organismes ? L’administration, c’était pour plus tard, c’était quelque chose à quoi vous ne songiez pas, c’était la recherche ?
Hubert Curien : Non, pas vraiment.
Michèle Chouchan : À quel moment alors ? Ça, c’est une deuxième profession …
Hubert Curien : Dans ces trucs-là, le ver se met dans le fruit et puis le mange progressivement. Le ver d’administration, ce n’est pas gentil du tout …
Michèle Chouchan : Le ver de l’administration ronge la recherche ?
Hubert Curien : Non, ronge les chercheurs. Non, une recherche sans administration, c’est une recherche qui ne peut pas marcher. Il y a chez certains d’entre nous, je ne dirais pas un goût pour l’administration, mais un manque de réductance, « Si on te demande de présider telle séance, tu es d’accord ? _Ben, oui, pourquoi pas », si on te demandait par la suite de présider telle commission, tu ne peux pas dire non, « ah, je suis bien jeune … _ Oui, mais justement, ça les fera un petit peu … », alors on accepte. Ainsi, les anciens collègues du département de physique de la Sorbonne, nous étions encore à la Sorbonne, avant d’être à Paris 6, à Jussieu, m’ont demandé un jour de présider le conseil des physiciens. J’avais 35-36 ans, c’était pour moi fabuleux, un honneur formidable. Comme je suis un petit peu vaniteux quand même, qui ne l’est pas, j’ai dit : « Ah, tu crois ? Je ne sais pas, si je pourrais … » _ « Mais, si, mais, si … » Alors, j’ai accepté. Ce que j’aime, ce n’est pas tellement remplir des dossiers et des imprimés, c’est présider des réunions. Ça, j’adore, il faut bien dire. Il faut bien avouer ses défauts, j’adore présider.
-*-
Michèle Chouchan : René Ginouvès, vous étiez à Normale Sup’ avec Hubert Curien. Vous étiez de la même promotion.
René Ginouvès : Nous étions de la même promotion. C’est très émouvant pour moi de revenir sur ce temps-là. Je ne sais pas si vous imaginez la France en 1945, c’était juste après la guerre. Puis, vous imaginez un petit provincial, comme moi, qui arrivait de Montpellier. Je ne suis jamais venu à Paris, donc, complètement perdu dans cette ville et dans cette maison. Et là, il se fait des rencontres, des affinités électives, plus ou moins, qui se manifestent. Ce qui est très drôle, à partir de ma première année d’École, je faisais partie d’un groupe, d’un sous-groupe, bien entendu, dans la grande collectivité. Ce sous-groupe n’était pas constitué spécialement que des littéraires, pourtant, j’avais un de mes camarades, qui s’appelle Alain Peyrefitte. En fait, très rapidement j’ai été attiré dans le bloc des scientifiques, où il y avait 4-5 personnes, dont Hubert Curien, bien entendu, et des gens, qui ont eu des fortunes diverses. Un de mes camardes, Jean-Pierre Serre [5], double professeur de géométrie et d’algèbre, et qui est donc …
Michèle Chouchan : Qui a été médaille Fields, ultérieurement.
René Ginouvès : Exactement. Il y avait aussi un autre mathématicien, Zakovitch, disait-on encore plus génial que Jean-Pierre Serre. Là, on traitait avec des génies, n’est-ce pas. Zakovitch était extraordinaire, parce qu’il travaillait sur les surfaces qui se rencontraient. Il prétendait avoir réinventé la formule géométrique du petit nœud papillon, des fois. Zakovitch a disparu, juste après l’Agrég, qu’il a passée parmi les tous premiers. Il y a un an ou deux, j’ai demandé à Hubert Curien s’il avait des nouvelles de Zakovitch, et il m’a dit : « Je l’ai rencontré sur la place du Panthéon, il est mendiant, et il fait des crocs-en-jambe, aux passants, qui ne voulaient pas lui donner de la monnaie. » Voilà, c’était donc là, que nous avions passé ces années, des années assez étonnantes, c’était l’après-guerre.
Vous avez entendu parler de la vie à l’École normale supérieure, vous savez il n’y a pas de cours, sinon deux cours très importants de mon temps, qui étaient vraiment majeur : il y avait le cours d’escrime et le cours de danse. Je ne me souviens pas bien d’avoir croisé le fer avec Hubert, mais pour les cours de danse, c’est certain. Nous faisons partie des mêmes cours de danse, et on pratiquait beaucoup. C’était toute une époque, je ne sais pas si les jeunes gens dansent beaucoup maintenant, mais on dansait beaucoup, on sortait beaucoup. Il y avait La Rose rouge, il y avait les Frères Jacques, Juliette Gréco, les caves, c’était une période … Et, on travaillait beaucoup bien, on travaillait comme des brutes, mais d’un autre côté, on avait une vie, après la province, après la guerre, c’était une sorte d’explosion, assez étonnante.
Enfin, il se trouve que Curien est resté mon ami, alors qu’on ne se voyait pas, mais quand on se retrouve au bout de dix ans, c’est comme si on s’était quitté la veille. Nous nous sommes retrouvés précisément.
Michèle Chouchan : Vous, votre carrière s’est faite dans le domaine de l’archéologie, lui, dans le domaine de la physique, mais vous avez réussi à communiquer au-delà de l’amitié, à communiquer aussi sur vos travaux ?
René Ginouvès : Précisément, à un moment, nous nous sommes rattrapés, à partir de 68. En mars 68, j’ai été nommé à Paris, à l’Université de Nanterre. Je ne sais pas si vous vous imaginez Paris, Nanterre, en mars 68, j’ai monté le département d’archéologie et d’histoire de l’art. Alors, ça n’intéresse pas directement Hubert Curien, ça intéressait plutôt mon autre copain, Peyrefitte, qui était mon ministre à ce moment-là, c’est assez drôle. Mais, ce qui est certain, c’est que, très vite, j’ai installé à Nanterre, un laboratoire qui était destiné à s’intéresser aux rapports entre l’informatique et les sciences humaines, plus précisément à l’utilisation qu’on pourrait faire de l’informatique en archéologique, essentiellement pour les banques de données. Et ça, c’est une nouveauté absolue, à ce moment-là. Je dois dire que les gens devant qui j’ai parlé de ces choses-là, en général, c’était le drapeau rouge devant le taureau, à peu près …
Michèle Chouchan : Qu’est-ce qui vous a donné l’idée ?
René Ginouvès : C’est très complexe, d’une part, parce que j’avais travaillé, deux années auparavant, aux États-Unis, à Princeton, et au Canada, à l’Université Laval, à Québec. À l’Université Laval à Québec en 1977, la bibliothèque était totalement informatisée, et je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de bibliothèques universitaires en France qui soit maintenant informatisées, en 1993-94. Et, celle-là était totalement informatisée, la gestion était informatisée. Là, j’avais compris, j’avais appris un peu ce côté informatique.
D’autre part, ça correspondait, si vous voulez, un certain souci chez moi de rationalité. Une de mes idées, c’était que l’archéologie était une discipline indisciplinée, je ne suis pas le seul à voir dit cela, bien entendu, l’astuce est ancienne, et l’idée, ça serait qu’éventuellement on pourrait essayer de faire passer l’archéologie du côté des sciences dures, difficiles, austères, mathématiciennes, etc. Bon, c’était un peu pour écarter les petits fantaisistes, vous voyez l’image qu’on se fait de l’archéologue, le monsieur qui a un nœud papillon, un canotier, et qui de loin surveille des ouvriers qui font des trous, comme ça, et puis on trouve des Vénus de Milo. Voilà, c’était un peu contre cette image que je voulais réagir, avec une archéologie scientifique. Donc, j’ai lancé cette affaire-là, et je vais dire que là, évidemment, Hubert Curien a été assez intéressé, tout de suite. Il était directeur du CNRS à ce moment-là, c’est le moment d’ailleurs où il s’était intéressé aussi à ce que faisait ma femme, et je vais dire qu’il nous a beaucoup aidés, ça l’intéressait non seulement d’un point de vue épistémologique, mais aussi du point de vue, j’allais dire, de la propagande de la France à l’étranger, puisque mon laboratoire a servi de laboratoire pilote, pour toute une série d’entreprises en Grèce, par exemple. On a eu des projets un peu démesurés, qui n’ont pas abouti, en particulier de faire une énorme banque de données en Jordanie, une banque de données Franco-anglo-arabe, en trois langues, en deux écritures, sur la totalité de l’archéologie jordanienne. Évidemment, le projet, le projet est tombé, d’un bon coup, parce que les Jordaniens n’ont pas eu l’argent, etc., etc. Mais, on avait eu de beaux projets, et je crois que cela faisait plaisir à Hubert Curien de voir qu’un archéologue pouvait jouer aussi au scientifique d’une certaine manière.
-*-
Michèle Chouchan : Vous arrivez à travailler, quand vous êtes à la campagne ? Vous n’êtes pas déconcentré par justement tous ces bruits, toute cette atmosphère, qui est quand même très distincte de celle d’un bureau fermé, et un petit peu à l’écart de tout ?
Hubert Curien : Les bruits de la campagne sont des bruits dont on peut s’abstraire facilement. Les bruits de la ville sont des bruits en général plus organisés, des conversations, des bruits de radio, des bruits de télévision, qui sont vraiment des dérivatifs, qui ne peuvent pas manquer de capter un peu votre attention, tandis que les cris d’un paon, les aboiements d’un chien, n’empêchent pas de mettre trois phrases l’une derrière l’autre.
Michèle Chouchan : On croirait que c’est sur commande [elle fait référence aux sons des animaux, notamment des paons]. Vous n’avez pas eu envie d’aller vous installer dans les Vosges plutôt, de retrouver votre enfance et votre jeunesse ?
Hubert Curien : C’est un peu trop loin. Quand on n’habite à Paris, une maison dans les Vosges ne vous permet pas d’aller y passer les week-ends. Puis, je dois avouer que depuis que mes parents ont disparu, les Vosges pour moi sont un peu plus lointaines.
Michèle Chouchan : Pourtant, vous avez encore de la famille là-bas.
Hubert Curien : Bien sûr, oui, mais il y a une rupture. Pendant l’occupation, il y a eu la zone libre et la zone occupée, et de toute façon, dans la zone occupée, il y avait une zone dite interdite, qui groupait quelques départements de l’Est, dont le département des Vosges. Mes parents étaient dans les Vosges, il était vraiment un peu difficile de passer cette ligne-là, de la zone interdite. Nous pouvions le faire de temps en temps, mais pas régulièrement, donc, je retournais assez rarement dans les Vosges. Mais, je pouvais quand même y aller pendant les vacances, et une certaine année, juste au milieu de la guerre, le maréchal-ferrant est venu me voir et m’a dit : « Alors Hubert, qu’est-ce que tu fais là ? » _ « Tu vois, je suis en vacances » _ « Oui, mais tu es un bon français » _ « Oh, ben, tu penses ! » _ « Alors, c’est bien, tu es avec nous » _ « Qu’est-ce que ça veut dire je suis avec vous ? Qu’est-ce qu’il faut que je fasse ? » _ « Mais rien pour l’instant, on te dira. Mais tu es avec nous, tu es d’accord » J’étais d’accord, et cela a entraîné le fait qu’au moment où on a constitué un maquis [6], mes amis des Vosges m’ont fait signe, et naturellement je suis venu, et je suis venu avec mes camarades, pour former ce maquis. Et là aussi, ça a été un très grand souvenir. Nous n’avons pas été ensemble au maquis pendant très longtemps, physiquement, je veux dire, rassemblé dans la forêt, mais la fin de l’été et l’automne 44 ont été des périodes très sévères, très sévères parce que les Allemands n’ont pas toléré cette présence d’un maquis dans une forêt, qui faisait tout même une clé stratégique dans l’Est de la France, et ils ont tout fait pour nous en déloger, et détruire le maquis, dans des attaques qui ont été vraiment sans pitié, pour les jeunes gens qui avaient le malheur de se trouver sur la trajectoire des balles, bien sûr, mais aussi, pour ceux qui se faisaient prendre dans des embuscades, si bien que nous avons, là, perdu beaucoup de mes camarades. Quand je regarde des photographies de classe [très forte émotion perceptible à la voix], je retrouve le visage de beaucoup d’amis, qui sont partis dans ces conditions. Et puis, il y avait une tradition, autrefois, une tradition catholique, qui était que quand on faisait sa communion solennelle catholique, on s’appariait, c’est-à-dire qu’on avait un camarade de communion, et ça créait un certain lien, c’est un peu un frère, et mon camarade de communion a été tué au maquis … Voilà [très, très forte émotion perceptible à la voix] ... Alors, bon, cette histoire de résistance est une histoire dont je ne me gargarise pas, ça n’est pas du tout le style, mais c’est quand même, pour nous tous qui l’avons vécu, un passage court, mais si intense ! Et, dans ce maquis, ce qui était assez extraordinaire, c’est que presque tous les jeunes gens du village s’étaient retrouvés, que voulez-vous que l’on fît à 20 ans, quand c’est la guerre et qu’on a à manifester une opinion ? On va naturellement dans la Résistance et dans le maquis. Nous nous retrouvions là, moi, j’étais étudiant, mais il y avait le serrurier, il y avait le menuisier, il y avait un séminariste, et nous formions une petite équipe, et quand on se retrouvait le soir, sur le foin d’une grange, avant de dormir, en échangeait des propos gais. L’ambiance était très fraternelle, eh bien la seule chose qu’on puisse regretter, c’était évidemment qu’elle nous ait conduits quelques fois à des pertes très cruelles.
Michèle Chouchan : C’était quelque chose de difficile de rentrer dans un une vie universitaire normale immédiatement après le maquis.
Hubert Curien : C’est tout à fait vrai. Je suis rentré pour terminer l’année scolaire 44-45, au lycée Saint-Louis, je suis arrivé après la rentrée, naturellement, je me suis retrouvé un petit peu déphasé, siégeant sur des bancs, où je retrouvais de jeunes gens, que j’avais quittés, il n’y a pas si longtemps, mais, qui n’étaient pas passés par le même type d’épreuves, que je trouvais un petit peu déphasés, un petit peu détachés. C’était peut-être eux qui avaient raison. Mais, c’était un peu difficile …
Alors, peut-être puis-je rappeler aussi un autre souvenir, c’est que quand on fait un petit bout de guerre, en général on est décoré. J’ai été décoré, mes chefs m’aimaient bien, et j’ai eu la médaille militaire. C’était très beau, j’étais très flatté. Très bien. J’ai eu la médaille militaire, cela a épaté tous mes copains à Paris. Puis, un peu plus tard, voilà que mon père, qui avait fait la première guerre, reçoit la Médaille militaire, comme un vétéran, et j’ai remis, moi, qui avait une quarantaine d’années, dans les années 60, la médaille militaire à mon père, devant le front des troupes, pour l’autre guerre, bien sûr. J’en ai la photographie, que je vais vous montrer.
Nous ne cultivons pas beaucoup de fleurs, parce que nous ne venons pas pendant la semaine, et ce serait dommage d’abandonner les fleurs pendant toute la semaine, mais nous ramassons les champignons, qui sont assez nombreux et assez variés. À la saison des fraises, nous en avons beaucoup, des fraises des bois, mais les gens du voisinage ou les enfants savent aussi qu’il y a des fraises dans ce bois, ils ne manquent pas, après l’école, de venir faire quelques récoltes. Donc, il n’est pas tout à fait sûr qu’en arrivant le week-end, on trouve les fraises. Mais ça ne me fait rien.
Michèle Chouchan : Alors, ça, c’est votre travail, il faut combien, ce bois ?
Hubert Curien : Une trentaine d’hectares, peut-être. Maintenant, j’ai initié mes petits-enfants au travail du bois en forêt. Ils adorent ça. Je n’ai pas toujours l’approbation de leurs parents, ni de leur grand-mère, parce que manier une tronçonneuse, ou monter sur un petit tracteur, n’est pas un travail d’enfants. Mais ils aiment tellement cela, que ça serait dommage de les en priver complètement.
Michèle Chouchan : Quel âge ont-ils ?
Hubert Curien : L’aîné à 16 ans, et la petite, la plus petite à trois ans.
Michèle Chouchan : Et, vous, vous aimez ça, couper le bois ?
Hubert Curien : J’adore couper le bois.
Michèle Chouchan : Vous en aviez parlé avant, en disant : « J’adore couper le bois ».
Hubert Curien : Un côté bestial, le retour à l’homme primitif. Je ne vais pas jusqu’à frotter le bout de bois, pour essayer de faire du feu.
Michèle Chouchan : J’ai remarqué que c’est vraiment au cordeau, c’est aligné, c’est …
Hubert Curien : Là, c’est sans doute les souvenirs vosgiens. La forêt vosgienne est exploitée naturellement assez intensément, pour le bois d’œuvre et pour le bois de chauffage, et mes souvenirs d’enfance sont très liés à de grands alignements de bûches.
J’ai commencé ma carrière comme assistant, puis maître de conférences, puis professeur à l’université. J’ai été engagé comme assistant, presque avant d’entrer vraiment dans la vie vraiment professionnelle, lorsque j’étais encore à l’École normale, si bien qu’il m’est arrivé une aventure un peu cocasse, c’est qu’un de mes anciens de l’École normale est venu un jour me dire : « Est-ce que tu ne voudrais pas venir faire les travaux pratiques du certificat de minéralogie ? », alors que j’étais moi-même élève. « Oui, me dit-il, parce que, moi, je viens d’être dans mes professeur à Sarrebruck, il faut que je m’en aille tout de suite, et je ne peux pas lâcher les étudiants comme ça… » _ « Oui, si tu crois que je peux, je peux. » J’y vais, je fais les travaux pratiques, je côtoie les étudiants, bien, je les connais. Puis, le jour de l’examen, il fallait bien je passe, moi aussi. Je me suis retrouvé avec eux, ils n’ont pas compris.
Bref, je suis devenu assistant à la Sorbonne, c’était un très bon métier, parce que là, on est vraiment en contact, très direct, avec les jeunes étudiants. Ensuite, je suis devenu maître de conférences, c’est-à-dire les cours magistraux. Et, là, j’avais un modèle, qui était quasiment inimitable, c’était Monsieur Charles Mauguin, a été un très grand cristallographe. C’est lui, on ne le sait pas, qui a été à l’origine, en France, de l’étude des cristaux liquides, qui ont maintenant tant d’applications, les affichages de vos montres, des cadrans dans vos voitures, etc. Eh bien, c’est à Monsieur Mauguin qu’on doit l’introduction, pas l’invention des cristaux liquides, qui date de la fin du siècle dernier, mais l’introduction en France. Vous savez ce que faisait Monsieur Mauguin, pour préparer ses cours ? Il se mettait d’abord devant son armoire à glace, et il répétait son cours devant son armoire à glace. J’ai essayé une ou deux fois c’est une épreuve terriblement difficile, on voit tous les défauts qui vous apparaissent. Je ne le fais plus, parce que ce n’est pas possible de faire ça. Le Certificat de minéralogie, grâce justement à la séduction de Monsieur Mauguin, avait été considéré comme l’un des Certificats à option, pour compléter une licence de physique et de chimie. Donc, on voyait beaucoup d’étudiants, en faisait soit de la minéralogie, soit de la mécanique rationnelle. Les gens, qui avaient plutôt l’esprit naturaliste, venaient chez nous. Donc, j’ai vu beaucoup de chimistes, c’est ainsi que beaucoup d’industriels, qui sont maintenant en activité, me rappellent souvent : « Ah, vous faisiez votre cours, le matin à 8 h 30, avec beaucoup de soin … » Eh ben, oui, beaucoup de soin, j’étais l’élève de Monsieur Mauguin.
Puis, parallèlement, bien sûr, j’ai travaillé au laboratoire de recherche. Et là, j’ai bénéficié, des avis de la direction, d’un maître, qui n’était pas banal non plus, qui s’appelait Jean Laval. Jean Laval, avait lui aussi une histoire assez parallèle à celle de Monsieur Mauguin. Il avait d’abord été instituteur, puis était devenu professeur à la Sorbonne, et il a été, pour finir, professeur au Collège de France. C’était vraiment un très grand savant. C’est lui qui a montré comment on pouvait mesurer vraiment, avec en détail, les mouvements d’agitation des atomes dans les cristaux. Les cristaux, vous le savez, sont des arrangements périodiques, qui peuvent être presque parfaits, d’atomes, les uns par rapport aux autres, bien rangés, mais quoi que vous fassiez, ces atomes s’agitent autour de leur point d’équilibre moyen. Les années 40-50 ont été les années où on s’est vraiment interrogé sur la matière d’étudier les mouvements de ces atomes dans les cristaux. Ce sont de très grands physiciens, comme Born, Brillouin, qui, les premiers, ont donné les lois essentielles, et C’est Jean Laval, qui a montré, comment grâce à la diffusion des rayons X, on pouvait mettre en évidence ces mouvements et les décrire en détail. J’ai été l’un des tous premiers élèves de Monsieur Laval, et j’ai eu la chance d’être le premier à décrire complètement les mouvements des atomes, dans un cristal, qui était tout à fait simple, le cristal de fer. Alors, ça, cela m’a effectivement mis en bien en place dans la recherche, ça m’a permis de connaître des savants du monde entier, essentiellement, disons, d’Europe et d’Amérique, notamment en Allemagne, un grand maître, qui s’appelait Max von Laue. Notre laboratoire, qui s’appelait alors laboratoire de minéralogie, qui s’appelle depuis laboratoire de minéralogie et cristallographie, à l’Université, était situé dans la vieille Sorbonne, où nous n’étions pas très somptueusement logés, mais où nous nous sentions dans une très bonne ambiance. Nous étions encore à la Sorbonne, en partie au moins, au moment des agitations de 1968. Comme notre laboratoire abritait, et abrite toujours d’ailleurs, une très belle collection de minéraux, nous ne tenions pas à ce qu’à la suite d’un coup de tête un étudiant, qui n’avait pas un amour particulier pour la galène, la pyrite ou la pyrolusite, vienne un jour fiche tous nos beaux cailloux en l’air.
Michèle Chouchan : Il y a une Curienite [7]
Hubert Curien : Il y a une Curienite, mais ce n’est pas le plus joli des minéraux. J’y tiens naturellement un peu.
Donc, on se relayait la nuit, pour garder les cailloux. Un jour, j’étais de garde, et j’entends du bruit à la grande porte, je vais voir, et je vois des loustics, qui ont d’ailleurs une bonne bille, qui enlevaient la porte. Je leur ai dit : « Pourquoi tu enlèves la porte ? » _ « C’est qu’on en a besoin, il faut bien qu’on nourrisse la barricade ! » Je leur ai dit : « Venez donc tous les deux, je vais vous montrer une bonne source d’éléments pour la barricade, et vous me laissez ma porte. » Je leur ai donné des madriers, et ça s’est arrangé.
Michèle Chouchan : C’est comme ça qu’on a découvert la Sorbonne, complètement désarticulée.
Hubert Curien : Mais c’était, là aussi, une époque intéressante.
Michèle Chouchan : Comment vous avez réagi, vous, par rapport à 1968 ?
Hubert Curien : Moi, très calmement, parce que j’avais déjà un âge un peu posé, mais nous avons trois fils, et l’un de nos trois fils, le plus jeune, qui avait à cette époque-là 14 ans peut-être, a été très marqué. Comme il est généreux, il s’était beaucoup engagé, il avait beaucoup participé à ces manifestations étudiantes, si bien qu’il m’est arrivé aussi une aventure un peu cocasse. Moi, à ce moment-là, j’étais à la fois professeur à l’université et directeur pour la physique au CNRS. J’avais donc un bureau au siège du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, et les couloirs et les escaliers du CNRS étaient naturellement envahis par les chercheurs, qui voulaient s’associer au mouvement des étudiants, et qui délibéraient de la philosophie, de la vie, de la science, et de tout ce que vous voulez, dans les escaliers. Quelquefois, quand ils parlaient un peu fort, je vais les voir et je leur disais : « C’est intéressant ce que vous dites, mais il y en a qui travaillent, chut ! » Parmi ceux-là, il y avait des assidus, dont un collègue que je connaissais bien. Ce collègue-là, il lui arrivait de nous téléphoner le soir à la maison, et de dire : « Est-ce que votre gamin est rentré ? » _ « Ben, non, pas encore » _ « Le mien non plus, vous devriez lui dire qu’il fiche un peu la paix à mon fils » Ce n’était quand même pas antipathique, ça prouve que les sentiments et la famille ça existe aussi, à côté des grandes idées révolutionnaires.
Michèle Chouchan : Et alors celui-ci est devenu, peintre ?
Hubert Curien : Celui-ci est devenu mathématicien.
Michèle Chouchan : Celui qui est passé par l’École normale supérieure.
Hubert Curien : Il est passé par l’École normale supérieure, comme il s’était beaucoup agité en 1968, et après, parce qu’il fallait quand même suivre un peu le mouvement, ça avait laissé quelques traces dans son lycée, un excellent lycée parisien, que je ne vous nommerai pas, et le proviseur de ce lycée s’était dit qu’il pouvait garder cet élève jusqu’au concours général, parce qu’il avait une chance d’avoir un prix, mais qu’après il s’en déferait facilement, ce qui fut fait. Le jeune homme qui voulait quand même faire une certaine carrière scientifique, qui restait ambitieux, malgré ses idées révolutionnaires, a pensé qu’en allant à Bonn, en Allemagne, premièrement il pourrait apprendre l’allemand, et deuxièmement, il y trouverait de bons mathématiciens, qui le mettraient dans des conditions, à peu près raisonnables, pour entrer à l’École normale, ce qui fut fait.
Michèle Chouchan : Donc, en fait, 1968, pour vous, n’a pas remis en cause les valeurs fondamentales de l’enseignement ?
Hubert Curien : [il manque sans doute un ou deux mots du fait du retournement de la cassette, au moment de l’enregistrement de l’émission] … Quelques aspects ont été vains, d’autres irritants. Irritants, par exemple quand on voyait, passant rue Saint-Jacques ou rue des Écoles, des olibrius aux fenêtres, qui brandissaient des torches, au risque d’allumer la Sorbonne. Non, on peut développer des idées sans incendier des bâtiments. Mais, les idées qui ont été développées, ont été utiles. Oui, nous avons changé beaucoup de choses dans l’enseignement, dans les rapports entre les étudiants et les maîtres, dans la manière de préparer l’avenir. Oui, ça a été une période, je crois, utile et pour beaucoup exaltante.
Michèle Chouchan : Le laboratoire est resté à la Sorbonne après 68 ?
Hubert Curien : Non, parce que notre doyen, Marc Zamansky [8], a trouvé que la Halle au vin au milieu de Paris n’était pas indispensable, et il s’est arrangé pour racheter, au profit de l’université, l’ensemble de l’emprise de la Halle au vin. Les pinardiers ont été éjectés, je dis les pinardiers sans aucune idée de critique, les marchands de vins …
Michèle Chouchan : On les a souvent appelés les pinardiers, effectivement …
Hubert Curien : Oui. Ils sont donc partis dans des lieux qui leur étaient peut-être plus propices. En tout cas, ils ont laissé ce terrain et Marc Zamansky a construit cet ensemble de l’Université de Jussieu, qui est, vous savez, constitué en deux universités : Paris 6 et Paris 7. D’ailleurs, tout de suite après 68, on avait pris l’habitude de parler de la Halle au vin rouge et de la Halle au vin blanc, parce que Paris 7, était un peu plus à gauche que Paris 6.
Michèle Chouchan : Et alors, vous étiez ?
Hubert Curien : Il se trouve que moi, j’étais à Paris 6, mais il n’y avait pas là d’affichage politique.
Michèle Chouchan : Donc, vin blanc 
Hubert Curien : J’avais beaucoup d’amis aussi, de l’autre côté, du côté du rouge.
Vous voyez, tous les voisins ont au moins un cheval.
Michèle Chouchan : Là, c’est celui qui appartient au voisin boucher ?
Hubert Curien : Non, c’est encore un autre.
Michèle Chouchan : Ça ne vous pas donné envie d’essayer ?
Hubert Curien : Monter à cheval, non ? Si, j’ai eu envie, je me suis fait faire un pantalon, quand j’avais 23 ans, le pantalon ne m’allait pas très bien, du coup, je n’ai pas fait de cheval. Eh ben, je vais prendre quelques leçons 
Michèle Chouchan : Vous aviez le pantalon mais pas le cheval ?
Hubert Curien : Le pantalon n’allait pas du tout, vraiment.
Les bruits de la campagne ne sont pas seulement les bruits des paons et les roucoulades des oiseaux, se sont aussi les bruits des moteurs, des petits moteurs de débroussailleuse, de faucheuse.
Michèle Chouchan : Vous avez ça aussi ?
Hubert Curien : J’ai tout.
Michèle Chouchan : L’équipement complet du parfait bûcheron, débroussailleur ?
Hubert Curien : Oui.
Michèle Chouchan : Vous éprouvez le même plaisir à débroussailler qu’à couper du bois ?
Hubert Curien : Non, parce que débroussailler, ce n’est pas très valorisant. C’est nécessaire, mais, non ça manque de noblesse.
Michèle Chouchan : Vous avez une installation, un bureau, ici aussi, de quoi écrire, etc. ? Ou c’est plutôt des dossiers que vous emmenez au coup par coup ?
Hubert Curien : Une installation, certes, j’avais un assez joli bureau, il a été cambriolé, alors on l’a remplacé par une table, c’est aussi bien pour travailler. Nous finissons par avoir de la sympathie pour les cambrioleurs, parce que ça crée une intimité.
Michèle Chouchan : C’est une façon de voir les choses
Hubert Curien : La première fois, on est choqué, on est ému, la seconde fois, on n’est pas très content, mais finalement en apprécie les qualités des cambriolages. Nos derniers cambrioleurs ont été extrêmement habiles. Ce sont des spécialistes, j’aime beaucoup le la manière dont ils ont opéré, ils avaient sans doute une commande pour une armoire et deux bureaux, alors ils ont pris juste une armoire et deux bureaux, mais pas ce qu’il y avait dedans, pas ce qu’il y avait dans l’armoire.
Michèle Chouchan : Ah, ils l’ont vidée avant de partir ?
Hubert Curien : Oui, oui, très bien, sans casser les verres ni rien, mais enfin, je ne souhaite pas qu’ils reviennent très souvent.
Les arbres sont surtout des chênes, il y a très peu de résineux. Les propriétaires ont eu la sagesse de ne pas replanter en résineux, pour obtenir des rendements plus rapides, mais de planter toujours en feuillus, surtout en chênes, ce qui donne une forêt très homogène.
-*-
Flash actualité, 1984, Jean-Louis Bianco, le secrétaire général de l’Élysée, va donner la composition du gouvernement à l’Élysée. Le président de la République a nommé : Ministre d’État, chargé du plan et de l’aménagement du territoire, Gaston Defferre ; Ministre de l’économie des finances et du budget, Pierre Bérégovoy ; Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Robert Badinter ; Ministre des relations extérieures, Claude Cheysson ; Ministre de la Défense, Charles Hernu ; Ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Pierre Joxe ; Ministre de l’agriculture, Michel Rocard ; Ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, Édith Cresson ; Ministre de l’éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement ; Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Georgina Dufoix ; Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, Paul Quilès ; Ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme, Michel Crépeau ; Ministre des affaires européennes et porte-parole du gouvernement, Roland Dumas ; Ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Michel Delebarre ; Ministre de l’Environnement, Huguette Bouchardeau ; Ministre de la Recherche et de la Technologie, Hubert Curien. Le Conseil des Ministres se réunira aujourd’hui à 17 h, au Palais de l’Élysée.
-*-
Michèle Chouchan, avec Dominique Ferriot, au Musée national des techniques, dans l’enceinte du Conservatoire des arts et métiers.
Dominique Ferriot : Je vous propose d’aller vers la chapelle. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, en ce moment, il doit y avoir des personnes en train de poursuivre les sondages archéologiques, et peut-être aussi des problèmes de démontage de vitraux. Mais on va trouver …
Je vais peut-être vous dire où nous sommes. Ici, nous sommes devant les avions, qui étaient, il y a peu de temps, encore suspendus dans la chapelle des Arts et Métiers. Le Conservatoire national des arts et métiers a été fondé il y a 200 ans. Et, depuis 200 ans, un certain nombre d’objets techniques sont présentés au public. Nous venons juste de terminer le déménagement des objets, qui étaient installés dans la chapelle, pour entreprendre un programme de grands travaux, qui a été décidé, il y a quelques années déjà, et qui doit être mené à bien, pour partie pour le bicentenaire de l’établissement, en octobre 1994. J’espère que nous pourrons terminer ce chantier à la fin de l’année suivante.
Là, c’est ce qui reste pour l’instant des avions de : Blériot, Breguet, Esnault-Pelterie, les principaux avions qui étaient dans la chapelle. L’avion d’Ader, lui, est, pour l’instant, exposé au Bourget. Ce que nous voulons retrouver ici, c’est un petit peu l’origine du Conservatoire, c’est-à-dire à la fois tradition et modernité. Je pense que sans vouloir essayer de retracer toute l’évolution des techniques, notamment au début du XXe siècle. Il y a beaucoup d’objets qui nous manquent, puisque la politique d’acquisition du Conservatoire s’est un petit peu ralentie à partir des années 1920-1930, nous tenons beaucoup à faire comprendre à la jeunesse de l’innovation technique aujourd’hui, aussi. Donc, nous avons une politique très active, en relation avec différents partenaires d’entreprises, des organismes de recherche, pour montrer réellement, soit à travers des objets historiques, soit à travers des objets plus contemporains, la genèse d’un certain nombre de processus ou d’innovations, qu’on peut trouver dans notamment dans les machines qui sont ici.
Michèle Chouchan : Quelle a été votre trajectoire pour arriver là ?
Dominique Ferriot : Oh, là, disons que Monsieur Curien y est pour quelque chose, en tout cas, puisque si je suis entrée, comme on dit en culture scientifique et technique, c’est un petit peu grâce à lui, ou pour lui, ou à cause de lui. Je l’ai rencontré en 1975. À l’époque, il était délégué général à la recherche scientifique et technique (DGRST), et il cherchait quelqu’un pour l’aider à développer une politique de communication sur la science, la recherche, et un certain nombre de problèmes de culture technique. Nous avons, je crois, travaillé de façon très, très positive ensemble, dès ces années-là. À l’époque déjà, il avait, je me souviens, insisté pour que nous développions les activités, par exemple du 1er centre de culture scientifique et technique, qui venait d’être créé, à Grenoble, ou pour développer toute une action de popularisation ou de vulgarisation, comme on disait alors, de la science, dans le cadre de chapiteaux itinérants, qui avaient été menée dans la région Centre, et dans d’autres régions. Donc, déjà, dès les années 70, on avait essayé au niveau des politiques de recherche de …
Michèle Chouchan : C’est les premières expériences de la physique dans la ville, où participaient à certains …
Dominique Ferriot : Il y a eu aussi des expériences de physique dans la rue, oui, oui, mais pas uniquement. Monsieur Curien a aussi beaucoup travaillé dans le domaine de la popularisation des sciences par toute son action au Palais de la Découverte, parce qu’il a été très proche de cette institution, qu’il a présidée pendant assez longtemps. Puis, lorsqu’il a quitté la DGRST, pour s’occuper du CNES, il avait gardé vraiment un lien assez fort avec toutes les activités muséales, c’est pourquoi il avait accepté, en 1982, de présider l’assemblée générale constitutive d’une association, qui est assez importante maintenant, qui est l’Association des musées et centres de culture scientifique et technique, qui regroupe près de 300 membres, et qui essaie de fédérer justement un petit peu les actions, les initiatives, de tous ceux qui travaillent, notamment en région, pour une meilleure diffusion de la culture scientifique technique industrielle, qu’Hubert Curien a vraiment marqué par une très grande continuité dans l’action dans ce domaine.
Puis, à partir du moment où il est devenu ministre de la recherche et de la technologie, disons, il a permis de donner une impulsion plus forte, et une assise plus stable à un certain nombre d’initiatives. Je crois que le développement des grands musées de collections, c’était le maillon manquant, parce que finalement nous avons des outils patrimoniaux en France très, très importants, et que naturellement, c’est très intéressant de développer des centres d’expérimentation ou de développer le côté Science Center, comme on le dit aux États-Unis. Malgré tout, la mise en valeur du patrimoine, c’est aussi quelque chose d’essentiel, et c’est ce qui est en train d’être mené dans le cadre des grands travaux de l’État, à la fois pour la partie Histoire naturelle, au Muséum national d’histoire naturelle, et en ce qui nous concerne, pour la culture technique. Nous avons aussi une capacité très forte, pour contribuer à la formation, à une démarche pédagogique, dans le milieu scolaire, à partir de classes, disons, en tout cas au moins au niveau du collège. C’est vrai que les orientations, comme on dit maintenant, se font très, très vite, et c’est très tôt que finalement il faut arriver à sensibiliser les jeunes à la culture technique, pour qu’ils puissent avoir les outils nécessaires, pour pouvoir décider d’un certain nombre de choses, en particulier de leur avenir, c’est-à-dire des filières qu’ils vont choisir après, et qui vont leur permettre de s’adapter à tel ou tel type de métier.
On avance un petit peu, si vous voulez. On est là, avec quelques bruits de fond, nous sommes vraiment ici dans le cœur du musée, dans le chœur de l’église d’ailleurs. C’est une église dont le chœur est du XIIe siècle, la nef est plus ancienne, et évidemment, comme tous ces bâtiments, elle a été beaucoup réaménagée aux XVIIIe et XIXe siècle, surtout, par Vaudoyer. C’est le premier programme de rénovation, restaurer et remettre en valeur à la fois le lieu et les collections. Là, nous avons déménagé tous les objets, qui étaient précédemment dans la chapelle, depuis le fameux pendule de Foucault, qui a oscillé pas très loin de nous, et tous les moteurs. Nous avons simplement gardé, voyez-vous, sur place, pour l’instant, cette maquette à l’échelle 1, du moteur Vulcain d’Ariane 5, qui nous a été donnée par la SEP [9], ce qui montre que nous avons aussi des objets très contemporains. Préalablement à tous ce programme de restauration du bâtiment, qui est une première phase avant le réaménagement muséographique, nous avons une campagne de sondages archéologiques. On peut peut-être s’approcher de points de sondage.
Bonjour ! Ce qui a permis de dater le squelette, Monsieur Mercier me disait, c’est la chaussure ? C’est ça, la chaussure XVIIe siècle ? [séquence d’échange avec la personne qui fouille, inaudible], de l’autre côté, la nécropole est du XIVe, c’est ça ? _ « De l’autre côté, on a deux sépultures du XIVe siècle, qui sont juste près de l’entrée. ». Catherine Brut est responsable de la campagne des sondages archéologiques, qui nous fait remonter beaucoup plus avant encore dans l’histoire du prieuré.
Catherine Brut : Avant que ça ne soit un musée …
Dominique Ferriot : Avant la fondation du Conservatoire, avant toute l’époque industrielle. Finalement, vous vous attendiez à trouver autant de choses ? Oui, d’une certaine façon ?
Catherine Brut : Dans la mesure où c’est un ancien prieuré, qui appartient à l’une des trois plus grandes abbayes de Paris, il était normal que l’on trouve d’abord des sépultures, parce qu’on est dans une église, et ensuite notre histoire de cet ancien prieuré conservé [manque une séquence inaudible]. Là, on est qu’au début du sondage, on tombe donc sur les sépultures les plus récentes, qui en l’occurrence sont du XVIIe, maintenant on va fouiller plus profondément, et là peut-être va-t-on trouver des vestiges plus anciens, qui vont nous permettre de comprendre l’histoire de la construction de cette église, qui pose, quand même, pas mal de problèmes historiques.
Michèle Chouchan : Vous espérez remonter jusqu’à quelle période ?
Catherine Brut : Les vestiges les plus anciens retrouvés, d’un point de vue archéologique, sont du XIe siècle, mais on peut remonter jusqu’à l’époque mérovingienne, donc vous pouvez éventuellement des sarcophages ou des sépultures plus anciennes, une occupation plus ancienne. Historiquement, Saint-Martin-des-Champs a pu être fondé à l’époque mérovingienne. Comme il n’y a jamais eu de fouilles, on s’attend à tout.
Michèle Chouchan : Sur le plan personnel, vous connaissez un peu Hubert Curien ?
Dominique Ferriot : Nous nous sommes rencontrés en 1975. Je crois que si je l’avais connu plus tôt, j’aurais sûrement fait des études plus scientifiques, puisqu’au départ, je suis une littéraire. C’est aussi pour ça, d’ailleurs, que je suis heureuse dans ce lieu, qui est un lieu technique, mais qui a inspiré tant d’écrivains, et qui porte en lui tant de créations, y compris de créations littéraires et artistiques. Ensuite, professionnellement, effectivement, je l’ai accompagné soit de près, lorsque j’ai pu travailler avec lui à son cabinet au ministère de la recherche, ou en tant que directeur dans l’administration, mais aussi, d’un peu plus loin, lorsque j’étais en particulier à l’écomusée du Creusot, il a toujours suivi de façon très précise nos activités, pour développer la culture technique dans un territoire, qui était à l’époque un territoire de mines et de métallurgie en reconversion.
-*-
Hubert Curien : Je suis vraiment très content de cette occasion de parler avec mon ami Bernard Decomps. Je dis mon ami, Bernard Decomps, parce que nous nous sommes connus dans les relations de professeur à élève, quand il était élève à l’École normale et que j’y étais professeur, mais vous savez, c’est une École où les relations de professeur à élève sont à peu près de la même nature que les relations de professeur à professeur, ou d’élève à élève. Elles sont très directes, très amicales, très confiantes. Et cette amitié, elle dure depuis ce moment-là, et nous avons eu l’occasion de coopérer dans différentes circonstances, et surtout j’ai eu l’occasion, moi, d’essayer de « sucer » les bonnes idées de Bernard Decomps, dans différents domaines. Mais, je crois que l’un des domaines, ou d’ailleurs le nom de Decomps restera attaché, c’est le domaine de la formation par la recherche, et de la formation des ingénieurs.
Michèle Chouchan : Ces fameuses filières Decomps, qui ont d’ailleurs, pendant un temps, défrayé les chroniques médiatiques, parce que c’était quelque chose de totalement nouveau, qui dérangeait
Bernard Decomps : C’est vrai que ça a dérangé, que ça dérange encore, j’espère, et si ça dérange encore, c’est à la fois parce que ça correspond, c’est du moins mon point de vue, à un manque, tout à fait important, de notre système éducatif, et d’autre part parce que ça amène à se poser des questions sur les formations existantes.
Michèle Chouchan : Bernard Decomps, il faut rappeler la formation que vous avez préconisée, que vous avez suggérée.
Bernard Decomps : C’est basé sur l’idée qu’on peut devenir ingénieur à tout âge, et pas exclusivement, lorsque l’on a 18 ou 19 ans ou 20 ans, et que l’on entre par la filière des grandes écoles. On doit pouvoir devenir ingénieur, lorsque l’on a exercé dans une entreprise un certain nombre de responsabilités techniques, ou des responsabilités dans des services, et que précisément, on va se trouver dans des positions, pour lesquelles il faut occuper ce que l’on appelle en France la fonction de cadres, et qu’il peut manquer un certain nombre de formations. Les systèmes actuels, qui existaient, plus exactement jusqu’en vers 1988-89, étaient des parcours du combattant, tellement long, et tellement pénibles, que peux y arrivaient, et que ceux qui arrivaient, étaient, quelquefois, usés par la formation elle-même. Il nous a semblé qu’il y avait une chance d’introduire en France un nouveau mode d’accès au statut d’ingénieur, d’ailleurs reconnu par la Commission des titres de l’ingénieur, autrement dit ceci s’est fait absolument dans la transparence la plus complète, et la reconnaissance officielle de tous ceux qui en France disent qui peut porter le titre d’ingénieur, et une formation, qui peut s’étaler sur un petit nombre d’années, par une méthode d’alternance, et ceci se fait à tout âge. Donc, le public visé, c’est plutôt des techniciens supérieurs, qui ont une trentaine d’années, 30-35 ans, mais également, et ça c’est une retombée que je n’avais pas du tout prévue au départ, et qui se révèle extraordinairement intéressante aussi, c’est de faire des ingénieurs par la bonne vieille technique de l’apprentissage. L’apprentissage n’est pas réservé qu’aux exclus du système, elle peut être aussi offerte aux meilleurs, et nous formons des ingénieurs par l’apprentissage, c’est-à-dire avec des personnes, qui, alors là, à 20 ans, passent la moitié de leur temps dans une entreprise, l’autre moitié dans un système de formation, et au bout de cinq ans sont des ingénieurs, qui se révèlent des gens parfaitement adaptés, et qui trouvent, dans le système de crise que nous connaissons, au contraire toute la connaissance intime de l’entreprise, qui leur permet d’être immédiatement utilisables.
Hubert Curien : Dans cette affaire de formation des cadres, à très haut niveau, dans le secteur technique, je dois dire que, sans aucune vergogne, j’ai pompé toutes les bonnes idées de Bernard Decomps.
Michèle Chouchan : Et nommé directeur de la recherche, après tout c’était pour ça.
Hubert Curien : D’autre part, je n’ai vraiment aucun remord, parce que, bien sûr, on lui a tiré toutes ses bonnes idées, mais on l’a laissé son nom en pour désigner la filière, la filière Decomps. Il y a un autre domaine dans lequel nous avons vraiment travaillé, je crois utilement, c’est le domaine de la diffusion de l’innovation dans le milieu industriel. Domaine, de qui n’est pas si facile à manier, parce que vous pouvez vous dire : « Mais, les très grandes maisons, non pas besoin de l’intervention de quiconque, pour savoir ce qu’elles doivent apprendre en technologie, ce qu’elles doivent chercher dans leurs laboratoires, pour mettre au point leurs produits futurs » C’est vrai, c’est presque vrai. De temps en temps un conseil extérieur leur est tout de même utile. Mais, ils ont le volume nécessaire pour faire ce type de choix. Mais les petites et moyennes entreprises, qui sont une source d’embauche très importante, qui méritent une attention toute particulière, sont beaucoup moins à même d’être au courant, directement et spontanément, de ce qui se fait de plus avancé dans les secteurs où ils travaillent déjà, ou dans des secteurs où ils pourraient aller travailler. Donc, il faut diffuser la connaissance technologique, et ça c’est vraiment une tâche compliquée, absolument nécessaire mais compliquée. Alors, on nous dit : « Les Allemands ont fait beaucoup mieux que vous, regardez, d’ailleurs leurs petites et moyennes entreprises, font nettement plus de recherche, de recherche appliquée, bien sûr, que l’ensemble des PME françaises » C’est vrai ! C’est vrai, mais ça tient aussi au fait que la structure des PME allemandes et des PME françaises est très différente, et qu’il y a en France beaucoup plus de PME, qui travaillent dans des secteurs de caractères plus traditionnels qu’en Allemagne. L’Allemagne a dû reconstruire complètement son économie, après la guerre, et s’est remise sur un certain mode de vie, qui était plus facile à établir à partir de presque plus rien, que chez nous où il fallait travailler dans une certaine continuité. Donc, c’est plus difficile, il y a plus à faire encore en France qu’en Allemagne. Alors, là, est-ce qu’on a réussi ? Je crois qu’on a avancé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Ce n’est pas du tout une critique des PME, pas du tout, je les trouve très allantes, mais pour aller, elles ont besoin qu’on les accompagne.
Bernard Decomps : Je dirais il y a d’abord un problème de sensibilité de vocabulaire. Si une PME n’a pas une amorce, une entité de technique, relativement avancée, en son sein, eh bien elle, ne peut pas profiter. Ce n’est pas le téléphone la R&D.
Hubert Curien : R&D, pour rechercher développement.
Bernard Decomps : Merci ! Je dirais que si on veut prendre une image de communication, j’aimerais mieux l’image de l’ordinateur. Pour une image d’ordinateur, on sait très bien qu’il existe des très gros ordinateurs, qu’il vous faut un micro-ordinateur, il vous faut une station de travail, pour pouvoir récupérer les données, qui sont dans ce très gros ordinateur. Il en est de même pour la R&D. Donc, premier projet, premier pilote, sur lequel beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire, c’est aider les entreprises à recruter des personnes qui soient capables de suivre un certain type de projet technique. Les conventions industrielles de formation par la recherche, les CIFRE, sont une des réponses, une réponse qui est adaptée à certaines PMI-PME, mais peut-être un peu chère pour d’autres PMI-PME. Ce n’est pas nécessairement des docteurs, c’est même exceptionnellement des docteurs ès-sciences, qu’il faut pour cela. Une opération plus modeste en ambition, mais beaucoup plus efficace dans beaucoup de réalités, a été une initiative pour former des techniciens supérieurs à la sortie des IUT, qui passent un an dans un laboratoire de recherche, et qui acquièrent ce type de relations, qui puissent être relayées, C’est les CORTECHS, ça a un succès considérable. Donc, c’est la première des idées.
Il y a une deuxième, c’est ce que l’on appelle l’audit technologique. Une entreprise n’a pas un problème de recherche. Un client qui lui dit qu’il y a un produit qu’elle aimerait bien fournir, qu’elle a trouvé à Taïwan, au Japon ou ailleurs, est-ce que l’entreprise est capable de le fabriquer ? Eh bien, quelquefois elle n’est pas capable de le fabriquer, parce qu’il lui manque des capitaux, c’est souvent le cas, et elle n’est pas capable de le fabriquer quelquefois, parce qu’il lui manque un maillon technologique. Et s’il lui manque un maillon technologique, quel est ce maillon ? Ça, c’est ce qu’on appelle l’audit technologique, autrement dit, former des gens, qui vont écouter des questions d’une entreprise, et qui vont aiguiller sur la source intelligente, et ça, des réseaux que l’on appelle, tout à l’heure le ministre a parlé des ingénieurs Decomps, ces raisons on les appellent les réseaux Curien. Eh bien, il y a des réseaux Curien, vous avez un ensemble de personnes, qui font des visites systématiques de toutes les entreprises, et qui proposent des audits technologiques, à des prix défiant toute concurrence. La première fois, l’entreprise dit : « Oh, ce n’est pas trop cher, je vais le prendre. », et si ça sert, après, l’entreprise en redemande. Voilà un aspect qu’il faut poursuivre.
Hubert Curien : Il y a peut-être un autre aspect des choses, que Bernard n’a pas souligné, qui peut-être un danger, c’est que nous avons voulu être sur le terrain, en contact avec le million industriel. Donc, les réseaux –cités tout à l’heure - sont tels que les industriels reçoivent des visites, mais il ne faut pas que ces visites arrivent à contretemps et soient considérées comme une gêne « Ah, voilà encore le raseur, qui vient nous faire la leçon », non. Et, surtout, il ne faut pas que ces visiteurs se présentent en rafale, les uns derrière les autres, l’un étant mandaté par le ministère chargé de la recherche, l’autre par le ministère chargé de l’industrie, le troisième par ministère chargé de l’environnement, etc. Alors, ça, ne le nions pas, c’est quand-même un danger. Moi, je ne suis pas tellement inquiet de la diversité des aspects des conseils, qui peuvent être donnés, ce qui est irritant et détestable, pour un petit industriel, c’est lorsqu’il veut bénéficier d’une aide, et les aides existent, il est tout à fait naturel qu’il essaie d’en profiter, il est obligé de remplir du papier, ça prend du temps, c’est casse-pieds de remplir des papiers, et puis il va la porter à un certain guichet, on lui dit : « Ah ben, oui, mais vous avez rempli les papiers, ce n’est pas les nôtres, ça ne va pas, c’était pour le guichet d’à côté, moi je ne sais pas, il faut que vous recommenciez … » Ça, c’est détestable. Autant l’unicité des dossiers de présentation, pour l’accès à un certain type d’aide, est indispensable, autant la multiplicité des interventions humaines, c’est-à-dire l’intervention d’ingénieurs, qui savent des choses différentes, qui ont des habitudes différentes, autant, je crois, cela peut être utile, si naturellement, ça ne représente pas une espèce de d’usure de temps, qui est mal supportée par ceux qu’on aimerait voir devenir des clients. Un petit danger cependant, nous ne devons pas jouer les marchands d’illusions. Quelquefois, l’enthousiasme des chercheurs est tel qu’en arrivant devant un problème industriel, ils disent : « Mais, si vous me donnez un an pour étudier ça, je vous trouverai la solution » Oui, peut-être, mais si cette solution est économiquement beaucoup trop lourde, et pratiquement impossible à appliquer dans l’industrie en question, ou dans la compagnie, qui est intéressée, on risque d’amener cette compagnie à une situation financière qui sera dangereuse. Donc, attention, ne nous laissons pas, quelquefois, porter par notre enthousiasme, au point d’oublier les réalités économiques, à très court terme ou à court terme. Nous voyons le moyen terme, le long terme, c’est tout à fait indispensable, n’oublions pas que pour de prospérer il faut vivre et la première des conditions est de ne pas faire mourir le patient. De toute façon, ces illusions-là, ces erreurs-là, de plus en plus on les évitera. Je dis de plus en plus, ça veut dire au fur et à mesure que l’ensemble de nos concitoyens seront conscients de ce qu’est la connaissance scientifique, de ce qu’elle peut apporter au mode de vie, au mode de travail. C’est la raison pour laquelle, avec Bernard Decomps, on a beaucoup insisté, au cours des dernières années, sur la nécessité d’une diffusion sous forme festive de l’appétit pour la recherche. Nous avions eu l’idée de faire, annuellement, une fête de la science, un peu à l’instar de la fête de la musique, si vous voulez, mais pour s’en démarquer, ça vous paraîtra peut-être un peu enfantin, au lieu de parler de la Fête de la Science, on avait parlé de « La science en fête ». Il y a l’idée, quand même, ce n’est pas simplement un jeu de mots. La science en fête, ça veut dire que c’est les scientifiques que qui font la fête avec tout le monde, ce jour-là.
-*-
Dominique Ferriot : … La présence humaine est tout à fait importante pour la médiation, en particulier dans les expositions scientifiques, il faut des démonstrateurs, il faut des personnes, qui soient présentes physiquement, qui puissent expliquer, qui puissent parler. Je pense qu’un musée de panneaux, ça n’est pas gérable, un musée d’écran, ça n’est pas souhaitable, un musée d’objets inanimés, parce qu’on ne peut pas toujours les mettre en mouvement, pour faire des expériences avec les objets originaux, ça n’est pas non plus une bonne chose. Donc, la présence humaine, c’est absolument indispensable, cela sera la clé de notre réussite future, que d’arriver vraiment à faire parler les objets, en ayant dans les présentations davantage de personnes, disons, à l’écoute des demandes des visiteurs. Je crois que la muséographie statique n’est pas la bonne réponse, mais la mise en spectacle systématique, automatisé, gadgétisée, n’est pas une réponse non plus. Il faut vraiment revenir à la médiation humaine.
Michèle Chouchan : Quand on voit, par exemple, la 4 CV, là-bas, de 1950, avec son moteur ouvert, qu’est-ce que vous pensez pouvoir rendre possible, avec un objet comme celui-là ? la 4 CV, c’est quelque chose, qui a absolument marqué une époque
Dominique Ferriot : Oui. Je disais, il ne faut pas d’écrans, pas de panneaux, mais il faut quand même un minimum de choses, en particulier il y a des documents originaux, audio-visuels, qui sont intéressants, qui peuvent tout à fait servir de référence. Je pense qu’on les a déjà listés, et pour tout ce qui est de cette période relativement récente, ce sera quand même quelque chose qui nous aidera beaucoup. Mais, par exemple, pour des instruments plus anciens, nous avons un petit peu plus loin les instruments de Lavoisier, là, nous sommes obligés d’essayer de penser une mise en scène du laboratoire de Lavoisier, à partir d’éléments qui resteront statiques, nous n’aurons pas de documents, par exemple audio-visuels, ou autre, pour expliquer, nous ne pourrons pas refaire régulièrement des manipulations dans le laboratoire, en tout cas pas avec les instruments originaux. Donc, il y a vraiment encore une fois, une médiation humaine, absolument indispensable. Nous l’avons fait d’ailleurs récemment pour La science en fête, par exemple, ou pour des opérations plus ponctuelles, la difficulté c’est de concevoir le mode de fonctionnement d’un musée permanent. Disons, qu’on a beaucoup trop insisté peut-être, dans les dernières décennies, sur les expositions temporaires, sur les événements, et toutes les solutions ou toutes les idées intéressantes, bien sûr, qu’on peut avoir dans une manifestation temporaire s’érodent très vite, et deviennent assez banales, voire répétitives, ou même dangereuse ou pernicieuses dès qu’on passe à quelque chose de plus permanent. Notre ambition est de refaire un musée pour les décennies à venir, c’est vraiment quelque chose qui est plus délicate, qui suppose beaucoup d’humilité, je crois, mais qui est naturellement au service d’une ambition un petit peu plus grande.
-*-
La science en fête sur France Inter, 13 juin 1992 : « Science et fête, deux termes qui n’apparaissent pas évidemment complices, et pourtant à l’initiative du Ministère de la recherche, ce week-end, c’est le signe de « La science en fête », de nombreuses manifestations à travers la France, pour expliquer que le monde scientifique n’est pas aussi rébarbatif qu’il ne paraît, et, on veut bien le croire, si l’on en juge par cette manifestation, qui se tient dans le RER, à Paris, à la station Auber. Jugez plutôt. Le Palais de la Découverte et son représentants Bernard Blache, y expliquent, par exemple, les recherches sur le chocolat. Bruno Rougier, grand gourmand devant l’Éternel, n’a pas raté ça.
Bernard Blache : Un certain nombre de d’idées reçues sur le chocolat font croire aux gens que le chocolat fait mal au foie. Le chocolat noir, en particulier quand il ne contient pas de fourrage, ou de choses particulièrement caloriques, est quelque chose de relativement digeste, bien entendu quand on ne fait pas d’excès. Le chocolat est quelque chose d’assez étonnant. Il contient de la caféine, donc il maintient éventuellement l’attention en éveil. Il contient des corps assez bizarres, comme la théobromine, un stimulant du système nerveux central. Quand on consomme du chocolat, la consommation entraîne la fabrication, par l’organisme, d’endomorphines, qui sont des euphorisants, c’est ce qui a fait comparer dans certains cas le chocolat à l’opium, mais bon, il y a quand même des questions de dosage. Alors, là, vous allez pouvoir tester. On a ici trois, j’allais dire, trois goûts de chocolat, trois crus de chocolat, des chocolats différemment dosés en cacao, entre 61 et 70%. Vous avez un chocolat assez amer, qui est le 70%, qui est un chocolat noir, et puis le pourcentage de sucre augmente petit à petit.
Avouez que cela vous déculpabilise son gourmand. La science en fête, donc plus de 1500 manifestations gratuites dans toute la France ce week-end. »
-*-
Dans les bureaux des éditions Odile Jacob, rue Soufflot, à Paris : Le métier d’éditeur, tel que nous le pratiquons, est un tout petit peu particulier, parce que la plupart du temps dans les livres que nous faisons, les livres scientifiques, ce sont des auteurs que nous allons chercher, que nous convainquons d’écrire, et que nous accompagnons jusqu’au bout. Ce que je voulais dire, simplement, c’est que c’est un métier différent de l’édition peut-être traditionnelle de littérature, parce que un éditeur de littérature attend peut-être un premier roman d’un auteur, en aura un deuxième, un troisième, peut-être 10, 20, ou 30. La plupart du temps, il a très peu de choses à faire sur un manuscrit, puisqu’il a un écrivain de métier, et il pourra publier plusieurs livres 30, 40, 50. Les scientifiques, d’abord, ont d’autres métiers, puisqu’ils font de la recherche, et des découvertes, de l’enseignement. Ils ont peu de temps pour écrire, c’est presque comme une obsession. Je crois que les scientifiques, et peut-être beaucoup de gens, ont des obsessions, l’obsession de comprendre, l’obsession de trouver quelque chose, c’est la même chose, cela se retrouve dans leurs livres, ils écrivent un, peut-être deux livres toute leur vie.
Hubert Curien : C’est tout à fait vrai. De temps en temps, vous vous adressez non pas à des scientifiques, mais, à des hommes politiques, qui ont une carrière extrêmement importante pour la vie de la société. Est-ce que vous trouvez chez ces auteurs un comportement assez différent de celui que vous connaissez chez les scientifiques ?
Odile Jacob : Ce que nous avons essayé de faire, ce que nous essayons de faire dans cette maison, c’est, je crois, de montrer au grand public des visages très différents, dans des domaines très différents, et d’essayer d’être le plus ouvert possible. On m’a souvent dit que les livres politiques n’étaient pas intéressants, parce que les auteurs politiques écrivaient de véritables livres politiques, au sens politicien du terme. On a voulu montrer, que là aussi, dans le secteur de la politique, il y a des visages aussi passionnants que dans les autres secteurs de la connaissance. Ça a été ça notre objectif. Je ne sais pas si nous y sommes parvenus. Nous avons publié le livre de Michel Rocard, « Le cœur à l’ouvrage », où il y a mis beaucoup de lui-même ; un livre de Jacques Delors, peut-être un peu plus technique, juste avant Maastricht sur l’Europe ; des livres d’auteurs étrangers, le plus récent étant le livre de Monsieur Gorbatchev, là, c’est évidemment une expérience très différente, parce que je ne parle pas le russe, mais j’ai eu la chance de le rencontrer, et de pouvoir travailler avec lui sur son manuscrit.
Hubert Curien : Un autre point important, je pense, pour un éditeur, c’est que de façon calme et continue, une grande collection de livres, tels que ceux qui sont édités par Odile Jacob, influent sur la politique, et ici en particulier la politique de la science. Il est tout à fait évident qu’un très bon livre va braquer le projecteur sur un secteur, et tout naturellement créer un mouvement de développement dans ce secteur. Alors, ça peut être bénéfique, quelquefois, c’est un tout petit peu dangereux, parce que ça peut créer aussi des effets de mode. Jusqu’ici, je ne peux pas donner des exemples qui aient été pernicieux, mais un excellent livre sur le Sida, par exemple, pourra faire penser à nos concitoyens que c’est vraiment le problème biologique du jour, de l’année, du siècle, et que tout politicien, qui renâcle à mettre tout l’argent que lui demandent les scientifiques dans ce secteur, est un politicien qui se trompe. Souvenez-vous d’une énorme campagne, faite aux États-Unis, il y a quelques dizaines d’années, sur le cancer. Le président des États-Unis avait dit : « J’en fais mon affaire, du cancer. À la fin de mon mandat, on aura trouvé la solution du cancer. », il n’a pas dit ça comme ça, mais c’est ce qu’il avait en tête. Il a mis beaucoup d’argent, cet argent-là, il n’a pas été perdu, les scientifiques l’ont utilisé, mais bien sûr que non, en 3-4 ans, on n’a pas trouvé la solution. Ça a donné une impulsion. Je crois que les faits politiques sont importants, il faut qu’ils tiennent compte de la réalité scientifique. Et, quand on a un très bon livre, écrit par un scientifique qui a le goût de la politique, on peut bien recadrer ces affaires-là, n’est-ce pas ?
Odile Jacob : Justement, j’allais vous demander, comment est-ce qu’on choisit les priorités dans lesquelles on va investir ? Comment est-ce qu’on peut concilier, quand on est ministre de la recherche, à la fois le développement des grandes disciplines scientifiques, le développement de la physique, le développement de la neurobiologie, le développement des mathématiques ? Comment est-ce qu’on peut à la fois se tenir au courant, connaître les grands secteurs dans lesquels il y a de véritables révolutions, et en même temps concilier, je ne sais pas, l’aspect médiatique, les lobbies ? Comment est-ce qu’on arrive, je ne dirais pas naviguer, à concilier le développement intellectuel et l’aspect plus pratique, les pressions des autres ? Comment on fait des choix, finalement ?
Hubert Curien : Première réponse, il faut faire des choix. Deuxième remarque, ils ne sont pas faciles. Bon, tout ça, c’est une banalité navrante. En fait, il y a deux types de critères. Premier type de critères, le critère interne, c’est-à-dire l’état d’avancement de la science. On sait que la science étant dans tel état d’avancement, on a de bonnes chances de progresser assez vite, ici ou là, en un temps donné, à un moment donné, il faut tenir compte de ça, si on veut vraiment profiter des opportunités, il faut vraiment essayer de bien connaître la science de l’intérieur, et pousser les secteurs où on voit que ça bouillonne. Deuxièmement, la science coûte de plus en plus cher, donc la société, nos concitoyens qui payent pour la science, souhaitent aussi que les critères économiques et sociaux soient de plus en plus pris en compte. Quand je dis économiques, évidemment, mais de plus en plus sociaux, c’est tout à fait évident. Et, introduire ces critères économiques et sociaux, vous voyez qu’ils ne sont pas nécessairement congruents avec les critères purement scientifiques, mais la politique moderne de la science, ne peut absolument pas, cela serait criminel, ignorer cette pression naturelle du public. Cette pression naturelle du public, elle est quelquefois exacerbée par quelques événements majeurs, politique ou naturels, et, c’est là qu’on pourrait arriver, si on ne mettait pas un petit peu de freins à des exagérations.
Michèle Chouchan : Hubert Curien n’a pas encore commencé à écrire son ouvrage, est-ce que vous auriez des recommandations de style - en tout cas, je ne sais pas, peut-être qu’il a commencé après tout, je m’avance peut-être un peu - est-ce que vous avez des recommandations à lui formuler
Odile Jacob : Ce n’est le style, c’est donner le goût à ces auteurs de faire partager au plus grand nombre leurs préoccupations, leur domaine, et leurs idées. C’est le premier auteur à qui j’ai demandé un livre, Michel Jouvet, qui est le grand spécialiste du sommeil et du rêve, à Lyon, qui me disait : « Je suis en train de faire des découvertes très importantes, je n’ai absolument pas le temps d’écrire un livre » C’est le premier auteur à qui j’ai demandé un livre, début 1980, quand j’ai commencé mon métier, avant ma propre maison. Puis, un jour, c’était l’an dernier, il y a un an, Michel Jouvet est arrivé avec son manuscrit. Manuscrit inattendu, même si je savais qu’il réfléchissait, qu’il travaillait sur un roman scientifique, et il a écrit ce livre admirable, qui s’appelle « Le château des songes », qui est extraordinaire, parce qu’il concilie l’intérêt intellectuel, que nous pouvons tous trouver, concernant le domaine du sommeil et du rêve, et une qualité littéraire exceptionnelle, puisqu’il a choisi de d’écrire son roman dans la langue du XVIIIe siècle, et c’est vraiment très réussi. En même temps, nous nous sommes dit, pour les étudiants, pour des gens qui véritablement s’intéressent à comprendre le cheminement de ses découvertes, sur le sommeil et le rêve, est-ce que vous pourriez rédiger - j’ai demandé à Michel Jouvet - un essai plus technique sur le sommeil rêve, et le mystère, ce que nous avons découvert tous les deux, c’est que le même jour, nous avons publié les deux livres, le roman et l’essai, est que nous avons vendu et du roman et de l’essai, chacun des deux livres 50 000 exemplaires, c’est-à-dire 100 000 exemplaires.
-*-
Michèle Chouchan : Il y a une réelle volonté à l’heure actuelle, de la part des scientifiques, de la part aussi des autorités, qui définissent les politiques de recherche, de définir également une politique de communication, en sorte qu’on retrouve la même volonté de communication avec les entreprises, c’est-à-dire que les scientifiques ne peuvent plus seulement être des chercheurs de laboratoire, enfermés dans une incommunication avec la cité, Bernard Decomps.
Bernard Decomps : Vous êtes en train de poser le problème de l’expertise auprès de la société, auprès des citoyens, auprès de ses voisins, auprès des non spécialistes, parce que les industriels sont des spécialistes, et en quelque sorte le problème est un problème de traduction, entre deux logiques de spécialistes. Là, le problème est nettement plus complexe, puisque nous devons apporter des réponses à des questions, qui sont posées par la société, est-ce qu’il est dangereux de boire du Perrier parce qu’il y a des bulles, ou je ne sais plus trop quel gaz, qui est à des doses infinitésimales ? C’est un problème que …
Hubert Curien : C’est un problème que se posent les Américains …
Bernard Decomps : … et qui a conduit à une modification tout à fait substantielle de la fabrication de l’eau Perrier, même en Europe. Qui va y répondre ? Avec quelle garantie ? Avec quelle déontologie ? De quelle façon les organismes de recherche vont servir à aider à cette expertise ? De quelle façon va-t-on l’organiser, l’authentifier ? Non pas pour dire qu’il va y avoir la science officielle et la science non officielle, mais tout simplement pour dire que telle et telle réponse a été apportée dans des conditions à peu près convenables. C’est un problème tout à fait essentiel, et je dirais même qu’il rejoint un problème d’indépendance nationale. L’indépendance nationale ne peut pas vouloir dire être les premiers ou être les leaders sur tous les fronts, c’est peut-être encore valable, et à mon avis, pas pour très longtemps pour les États-Unis d’Amérique, mais aucune communauté nationale, en dehors des États-Unis d’Amérique, ne peut y prétendre. Je crois que l’indépendance nationale, dans ce contexte-là, veut dire d’avoir des chercheurs, qui progressent dans un domaine parfaitement déterminé, parfaitement fini, mais pour y progresser utilement, ils doivent avoir des connaissances dans un champ, un peu plus large que leur spécialité, et ce champ étend le chant de leur expertise. On peut donc imaginer un système dans lequel nous ne progresserions que dans un nombre fini, que sur un nombre fini de thèmes, mais dans lequel ces thèmes permettrait pour leur bon développement d’avoir une idée, une expertise, qui couvre, alors là, l’ensemble des domaines. Je crois que c’est extrêmement important. D’abord, parce que ceci permet de capter toutes les bonnes idées d’où qu’elles viennent au niveau du monde, et deuxièmement ceci est la bonne couverture, pour pouvoir répondre à la multiplicité des questions de société, qui n’ont que faire des disciplines et des sujets de recherche.
Quand on vous pose un problème, comme je vais en poser un, que tout le monde pose, tous les jours, dans Le Monde, dans Le Figaro, il n’y a pas de journée dans laquelle vous n’avez pas un article de fond sur « est-ce que la technologie favorise le chômage ou au contraire lutte contre le chômage ? », personne n’a la réponse, ou alors elle est bien cachée, et je ne sais pas lire les articles qui nous sont proposés. Personne n’a la réponse ! Poser comme ça, ce n’est pas une question scientifique. Il faut la décomposer suivant des axes relativement fins, et faire appel à des économistes, à des technologues, à des spécialistes de telle et telle branche, à des spécialistes de la macroéconomie, comme à des spécialistes de la microéconomie, à des sociologues, à des anthropologues, et je dirais que c’est une fois qu’on va avoir rassemblé toutes ces choses-là que nous pourrons éventuellement dire : « Ben, oui, peut-être que les technologies ne sont pas aussi utiles que ce que l’on avait pensé pour lutter contre le chômage, mais que peut-être que c’est dans l’organisation de la société que va se trouver l’essentiel des gains là-dessus », mais peut-être qu’elle dira le contraire. Je dirais qu’aujourd’hui c’est un problème ouvert.
Hubert Curien : Ouvert, mais combien important !
Bernard Decomps : … essentiel, mais il nous faut des recherches sur ce type de problèmes. Voilà, le sens de l’expertise, et voilà en quoi, à mon avis, un pays comme la France se doit d’avoir une couverture de sujets, non pas qui lui permet d’avoir tous les fronts, mais toutes les expertises.
-*-
Michèle Chouchan : Il y a quand même quelque chose que vous n’avez pas réussi, en tant que ministre, pourtant vous aviez mis de l’espoir là-dedans. C’était la présence de la science à la télévision
Hubert Curien : Vous avez raison. Nous avons fait quelques pas, je veux dire en avant, mais il en reste beaucoup à faire. Lorsque j’ai commencé cette croisade auprès des directeurs de chaîne, auprès des producteurs, j’étais bien accueilli. Chacun m’a dit : « Ah, comme vous avez raison ! », « Ah, oui, quelle erreur de notre part, de ne pas faire passer plus de sciences à la télévision … » Mais, ces paroles n’ont pas toujours été suivies de beaucoup d’effets, quelques effets, mais pas beaucoup d’effets, parce que les responsables de télévision ont naturellement le souci de l’audience, puisqu’ils vivent, en partie au moins, de la publicité. Donc, l’audimat est pour eux un instrument un peu trop présent à mon sens, mais je n’ai pas à critiquer l’esprit dans lequel ils ont à équilibrer leurs comptes. Bref, pour eux, ile sentiment est encore vif qu’une émission scientifique est un appel au zapping. Les tordes sont partagés, beaucoup de nos collègues scientifiques, sollicités pour faire des présentations à la radio ou à la télévision, ne font pas toujours l’effort pour adopter les méthodes qui sont propres à ces moyens de diffusion.
Michèle Chouchan : Il y a quelques temps, vous avez été élu président du CERN, ça devait quand même être un moment de grande émotion, après les réussites de type Charpak, par exemple ?
Hubert Curien : Oui. Le CERN, centre européen de recherche nucléaire, qui est situé à Genève, juste à cheval entre la Suisse et la France, est un très grand établissement. Je crois que nous pouvons le qualifier de prototypes du grand établissement international de recherche, vraiment internationale de recherche. C’est un établissement européen, une Europe assez large, maintenant qu’elle s’étend assez fortement à l’Est. Là, on construit des accélérateurs pour essayer de comprendre la nature ultime de la matière. Au-delà de l’atome, au-delà des particules qu’on a déjà bien identifiées dans l’atome, qu’est-ce qu’il y a ? Quelles sont les forces élémentaires qui font la nature dans le monde est ce qu’il ? Comprendre ça, c’est vraiment l’honneur de l’homme. Je crois que, j’évoque souvent le Bon Dieu, avec conviction d’ailleurs, si le Bon Dieu a fait l’homme, c’est pour que l’homme s’excite à essayer de comprendre tout ce que le Bon Dieu avait imaginé, et ce qu’il nous cache encore. Bon, on fait ça au CERN.
Le CERN est d’abord, un milieu où se retrouvent des physiciens d’une très grande qualité. Je crois que nous concitoyens européens ne sont pas assez fiers du CERN. Ils devraient savoir qu’au CERN viennent actuellement quatre fois plus de physiciens américains qu’il n’y a de physiciens européens, qui vont travailler sur des machines de même nature aux États-Unis. Quatre fois plus ! Il y a quelques temps, c’était autant, mais maintenant, c’est quatre fois plus ! Le CERN est donc un foyer d’attraction, pour les meilleurs physiciens du monde, ce qui est considérable, c’est un des fleurons de l’Europe scientifique. Donc, être nommé, élu, président du conseil de cette assemblée, je le ressens comme un très grand honneur, c’est vrai.
Michèle Chouchan : À titre documentaire, on passe en revue quelques-unes des présidences que vous assurez ?
Hubert Curien : Mon épouse trouve que j’en assure trop. C’est très agréable d’être président.
Michèle Chouchan : Vous avez dit que vous adoriez ça, que vous adoriez présider les réunions.
Hubert Curien : Oui, c’est bien plus agréable, dans une réunion, d’être président que d’être membre, parce que président, d’abord on se sent un peu plus de responsabilité, et on a le sentiment qu’on aura le droit de présenter son propre point de vue, en général on s’arrange pour le faire présenter par quelqu’un d’autre, c’est plus discret, et on aura surtout le plaisir d’essayer de trouver, dans ce que chacun a dit, ce qui est essentiel. Là, je ne veux pas me faire des compliments trop marqués, mais on me reconnaît en général la qualité d’assez bien résumer ce que chacun a dit. Vous ne pouvez pas savoir – si, vous le savez bien -le plaisir qu’on fait à chacun en disant : « Ah, dans ce que vous avez dit, ou dans ce que tu as dit, il y a ça, qui est particulièrement important ! », alors là …
Michèle Chouchan : Vous avez quand même une grande maîtrise de la technique de groupe …
Hubert Curien : Oui, il y a un petit truc, là …
Michèle Chouchan : … un petit peu de manipulation …
Hubert Curien : Ah, non, pas du tout ! Alors là, pas du tout.
Michèle Chouchan : … une connaissance, à partir du moment où vous tirez parti, effectivement vous faites plaisir à tout le monde, et en même temps ça fait avancer les choses. Le fait de savoir que ça fait plaisir, ça fait partie de la technique qu’on maîtrise.
Hubert Curien : Absolument !
Des présidences, j’ai l’honneur d’un assurer quelques-unes. Il y a une, qui est toute récente, dont je mesure assez fortement d’importance, même si, vous allez voir, que physiquement ça ne représente pas un très grand groupe de personnes. Nous avons à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, l’entourage de la rue d’Ulm, la rue Pierre et Marie Curie, un grand nombre d’institutions scientifiques. Nous avons imaginé que ces institutions scientifiques pourraient, ne pas se grouper administrativement, mais avoir une espèce d’émanation, de réflexion, et nous avons créé une association de la Montagne Sainte-Geneviève, qui groupe quatre belles institutions, qui sont : l’École normale supérieure, l’école de physique et chimie de la ville de Paris, l’Institut Edmond de Rothschild biologie physico-chimique et l’Institut Curie.
Autre présidence, les collègues européens viennent de me faire l’amitié de m’élire à la présidence d’une académie européenne, qui s’appelle -on avait hésité beaucoup à lui trouver un nom, parce que quand on fait quelque chose d’européen, le nom dans quelle langue le choisissez-vous, là on a choisi le latin - Academia Europaea [10], c’est-à-dire l’Académie de l’Europe. Nous avons pensé, il y a quelques années, - quand je dis-nous, ça veut dire quelques britanniques, quelques Allemands, quelques français et quelques scandinaves – qu’il était nécessaire d’avoir, non pas une espèce de fédération des académies existantes, mais un forum de réflexion, où des scientifiques de bonne compagnie, et si possible de bonne qualité, puissent se rencontrer et discuter des problèmes scientifiques, vu avec un verre, peut-être un peu déformant, mais quelquefois nécessaire, un verre européen. Travailler sur la science, en essayant de voir comment on peut améliorer les procédés, les recrutements, les mobilités au sein de l’Europe, de tout le petit monde scientifique.
-*-
Michèle Chouchan : Vous avez réussi à faire transformer le Ministère de la recherche et la technologie, en un ministère de la recherche et l’espace.
Hubert Curien : Non, ne dites pas comme ça, je ne l’ai pas réussi, parce que je ne l’ai pas demandé.
Michèle Chouchan : Mais, ça concordait quand même avec votre souhait.
Hubert Curien : Non, écoutez, je dois être très franc, là. Je crois que quel que soit le goût particulier, et la propension que j’ai vers l’espace, je trouve que le ministère tel qu’il était défini, sous le titre « recherche et technologies », avait une excellente définition, et comprenait en particulier l’espace. Pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, et que j’ai naturellement admises, lorsque le Premier ministre, qui formait le gouvernement, et le président de la République m’ont consulté, d’avoir un ministère de la recherche de l’espace, était bien. J’avais simplement regretté une chose, c’est que le ministère perde le mot technologie, ce qui a créé un certain flottement, et j’ai été obligé de donner un certain nombre de coups de téléphone pour assurer les gens, en disant : « Vous savez, technologie n’est pas dans le titre de mon ministère, c’est parce que le Président de la République n’aime pas les ministères qui ont trois noms, il en fallait deux, et pour des raisons diverses, il était intéressant, politiquement, de mettre espace, mais technologies, rassurez-vous, il est, entre parenthèses, entre recherche et espace. »
Michèle Chouchan : À quel moment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à tout ce qui concerne l’espace ?
Hubert Curien : Par le hasard le plus grand.
Michèle Chouchan : … parce que c’est quand même une partie de votre vie, qui fait partie de vos centres d’intérêt et un grand engagement.
Hubert Curien : Extrêmement importante, oui, absolument, et auquel je suis vraiment maintenant viscéralement attaché. Par le plus grand des hasards, voilà ce qui s’est passé. J’étais, en 1976, Délégué général à la recherche scientifique et technique, c’était un poste qui n’existe plus maintenant. À cette époque-là, il n’y avait pas régulièrement un ministre chargé de la recherche, et il y avait un Délégué général, qui rapportait au Premier ministre. Il n’avait pas du tout le rôle de ministre, ni même de secrétaire d’État, mais qui faisait à peu près le même travail qu’un secrétaire d’État à la recherche. Ce poste avait été occupé par des gens comme Pierre Piganiol, André Maréchal et Pierre et Aigrain, auquel j’ai succédé. J’étais là, depuis 1973, il s’est trouvé que je n’étais pas extrêmement content du budget de la recherche, tel qu’il avait été préparé par mon ministre.
Michèle Chouchan : Qui était qui à l’époque ?
Hubert Curien : Qui était Monsieur d’Ornano [11]. Un bon ministre d’ailleurs, avec lequel je m’entendais bien, mais il m’a semblé qu’il était de mon devoir de lui dire … ça l’a un peu choqué, je dois dire. Et, tout à fait à la même semaine, il s’est passé un autre événement, il y a eu un remue-ménage à Toulouse, au CNES, où les employés du CNES n’étaient pas très contents d’une mesure, qui avait été prise pour réduire les crédits. Vous voyez, ça procède du même esprit, et alors, grève au CNES. Du coup Monsieur d’Ornano se fâche en disant : « Quoi, grève au CNES ? Je change de président ! » Il m’appelle le mardi et il me dit : « Monsieur Curien, j’ai besoin de vous » _ « Monsieur le Ministre, je suis à votre disposition. » _ « J’ai besoin de vous pour présider le CNES » _ « Attendez, Monsieur le Ministre, je suis Délégué général. » _ « Oui, vous êtes Délégué général, mais j’ai besoin de quelqu’un … » Et ainsi, le mercredi, le lendemain, j’ai été nommé président du CNES. Vous voyez, ma vocation spatiale a été un peu contingente.
-*-
24 décembre 1979. Extrait des infos : Au sommaire ce soir, bon vent Ariane, la troisième fois a été la bonne, la fusée spatiale européenne vole de ses propres réacteurs. Lancement réussi 5 sur 5. Michel Forgit [12] nous attend au PC du Centre national d’études spatiales. Tout vient à point, à qui sait attendre, la fusée européenne Ariane s’est conduite un peu comme une jolie femme, elle a posé deux lapins à ses admirateurs, mais finalement elle a récompensé leur patience. Après deux faux départs, hier et l’autre samedi, Ariane a enfin quitté sa rampe de lancement. Il était très exactement 18 h, 14 minutes et 36 secondes, une journée encore fertile en suspense, puisque à trois reprises le compte à rebours a été interrompu, mais maintenant tout cela est dépassé, Ariane, la fusée blanche, a prouvé qu’elle fonctionnait bien. Au centre spatial de Kourou, en Guyane, les techniciens ont débouché le Champagne. Michel Forgit, j’imagine que c’est également la joie à Évry, au PC du Centre national d’études spatiales ? Michel Forgit : Eh bien, je peux vous dire qu’effectivement c’est la fête, ici. C’est la grande joie. À propos de cette fusée et de ses arrêts de compte à rebours, on peut dire qu’a aucun moment la fusée n’a été mise en cause, les techniciens ont péché en fait par excès de prudence. En effet, ils avaient confié à un ordinateur les 6 dernières minutes, - c’est presque le titre d’un feuilleton à la télévision - qui étaient entièrement automatiques, et lorsqu’un feu rouge s’allumait quelque part et bien tout s’arrêtait, il fallait recommencer à zéro, même si cela indiquait une panne minime, ou même une panne qui n’existait pas. Finalement tout a bien fonctionné, la fusée s’est mise à feu, comme prévu, elle a suivi sa bonne trajectoire, et actuellement sa capsule technologique s’en va jusqu’à 36000 km de la Terre pour revenir à 200 km. On peut dire qu’aujourd’hui, le monopole américain, en matière de télécommunication, a disparu. L’Europe est devenue une puissance spatiale de première grandeur, et elle pourra mettre sur orbite les satellites de télécommunication..
-*-
La Société européenne de propulsion à Vernon, dans l’Eure.
XXX Là, c’est Véronique, qui est à l’origine de la technologie Viking, les deux premiers étages d’Ariane, et ici le premier moteur à hydrogène et oxygène liquide ayant fonctionné en Europe, le 21 juillet 1967, à partir de travaux qui avaient commencé dès 1960. C’est le fait que ce moteur ait fonctionné convenablement pendant deux ans, qui a permis de prendre la décision de …
Commentateur, sans doute un audiovisuel du musée : Ce modèle va donner naissance à la famille des moteurs Vikings, les premières mises à feu sont assez surprenantes.
XXX : Ici, Véronique, qui est un modèle de simplicité, des années 50, mais la dernière Véronique a volé en 1975. On va retrouver sa technologie dans le premier étage de Diamant, qui est ici, qui a volé il y a plus de 25 ans, le 26 novembre 1965.
En parallèle, l’Europe essayait de se faire déjà, avec le programme Europa 1, qui est devenu Europa 2, l’Angleterre avait un premier étage, qui n’est pas ici. Le second étage est là, et reprend, en gros, les mêmes principes que le premier étage de Diamant. Le troisième étage, lui, était allemand, chaque pays avait son étage alloué.
Le passé très lointain, c’est la V2, qui a été reconstruite par des techniciens allemands, qui sont arrivés à Vernon juste après la guerre. Et pour garder la mémoire, il n’y avait pas un maître d’œuvre dans cette équipe de techniciens, ils ont donc décidé de reconstruire un modèle, pour essayer de garder un maximum la mémoire technique de ce qu’ils avaient fait chacun dans son domaine.
Commentateur, sans doute un audiovisuel du musée : Des essais de groupement des quatre moteurs du premier étage ont lieu à Vernon, tandis que le moteur Viking, qui équipe le deuxième étage, est essayé en Allemagne.
XXX : Quand on regarde cette machine, pour revenir sur cette impression de masse de la V2, cette turbopompe, qui sert à alimenter le moteur, de 25 tonnes de poussée, elle est, à peu près, aussi grosse que celle des moteurs Vikings actuels, elle fait seulement 500 chevaux, alors que sur le moteur Viking, qui n’est pas le summum dans le domaine, la puissance est de 3000 chevaux. Ceci nous met loin des pompes de Vulcain, qui pour des tailles à peu près comparables, atteignent 16 000 chevaux.
Commentateur, sans doute un audiovisuel du musée : Allumage réussi. Quatre secondes sur la plateforme pour vérifier les systèmes, et c’est le décollage ! L’ascension est très majestueuse, lourde d’abord, puisque la poussée dépasse à peine le poids, mais celui-ci diminuant au fur et à mesure que les combustibles sont consommés, c’est une accélération qui va devenir de plus en plus importante, tandis qu’une phase d’ascension verticale va bientôt succéder …
-*-
Hubert Curien : Je connais Ichtiaque Rasool depuis très longtemps. En fait, Ichtiaque Rasool est une personnalité, que tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’espace ont l’habitude de côtoyer et d’interroger.
Ichtiaque Rasool : Je suis parti de l’Inde en 1948-49, après la séparation de l’Inde avec le Pakistan. Il y a eu une grande émeute, comme vous savez, il y eut quelques dizaines de millions de personnes qui ont été tuées. Je suis venu en bateau comme « boat-people », avec ces bateaux cargos de marchandises. Après le Pakistan, un jour je faisais le stop, et j’ai été pris par une voiture, dans laquelle il y avait un Anglais qui travaillait en France. En fait j’avais laissé passer deux trois voitures, parce que je voyais qu’elles n’étaient pas climatisées, j’attendais une belle voiture pour faire le Stop. Ce monsieur anglais m’a engagé la semaine d’après, comme son assistant. J’avais 18-19 ans, et trois ans après, il m’a fait avoir une bourse pour venir en France.
Ma raison d’être en ce moment est de promouvoir la recherche sur la planète Terre pour l’ensemble des questions qu’on se pose souvent : est-ce que la Terre va se chauffer à cause du gaz carbonique ? Est-ce que les niveaux des mers vont monter à cause de ce réchauffement ? Quel est le taux de déforestation dans le monde ? Ce sont des questions globales, qui ont des conséquences, ça pourrait être assez important dans l’avenir. Jusqu’à présent on a étudié la Terre par petits morceaux, on a étudié la culture en Afrique ou ailleurs, la géologie de certaines régions, mais tout d’un coup, on se commence à s’intéresser à la planète dans son ensemble, surtout avec les mesures des satellites.
Il y a beaucoup de mesures de satellites qui existent, et en ce moment j’essaye de faire utiliser ces données acquises par les satellite japonais, français et américains, les mettre ensemble, comme une base de données globale, pour étudier ce qui se passe sur le terrain, est-ce que la Terre se chauffe vraiment ? Vous n’allez pas croire qu’il n’y a pas de preuves jusqu’à présent. Quel est le taux de déforestation dans le monde ? Il y a des chiffres très différents, basés sur différents satellites, ça varie entre 80 000 km² par an, donnés par un scientifique, un autre scientifique vient de dire que c’est seulement 15000 km² par an. Il y a une différence énorme dans les méthodes utilisées par différents pays, différents scientifiques.
Hubert Curien : C’est assez exaltant, n’est-ce pas, d’avoir tous ces collègues, venant d’horizons divers, avec des cultures très diverses, que vous sentez unis par, premièrement la méthode scientifique et deuxièmement le souhait de faire quelque chose pour la planète.
Ichtiaque Rasool : Exactement. En ce moment j’ai un petit problème, je peux vous le dire, dans les pays en voie de développement, pour expliquer aux Africains ou aux Asiatiques, même dans mon pays, en Inde, pour avoir les données des satellites indiens pour la recherche globale, c’est compliqué. Il y a beaucoup de pays qui, en ce moment, se concentrent sur des problèmes locaux, et pour leur expliquer que c’est utile pour le problème global, il y a leurs problèmes stratégiques. Par exemple, la déforestation en Afrique, le feu de forêts en Afrique, qui donne presque 1 milliard de tonnes de carbone dans l’atmosphère, les feux de forêts dans le monde, ça augmente l’ozone dans l’Antarctique, ça détruit l’ozone dans notre atmosphère, donc on commence à comprendre qu’il y a l’effet global par les changements locaux de surface. Mais, c’est un problème difficile à expliquer.
Hubert Curien : C’est difficile à expliquer. Et puis, il y a aussi un autre aspect des choses, c’est que tous les pays du tiers-monde sont extrêmement intéressés par tous les renseignements qui peuvent être donnés par les satellites, mais ils n’ont pas de quoi les payer. Donc, il faut que nous imaginions un système de solidarité, c’est en très bonne voie, pour que les clients intéressés et pauvres, puissent être servis grâce à la compréhension des pays plus riches.
Ichtiaque Rasool : C’est ça que nous, on est en train de monter en ce moment, cinq centres régionaux en Thaïlande, en Amérique du sud, il y a la France qui est en train de mettre en place un centre à Toulouse, qui travaillera avec Niamey, qui s’appelle MEDIAS, et après MEDIAS l’Europe de l’Est, en Russie, j’espère, et en Chine. Ces gens qui sont connectés ensemble, pour analyser leurs données de satellite, et nous, dans les grands centres, bien équipés, on va faire une base de données globale.
Hubert Curien : Finalement, ce qui est merveilleux dans la science actuelle, dans la recherche actuelle, c’est qu’on est capable de s’attaquer à des problèmes tels que la vie, l’évolution de la planète Terre, qui paraissaient absolument en dehors de toute possibilité, il y a encore une cinquantaine d’années, parce qu’on n’était pas capable d’appréhender en même temps, pour un seul problème, un nombre de variables considérables.
Michèle Chouchan : Mais ce que réclame parfois le public, ou ce que réclament un certain nombre de médiateurs, ce sont des certitudes.
Hubert Curien : Mais, bien sûr, c’est bien plus facile des certitudes.
Ichtiaque Rasool : C’est très difficile de prouver le négatif. On dit que l’ozone a diminué sur l’Antarctique, on appelle ça le trou d’ozone, découvert il y a seulement 10 ans, parce qu’on a les mesures satellitaires depuis 1979, il y a 15 ans, les gens peuvent tout de suite dire, comment pouvez-vous savoir qu’il n’y en avait pas avant. Est-ce un problème naturel fait par l’homme ? Il y a eu une grande polémique en France, et maintenant aux États-Unis, c’est très intéressant, parce que le devoir des scientifiques est de montrer, de donner les preuves, on a pensé qu’on avait donné les preuves en montrant que le chlore est présent dans la stratosphère, et on a montré dans le laboratoire que le chlore, cl, quand il réagit avec ozone, détruit l’ozone, comme on a mesuré la diminution d’ozone, on a là le problème. D’autres gens arrivent et disent, le chlore, vous dîtes que ça vient des CFC, mais le chlore vient aussi des volcans et aussi des chlorures de sodium des mers qui vont dans l’atmosphère, comment savez-vous que ce n’est pas les volcans ou les mers ? La quantité de chlore émise dans l’atmosphère par les CFC est moindre que celles émises, de temps en temps, par les volcans, comme le Pinatubo. En ce moment, il y a un grand problème pour prouver que le chlore de la stratosphère en Antarctique, qui détruit l’ozone, vienne des CFC et non par des processus naturels.
Michèle Chouchan : Cela dit, cela mérite quand même la vigilance, il y a quand même une responsabilité individuelle, que le scientifique doit faire partager à ses …
Ichtiaque Rasool : C’est vrai, dans l’ensemble c’est vrai, mais de temps en temps il y a un scientifique, qui est beaucoup plus convaincant qui va au Sénat américain, les médias le reprennent, et puis après il y a un autre scientifique qui arrive pour dire que ce n’est pas vrai. Donc, le débat continue, c’est le processus scientifique. C’est comme la tectonique des plaques, prévue par un scientifique, il y a 100 ans, mais il a fallu 100 ans de mesures magnétiques et géophysiques pour prouver, sans doute maintenant, qu’il y a des mouvements des continents.
Hubert Curien : Un autre exemple de superbes précisions est dans la mesure de l’altitude du niveau des océans. Vous me direz qu’au niveau des océans, c’est tout plat, il y a des vagues, certes, mais si vous faites la moyenne … Non, il y a des bosses, des creux sur les océans. On a lancé - quand je dis on, cela veut dire les Américain et Français - un satellite, qui s’appelle TOPEX-Poseidon, qui mesure en moyenne la surface de la mer, à quelques centimètres près.
Ichtiaque Rasool : C’est formidable comme précision. Nous avons travaillé 10 ans pour pouvoir lancer ce satellite, conjointement avec la France et l’Amérique. Maintenant, on essaye de faire, avec ce satellite, la topographie, à 10-5 cm près, du monde entier, tout le temps. Pourquoi on fait ça ? Parce qu’avec ça, on peut mesurer l’intensité des courants, comme le Gulf-Stream ou le Kuro-Shivo. Quand les courants s’avancent, avec la rotation de la terre, ça colle vers la côte américaine, et comme c’est plus chaud que le reste de l’océan, il y a l’expansion de l’eau, et avec la vitesse, il y a le changement de la topographie, ça fait une bosse. Ce que l’on a découvert aussi par des satellites, c’est le tourbillon, les grands tourbillons dans les mers, qui amènent beaucoup d’énergie vers le nord. Pour la première fois, on pourrait calculer vraiment, s’il y a une variation de long terme du climat global à cause des variations de l’intensité de ces courants.
Hubert Curien : Quand vous dites long terme, Ichtiaque, vous pensez à quelques siècles ?
Ichtiaque Rasool : Quelques siècles, c’est ça. Vous savez qu’il y a un problème, Monsieur Curien disait tout à l’heure, qu’on fait des mesures si précises, de quelques centimètres près, vous pouvez tout de suite vous demander pourquoi ne on voit pas qu’il y a un changement du réchauffement de la terre, on ne peut pas prouver ça, c’est ça le problème. Il y a toujours la réticence pour accepter. C’est pour cela qu’il faut étudier non seulement la variation à cause de l’homme, mais aussi les variations naturelles. Il y a beaucoup de changements globaux en ce moment à cause des changements de vitesse de circulation des océans, il y a un phénomène qu’on a découvert aussi récemment, prouvé qu’il existait, c’est les phénomènes El Niño. Tous les 10 ans ou les 5-6 ans, le Pacifique équatorial se réchauffe de 2-3° C pendant un an. Et cette petite augmentation de température de 2°C ou 3° C, change le climat mondial.
Hubert Curien : Ce qui est important pour un scientifique, c’est de bien connaître ce qu’on appelle les cycles de tel ou tel matière naturelle. Les cycles du gaz carbonique, les cycles de l’eau, les cycles du chlore, en regardant toutes les sources et tous les puits, c’est-à-dire toutes les manières de faire disparaître, peut-être provisoirement.
Ichtiaque Rasool : C’est ça. Je vais donner l’exemple du gaz carbonique. Toutes les voitures du monde, en ce moment, et toute l’industrie, rejettent dans l’atmosphère 5 milliards de tonnes de carbone tous les ans. Ces 5 milliards de tonnes, comme il y a, comme par hasard, 5 milliards de personnes aussi dans le monde, c’est une tonne par personne par an, c’est vous et moi. Par contre, aux États-Unis, c’est à peu près 4 tonnes par personne et en Chine c’est seulement 200 kg, mettons. Comme la population de la Chine est beaucoup plus grande, si ça continue à évoluer de la même façon, ça pourrait être un problème. Mais, ces 5 milliards de tonnes, c’est seulement 1% de ce qui existe vraiment dans l’atmosphère, et ça change en été et en hiver, à cause de la végétation, c’est quelques dizaines de milliards de tonnes aussi. Alors, comment déterminer quel est l’impact de cette petite augmentation, sur un cycle qui est saisonnier ou annuel ? Par contre, il y a un autre problème, c’est que ces 5 milliards de tonnes continuent depuis 20 ou 30 ans. Si cela continue pendant encore 50 ans, ça va doubler le gaz carbonique dans l’atmosphère. Le problème scientifique en ce moment est que si cela double, il va y avoir le problème d’effet de serre. Dès qu’on commence à calculer les conséquences de cette augmentation, il y a tous les autres problèmes, parce que si la terre se réchauffe, l’eau va s’évaporer plus vite, donc il y aura plus de nuages, et si vous dites qu’il y a plus de nuages, le soleil est moindre, cela va refroidir, c’est feedback négatif, le système doit rester stable. Les autres disent, ça dépend de quels nuages qui vont se former en plus, des cumulus ou des cirrus … Voilà les grands débats en ce moment. En France d’ailleurs, c’est formidable, parce que c’est la seule équipe dans le monde, Monsieur Curien, qui vient de faire une simulation globale, de l’augmentation des nuages, à cause du changement climatique de 1°C ou 2° C, comparée avec les mesures des satellites.
-*-
5, 4, 3, 2, 1, stop, allumage.
Michèle Chouchan : Le retour sur la Lune, on peut y retourner à quelle échéance ? Il y a des tas d’études sur le béton lunaire, sur des tas de choses, mais a-t-on les installations ?
Hubert Curien : : Le retour sur la Lune, tous les spécialistes vous disent que cela se fera. Ça se fera très évidemment. On en donne quelquefois des raisons, qui ont l’air d’être complètement évaporées. Par exemple, aller exploiter une certaine variété d’hélium sur la Lune, qui s’est formée parce que la Lune n’ayant pratiquement pas d’atmosphère, les rayonnements, très durs, venant du soleil ont pu induire un certain nombre de réactions nucléaires. Oui, peut-être, mais ce que les scientifiques voient comme intérêt essentiel, c’est d’installer une base de caractère astronomique sur la face cachée. Ça, tout le monde est bien d’accord, le plus bel observatoire qu’on puisse imaginer, qui n’est pas trop loin, 300000 km, ce n’est pas terrible, c’est vraiment la Lune. Là, tranquille, pas d’atmosphère, des tremblements de Lune, je crois qu’il n’y en a pas, sauf quand il y a des météores qui tombent dessus. Si, vous vous mettez sur la face cachée, vous voyez, vous êtes bien protégé de toutes les pollutions de radiations radioélectriques, qui peuvent venir d’émetteurs terrestres, par exemple, là vous auriez une base d’observation de l’univers qui serait formidable. Il faut entretenir naturellement une cantine et un dortoir convenable, c’est quand même un problème, pas vraiment technique, mais de gros sous. Ça coûte cher.
Je ne sais pas ce que pense Monsieur Luton, mais il me semble quand même que ça, c’est un projet d’avenir.
Jean-Marie Luton : Ça, je dirais que c’est tout à fait un projet d’avenir. Il y a en plus dans ce domaine, par rapport à d’autres débats, qui existent aujourd’hui, un consensus des scientifiques ce sur ce point-là.
Michèle Chouchan : Quel point ? L’observatoire ?
Hubert Curien : D’une base sur la Lune, oui
Jean-Marie Luton : Quand je suis arrivé à l’Agence spatiale européenne (ESA), on parlait de faire ces études et de faire l’atelier dont parle le ministre. Eh bien la première chose dont je me suis aperçu, c’est que dans la communauté scientifique, il n’y avait pas de réactions a priori contre, avec un dogme, en disant non, c’est encore une fois l’aventure, cela ne nous intéresse pas, et on nous mettra sur le dos la responsabilité d’avoir donné l’intérêt scientifique, pour justifier une telle mission. Non, ils l’ont pris sous l’angle vraiment de qu’est-ce qu’on va faire avec ? Et, quelles sont les bonnes idées ? Donc, je trouve que l’approche est tout à fait importante.
La deuxième chose, c’est que dans une affaire de ce genre, il est clair que vu l’ampleur des coûts, et je dirais de la volonté politique, pour maintenir une exploitation, par exemple sur une dizaine d’années, comme dans une base antarctique, là, c’est une coopération mondiale. Je dirais qu’indépendamment de ce but final, nous l’Europe, nous allons regarder dans les travaux des années qui viennent, quel pourrait être une espèce de projet de moyens communs, qui puissent être utilisés dans tels cas, et qui pourraient être utilisés sur d’autres activités hommes dans l’espace, pour l’Europe.
Michèle Chouchan : Et du côté de Mars, quels sont les projets, les perspectives ?
Hubert Curien : Du côté de mars, il y a des choses très tangibles, déjà décidées, une mission Mars 95 …
Jean-Marie Luton : Mars 94, vous pensez qu’elle a déjà glissé, formellement …
Hubert Curien : Oui, elle a déjà glissé, je le crains. Mars 95, est une mission décidée, qui implique les Français, les Russes, et d’autres aussi Monsieur Luton ?
Jean-Marie Luton : Les Allemands, et même l’ESA.
Hubert Curien : L’ESA aussi a une participation, c’est naturellement une mission non-habitée, mais avec des engins extrêmement astucieux, plusieurs d’ailleurs de conception française, qui sont dus à l’imagination de notre collègue et ami Blamont. C’est vraiment très séduisant. Ensuite, on peut se dire pour l’humanité, est-ce que cela serait un grand pari, l’idée d’un homme sur Mars à telle date ? Oui, mais les missions automatiques sur Mars peuvent encore nous apporter beaucoup, beaucoup, et la difficulté, vous le voyez bien, la Lune, c’est vraiment l’approche banlieue, 300000 km, on sent que c’est humain, dans la dimension, il ne faut pas tellement le temps pour y aller, tandis que pour aller sur Mars, avec les moyens dont on dispose actuellement, et dont probablement on disposera encore dans quelques années - pas mieux, je veux dire - il faut presque une année pour aller une année pour revenir, il faut tout de même rester là-haut, plus longtemps qu’un week-end, à vrai dire, avoir des personnes humaines dans des conditions aussi anormales pendant plusieurs années, c’est un risque que pour l’instant, je crois, que personne ne prendrait..
-*-
Hubert Curien : : Il y avait eu une crise, au début des années 70, assez profonde, c’est qu’il y avait deux grandes organisations européennes qui s’occupaient d’espace. L’une s’appelait l’ELDO, s’occupait de lanceurs, l’autre s’appelait l’ESRO, s’occupait des satellites. L’ESRO avait bien réussi, tous les satellites qui avaient été conçus puis réalisés par cette agence avaient donné de bons résultats scientifiques, et avaient prouvé la capacité technique des industriels qui les avaient construits. Quant à l’Agence ELDO, qui s’occupait de lancement, le succès n’était pas là, c’était venu du fait que la définition de la coopération n’était pas bonne. La coopération avait été conçue un petit peu dans le genre de Babel, chacun continuait à parler sa propre langue, au sens technique du terme, j’entends. Chacun voulait caser dans cette fusée le morceau qu’il savait faire, or on n’était pas au balbutiement en Europe pour les fusées, on savait faire des fusées, modestes en taille, mais des fusées qui marchaient, notamment pour la météorologie, les militaires. Tous ces pays-là s’étaient dit, nous allons reprendre un morceau de ce que nous avons déjà fait, en assemblera ces morceaux et ça fera une fusée qu’on appelle Europa.
France Inter, le vendredi 19 juin 1981 : « Ariane bonne pour le service. La fusée européenne a décollé en début d’après-midi de la base spatiale de Kourou. Le lanceur a permis de placer sur orbite deux satellites : un Météosat, pour les Européens, et un APPLE expérimental pour les Indiens. La charge utile de la fusée s’est séparée du troisième étage d’Ariane à 14h49, soit un petit peu plus de 16 minutes après le décollage. Ariane a donc parfaitement rempli sa mission. »
Hubert Curien : Cette fusé Europa, en fait, n’a jamais donné satisfactions, parce qu’elle était hétéroclite, elle s’est effondrée si je peux dire, exactement comme la Tour de Babel, et pour les mêmes raisons que la Tour de Babel. Les Français, eux, étaient vraiment très accrochés à l’idée de faire une fusée française ou européenne, mais une fusée sur le continent, qui nous donne une autonomie vis-à-vis des Américains, et quand on parlait d’autonomie aux Allemands, ils nous disaient : mais qu’est-ce que c’est ces notions d’indépendantistes, voyons on n’en est plus là, les Américains sont nos alliés … Certes ce sont nos alliés disait-on, mais vous savez ce sont des affaires qui deviendront commerciales et industrielles, et tout alliés qu’ils sont, ils sont aussi des concurrents. On ne voulait pas le croire jusqu’au moment où une circonstance favorable s’est présentée, favorable pour l’avenir des fusées européennes. Les Allemands et les Français avaient construit un satellite, deux parce qu’on fait souvent une paire, pour les télécommunications, les satellites Symphonie, c’était même par rapport aux satellites américains, des engins extrêmement modernes. On fait nos Symphonie, ils arrivent à maturité, il faut donc que les mettre en orbite. Or, les mettre en orbite, l’un des …
[suite, avec quelques mots en moins du fait de l’aléa des enregistrements sur les bonnes vieilles cassettes magnétiques] les démarches chez les Américains, en disant, on a ces satellites, on est un peu embêté, Europa est un peu en retard - c’était un euphémisme - est-ce que vous pouvez nous aider à les mettre en orbite ? _ « Oh, oui, disent les Américains, facile ! Nous avons cette fusée qui convient. » _ « En effet, elle convient très bien. » _ « Elle nous coûtera tant, c’est le prix du marché, on ne vas pas vous faire des rabais, il n’y a pas de raisons ? » – « Non, il n’y a pas tellement de raisons. Elle coûtera tant… » Puis, disent les Américains : « Il y a quand même quelque chose. Pour l’instant, il n’y a pas de satellite de télécommunication qui soient utilisés commercialement autres qu’américains, c’est un monopole que nous n’avons pas de raison de perdre, donc on vous mettra vos satellites en orbite, mais vous n’aurez pas le droit de vous en servir. » Ce n’était pas dit exactement comme ça, mais c’est ça que ça voulait dire. Les Allemands ont tout d’un coup réalisé que le mot autonomie avait un certain sens. Un revirement de l’opinion, et sous la poussée, très forte, des gouvernements français de l’époque, ont décidé de relier le bouquet européen avec un fil solide, d’où aussi le nom d’Ariane, le fil de, et nous, eh oui, il n’y a pas de petits profits,
Michèle Chouchan : Le non d’Ariane vient de …
Hubert Curien : En particulier, en particulier. En fait, c’est Jean Charbonnel qui a choisi le nom d’Ariane. Jean Charbonnel avait des goûts littéraires, c’est un très bon connaisseur de la littérature française, il connaissait ses classiques « Ariane ma sœur, de quel amour blessée … », il avait d’ailleurs une petite ironie, à propos de ces deux vers, il avait fait ses études en Auvergne, il prétendait que son professeur leur apprenait ce passage : « Ariane, ma sœur, de quel amour blessée, _ Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée ! » [Curien imite là l’accent auvergnat, en remplaçant le S par le CH, au grand plaisir de son auditoire], ce n’est pas très convenable, mais histoire n’est pas de moi, elle est de Jean Charbonnel.
Donc, on repart avec Ariane et on rassemble. Pour rassembler, il fallait vraiment que les Français soient convaincants, et pour être convaincants, il fallait qu’ils contribuent fortement à cette aventure. C’est la raison pour laquelle ils ont accepté de prendre les deux tiers de la dépense correspondante, et aussi les deux tiers de la fabrication. Pour nos industriels, c’était une affaire extrêmement importante. Nous sommes donc partis sur le chemin d’Ariane avec beaucoup de convictions, quelquefois quelques déboires. Mais au total, vraiment, les succès nombreux de lancements d’Ariane, nous permettent de le dire sans aucune forfanterie, Ariane est un excellent lanceur. La famille Ariane, est une excellente famille de lanceurs, et fait dans une certaine mesure l’admiration, et dans une petite mesure aussi l’envie de beaucoup de collègues américains.
Michèle Chouchan : Mais il a fallu convaincre l’opinion de l’intérêt des vols habités, ultérieurement …
Hubert Curien : Ça, c’est autre chose.
Michèle Chouchan : Oui, c’est autre chose, mais effectivement là, il y a eu un gros travail à faire, et puis je suppose que vous avez été un petit peu déçu aussi de l’abandon progressif d’Hermès.
Hubert Curien : Oui, bien sûr mais ça c’est une histoire dont l’analyse est intéressante, et qui, je pense, porte enseignement. Voilà comment les choses se sont passées, en ce qui concerne les vols habités, vu du côté de l’Europe, et plus spécialement de la France. Dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, le panorama pour l’Europe est un beau succès en ce qui concerne les lanceurs, des succès évidents, en ce qui concerne les satellites d’application, ceci nous donnait des ailes, si je puis dire. Nous faisions le recensement des domaines où nous n’étions pas présents, le seul domaine dans lesquels nous n’étions vraiment pas présents, c’était la présence humaine dans l’espace. Et nous constations que les grands de l’espace, les très grands de l’espace, c’est-à-dire les États-Unis d’Amérique et à cette époque l’URSS, avaient naturellement les facilités, ou étaient en train de monter des facilités, pour mettre des hommes dans l’espace, de façon plus ou moins permanente. Nous avons pensé à ce moment-là que si l’Europe de l’Ouest n’était pas dans cette course-là, alors 10 ou 20 ans plus tard elle se trouverait déclassée. Nous ne pouvions pas nous mettre en dehors de cette course-là. Aussi, lorsque nous avons eu une réunion à Rome, en 1985, qui a été très importante pour l’espace européen, j’ai très fortement plaidé auprès de mes collègues européens pour considérer la possibilité d’une véritable présence humaine européenne dans l’espace. À ce moment-là qu’ont dit les partenaires ? Les Allemands, très liés aux Américains, nous ont dit : oui, un homme dans l’espace, très bien, mais faisons-le avec les Américains. Puisque les Américains veulent faire une station, très bien, demandons-leur de nous louer un petit terrain, on construira notre maisonnette sur ce petit terrain, puis on fera les branchements d’eau, de gaz et d’électricité sur leur centrale, tout ça dans l’espace, à 300 km d’altitude. Très bien. Mais au moins dis-je aux Allemands, aux Italiens à nos autres collègues, si nous avons notre appartement dans la grande maison américaine, en copropriété, ayons au moins notre mode d’accès à cet appartement, parce que si, premièrement on est en copropriété minoritaire, et que deuxièmement, on n’a pas notre propre taxi, autobus ou camion, pour y aller, vous êtes sûrs que vous ne serez pas maîtres, nous ne serons jamais maîtres des programmes d’utilisation de cette participation que nous prenons. C’est tout à fait clair, tout à fait évident. Heu, heu, disait celui-ci ou celui-là, et à celui-ci ou celui-là, je disais : mais, cher ami, souvenez-vous de Symphonie. J’ai dit, faisons un taxi, et ça a été Hermès. Hermès avec un bel enthousiasme français et une acceptation des autres pays, en général des autres pays européens, mais pas un enthousiasme terrible des autres pays européens, ce qui nous a amenés à prendre dans Hermès une participation un peu plus grande que ce qui aurait correspondu à la répartition selon les richesses nationales.
Puis voilà ce qui s’est passé, le mur de Berlin tombe, le régime soviétique se délite, et du coup cette concurrence pour le prestige féroce, entre les États-Unis et l’URSS dans l’espace, se dilue complètement. Tout change, et tout à fait indépendamment de nous. Il eut été au début de ces années 1990, malsain de s’entêter sur une idée qui était bonne, et qui était même nécessaire, disons auparavant. Bien sûr, l’allure qu’ont pris les choses à pu choquer et décevoir beaucoup d’entre nous, moi en particulier. Hermès était l’un des concepts à la définition duquel j’avais beaucoup contribué, politiquement j’avais beaucoup poussé à son admission par l’ensemble des Européens, le fait de changer considérablement de cap à ce propos m’a posé quelques problèmes et une grande déception. Mais, je crois, qu’il ne faut pas s’accrocher aux idées, surtout aux idées qui ont changé, surtout lorsqu’il s’agit de technologie. La technologie ça change, il faut essayer d’être entêté quand ça doit payer, et de ne pas l’être, quand les choses ont vraiment évolué. Par exemple, reprenons le cas d’Ariane, là, nous avons fait preuve d’un entêtement, et vous savez qui a été méritoire, je me souviens d’une visite m’a rendu le grand patron de la NASA, alors que j’étais tout jeune, tout récent président du CNES. Je l’amène à Toulouse, et le soir nous sommes de retour à Paris, et je l’amène dans un restaurant, qui est aussi un club, à l’Amérique latine, ils avaient à cette époque-là un excellent Jurançon, le vin préféré d’Henri IV. Premièrement ce vin était bon, puis, deuxièmement ça me permettait de faire un petit couplet sur Henri IV, ça meuble l’apéritif, quand on a des étrangers. On y va, on boit un bon petit coup de Jurançon, deux petits coups de Jurançon, puis mon camarade américain se sent plus à l’aise, commence à m’appeler par mon prénom, et à me mettre la main sur l’épaule, il me dit : « Hubert, what a stupid idea you have, to … », quelle idée stupide vous avez de vous entêter avec cet appareil ringard, que vous appelez Ariane. Écoutez, franchement, franchement, des fusées comma ça, nous on en ferait plus. Nous avons ce superbe programme de la navette, que vous connaissez bien, on a l’argent qu’il faut pour le faire, mais si des collègues étrangers venaient avec nous, en contribuant techniquement et financièrement, on serait bien content, et ça donnerait une allure internationale aux affaires spatiales, ça quand même plus joli. Réfléchissez-y, réfléchissez-y, on comprend bien que vous soyez attachés à certaines idées, mais quand même le modernisme est là, la navette, c’est l’avenir.
Alors, c’était un peu embêtant pour moi, parce que c’était quand même le grand patron, de la grande agence, du grand pays, qui était les États-Unis, qui me disait ça. J’ai réfléchi beaucoup, je dors mal, j’en parle à mes collaborateurs le lendemain, puis je me fais une raison, non, il ne fallait évidemment pas écouter la sirène américaine. Nous avions besoin de cette fusée, d’autre part j’étais convaincu, l’expérience a confirmé cette conviction, que les Américains faisaient une erreur, en mettant toute leurs billes, en ce qui concerne les lancements, dans un seul engin, qui était la navette. Ils sont revenus à la fabrication de fusées classiques, que maintenant je peux dire, du type Ariane.
-*-
Base militaire d’Istres, samedi 12 mai 1951. Aux premières heures de la matinée, Robert Bel-Air se mettait en contact avec le lieutenant-colonel Versini, commandant la base. Madame Jacqueline Auriol allait tenter, sur le Vampire 1000061, de battre le record du monde féminin de vitesse, sur 100 km, en circuit fermé, qui appartenait jusque-là à Miss Cochran, avec une vitesse horaire de 755 km 668. À 9h, Bel-Air nous téléphonait : Madame Jacqueline Auriol vient d’effectuer un vol, et l’on pense que le record est officieusement battu. Trois heures plus tard, nous recevions les nouvelles suivantes : à 12h15, le pilote Guillaume a reconnu le parcours sur un chasseur Maurane, il se pose quelques minutes plus tard, en déclarant que l’essai officiel peut être tenté. Nouveau décollage à 14h20, pour s’assurer des conditions atmosphériques, à 16h on enregistre une légère éclaircie, mais une plus fine tombe toujours. Guillaume s’envole une troisième fois à bord d’un avion de liaison, Madame Jacqueline Auriol l’accompagne. Ils vont reconnaître les Alpilles. Madame Jacqueline Auriol détient le record du monde féminin, pour une vitesse horaire de 818 km 181. Éblouissante, sans aucune trace de fatigue, l’aviatrice se dirige maintenant vers son moniteur Guillaume, dont l’émotion a été telle, à l’atterrissage, qu’il e peut retenir ses larmes. 5 minutes après sa victoire, Madame Jacqueline Auriol, belle fille du président de la République, voulait bien s’adresser aux sportives françaises, et sa déclaration nous paraît la plus belle conclusion à cette magnifique journée. « Je suis aujourd’hui heureuse et émue, impressionnée aussi par la pensée de prendre la succession d’Hélène Boucher, en ramenant à la France, par ma réussite, le record féminin du monde de vitesse. Je trouve que les femmes sont les mêmes que moi, sachent qu’elles peuvent coopérer à la renaissance, si nécessaire. Renaissance qui exige tous les efforts et toutes les bonnes volontés. Je voudrais maintenant remercier Monsieur Jules Moch, ministre de la guerre, et Monsieur Maroselli, secrétaire d’État à l’air, qui m’ont fait confiance, et dont le concours m’a été si précieux, et également vous tous, [manque les noms et / ou les fonctions, inaudibles], qui m’avez qualifié, qui m’avez encouragée, guidée, entraînée, sans lesquels je n’aurais jamais pu réussir. Je me réjouis enfin d’avoir pu battre ce record mondial sur un avion construit par les ingénieurs et les ouvriers de la SNCASE (Société de Constructions Aéronautiques du Sud-Est). Quant à mes projets immédiats, pour l’instant qui est de rentrer tout de suite à Paris, dans ma famille, que j’ai dû quitter, pendant quelque temps, pour venir ici m’entraîner. »
-*-
Michèle Chouchan : Vous aviez envie de rencontrer Jacqueline Auriol, Hubert Curien.
Hubert Curien : Oui, bien sûr j’avais envie de rencontrer Jacqueline Auriol. J’ai bien des occasions de la rencontrer, nous faisons partie de la même académie, qui est l’Académie nationale de l’air et de l’espace, que nous avons d’ailleurs créée ensemble, il y a quelques années. Nous avions le sentiment que la communauté de tous ceux qui s’intéressent à l’aviation, et aux techniques spatiales, méritaient un point de rencontre, un forum, dont Jacqueline Auriol et l’une des gloires.
Michèle Chouchan : C’est en 1955 que vous êtes devenu pilote d’essai ?
Jacqueline Auriol : Peut-être, vous savez tout, moi, je suis absolument ignorante de ce qui s’est passé dans ma vie, c’est pour ça que cela ne va pas être commode. C’est vrai. Jamais d’abord je n’aurais espéré de pouvoir faire ce métier. J’adorais voler, mais aller jusque-là, c’est tout ce qu’on peut faire de plus fascinant dans l’aviation. C’est d’avoir un petit avion, comme un bébé, qui connaît pas grand-chose, et ensuite d’en faire, avec beaucoup de choses, un vrai avion que l’on met sur les lignes, ou bien qui devient un avion de guerre. [petite coupure de son] … tant que la cellule, il faut essayer, tout ce que comporte un avion, bien sûr tout l’équipement, tout un tas de choses qu’on ne peut pas se figurer, quand on ne fait pas le métier, il y a pas de doute. Un avion au départ était essayé par la firme qu’il conçoit, et, obligatoirement après, passe dans un organisme d’État, qui est le centre d’essais en vol, et la réflexion se passe au niveau du pilote de la maison, et est contrôlé et renvoyé chez le constructeur, car il y a toujours quelque chose à faire, bien sûr. C’est une espèce de va-et-vient d’un avion qui se passait très doucement à un moment donné, et qui maintenant s’est fantastiquement amélioré. C’était passionnant.
La joie et le bonheur d’un pilote d’essais autrefois, car moi je suis tout à fait de l’autre fois, est maintenant compensée aussi par des choses tout à fait différentes, des façons de travailler tout à fait différentes. Par exemple, j’ai été voir les essais du 2000, que moi-même je n’ai pas essayé, moi, je m’arrête au Mirage III, et je ne vais pas plus loin, mais j’étais tout de même allé à Istres, pour voir un petit peu comment ça se passait ; deux vols, maintenant, cela était 20 vols autrefois. Vous vous êtes pour quelque chose là-dedans, mais vous n’êtes pas dans l’avion. Moi, j’avais seulement la joie en définitive. Une joie sans pareil, parce que tous les matins, en me réveillant, je me disais c’est encore le miracle, je vais encore avoir à faire aujourd’hui un vol, sur tel avion. Et, quand j’arrivais au centre d’essais en vol, il y avait non seulement un vol sur tel avion, mais un autre, que je n’attendais pas, enfin si. Je crois que c’est le plus beau métier dans l’aviation que l’on puisse exercer, il n’y a pas de doute, être pilote de ligne ou pilote de je ne sais quoi, c’est sûrement passionnant aussi, bien sûr, mais ça n’a pas de rapport avec espèce de continuité. L’éducation de l’avion, c’est fascinant.
Hubert Curien : Et puis, Jacqueline, ce métier et plutôt considéré comme un métier d’hommes.
Jacqueline Auriol : Les choses ont été peut-être plus simples pour moi, c’est le contraire de ce que pensent beaucoup de gens, en disant, mais comment pouviez-vous arriver à vivre au milieu des hommes, sans que les choses ne soient pas simples. C’est vrai que c’est un métier de vedette aussi, un petit peu. En fait, non, j’aime beaucoup les choses qui se font seules. Je me souviens avec joie de mon lâcher en avion et de mon lâcher en voltige, et puis tous ces sports, qui sont comme la montagne, le ski, l’équitation. Tout ça, j’aimais beaucoup. Maintenant, je joue au Golf, c’est normal, vous le savez. Mais, c’est un milieu absolument extraordinaire, on est protégé. Je n’ai jamais rencontré de salauds, moi. Je ne sais pas ce que c’est. Et vous dites jalousie, même pas, je ne sais pas. Même pas, les gens ont une espèce de droiture et de vérité. Dans le métier de pilote d’essais, il est évident qu’on ne peut pas mentir, car sans ce ne serait rien. Donc, tout est clair, tout est net. Enfin, en tout cas, moi c’est ce que j’ai ressenti, et c’est ce que j’ai vécu, avec des hommes, qui étaient des hommes purs, qui avaient eu une seule une seule idée, l’argent pas d’importance, enfin pas d’importance, oui.
Hubert Curien : Ça ne venait pas au premier plan.
Jacqueline Auriol : Pas dans notre milieu à nous, les pilotes d’essai, il n’y a pas de doute. Je suis très malheureusement très séparée des avions maintenant, parce que c’est il y a tout de même très longtemps que je les ai quittés, mais pas séparée des hommes qui les traitent. Donc, je vois les jeunes pilotes qui sont qui sont en ce moment à l’école PN. Ils sont aussi passionnés que nous pouvions l’être à ce moment béni, où il fallait reconstruire quelque chose.
Hubert Curien : Quand vous assistez à une démonstration aérienne, comme on en voit à l’occasion du Salon du Bourget, est-ce que lorsqu’un avion fait des pirouettes extraordinaires, vous ressentez cela, comme si vous étiez vous-même aux commandes ?
Jacqueline Auriol : Complètement. Ça, j’avoue que ça ne passe pas, oui, y compris le mystère de comment ce gars fait-il pour faire cette figure. Je pense au …
Hubert Curien : Au cabrage …
Jacqueline Auriol : Oui, exactement. L’autre jour, quand nous étions tous ensemble, on était tous en train de se demander, à toutes nos tables, avant-hier, nous déjeunions tous ensemble, les gens de l’Académie, comment il a fait, chacun donnait sa version. Évidemment ça ne peut pas être l’aérodynamique …
Hubert Curien : C’est ça, il s’agit de figure où l’avion se cabre, comme un cobra, ça s’appelle la figure du Cobra, et quand il est cabré, et même penché vers l’arrière, non pas seulement vertical, mais encore penché vers l’arrière, il arrive quand même à avancer alors qu’il doit reculer, et tout le monde se demandait comment il faisait. C’est le talent du pilote, et peut-être aussi de la technologie.
Jacqueline Auriol : Pardon, le talent de l’ingénieur d’abord, parce que ce n’est pas l’aérodynamique extérieure qui compte, c’est une aérodynamique interne, de petits volets qui permettent une espèce de nouveau pilotage. C’était tout à fait extraordinaire, cette histoire-là.
-*-
Michèle Chouchan : Hubert Curien, il est évident que dans votre vie le travail occupe une place considérable. Il reste de la place pour autre chose ?
Hubert Curien : Il reste toujours de la place pour autre chose. Pour autre chose, pourquoi ? Les loisirs peuvent être très différents, très divers.
Michèle Chouchan : Vous occupez de vos loisirs en travaillant ?
Hubert Curien : Non, pas en travaillant, en lisant. Pour les lectures, ma technique n’est pas bonne, parce que j’ai la naïveté de me croire obligé de lire tous les livres qu’on m’envoie. D’une façon générale, je ne remercie qu’après avoir lu, ou presque lu. Ça, ça occupe déjà du temps, et il y en a beaucoup de très bons, dans les livres qu’on m’envoie, mais il y en a qui prennent du temps.
Michèle Chouchan : Vous parlez là de livres scientifiques, de romans, d’essais ?
Hubert Curien : Les livres qu’on m’envoie sont essentiellement des livres soit de sciences, soit des livres sur la science, soit des livres sur la politique de la recherche, ou sur les équilibres politiques d’une façon générale. Mon passage à travers la politique m’a aussi fait connaître ce genre de plaisir. Des livres enrichissants, mais de temps en temps, on a aussi envie de relire un tout petit peu de Victor Hugo, ne serait-ce que pour retrouver des rimes. Quand nos enfants étaient jeunes, nous avions un petit jeu, pas pour les endormir, mais pour passer le temps dans le train, par exemple, on prenait un livre de Victor Hugo, ou d’un autre poète très classique, et on lisait le vers, en laissant les trois dernières syllabes, et on faisait deviner les trois dernières syllabes, avec la rime, ça marchait toujours. Au fond, les poètes on les trouve admirables parce qu’ils parlent en vers, mais avec un petit peu d’habitude les rimes viennent assez facilement.
Donc, lire. Et évidement, les loisirs qui dépaysent le plus, sont ceux qui sont de caractères sportifs ou physiques, plus généralement, parce que sportif, vous me voyez, je n’ai pas l’air d’un très grand sportif. La montagne, l’hiver, l’été, ce n’est pour très inventif ce que je dis là, mais c’est tellement complémentaire. L’été, la montagne est vraiment une source de joie inépuisable, et l’hiver me donne l’occasion de me rassurer sur ma santé, parce que je change assez fréquemment de paires de skis. Il faut à chaque fois une paire de skis, des progrès phénoménaux, matériels, et moi, je baisse un peu naturellement, progressivement, et je ne m’en aperçois pas, je skie toujours à peu près de la même façon, c’est-à-dire correctement, sans plus, grâce à la qualité des skis.
Michèle Chouchan : À partir d’un certain stade, à partir d’un certain rythme, une accélération, est-ce qu’il n’y pas une sorte de boulimie de peur du manque ? Est-ce que ce n’est pas aussi une façon de se protéger d’une certaine manière ?
Hubert Curien : Oui, oui, absolument. C’est une façon de se protéger, sursaturer ses emplois du temps. On ne le dit pas explicitement, on regarde son emploi du temps le matin, toute les heures tombent quelque chose, et on se dit un peu égoïstement, tiens aujourd’hui, je n’aurais pas le temps de penser … Un peu égoïstement, de temps en temps, ça arrive, c’est tout à fait dommage, je crois qu’il faut faire des interruptions dans un emploi du temps. Il y a des gens qui savent très bien faire ça, qui se réservent une demi-journée par-ci-par-là. Moi, j’ai eu la chance de considérer comme un impératif absolu, le lundi matin, consacré à l’enseignement. Et chacun a toujours su ça, Hubert Curien, le lundi matin, on ne peut pas le voir. Pour d’autres, on sait que le samedi matin, ils dorment, moi, le lundi matin, j’étais au laboratoire ou devant les étudiants. Et ça, cela me procurait une certaine sécurité, je savais que j’avais des fenêtres. Il faut que, je crois, dans une vie qu’on veut relativement équilibrée, avoir quelques fenêtres et être absolument farouche, parce que le nombre de raisons que vous avez à faire des entorses à de telles règles est considérable, mais quand tout le monde est bien au courant qu’il y a une règle, et que vous l’enfreindrez pas, ça marche.
Michèle Chouchan : Ce besoin de se retrouver justement un petit peu l’écart de ces impératifs ne doit quand même pas se priver de s’interroger sur la rencontre avec soi-même. La rencontre avec les étudiants n’équivaut pas à une rencontre avec soi-même. Est-ce que c’est le moment où vous coupez le bois …
Hubert Curien : Dans une certaine mesure, si, la rencontre avec les étudiants est une très grande leçon d’humilité et de retour sur soi. J’ai gardé un très vif souvenir d’une lecture d’enfance, celle d’un livre d’Hector Malot, « Sans famille », c’est un livre qui est tout à fait démodé, je ne suis pas sûr que les enfants d’aujourd’hui le lisent, mais c’est un livre très touchant, qui raconte l’histoire en particulier, il y a trois ou quatre histoires dans ce livre, d’un chanteur italien, qui est au-devant de la scène, et qui a senti un jour qu’il pourrait le lendemain ou l’année suivante être moins bon, et qui s’est arrêté complètement, est parti et s’est fait chanteur de rue, bateleur, montreur de singes, etc. C’est parce que il avait le contact avec le public, qu’il a senti que ce public-là, il ne pouvait pas le décevoir, ce ’était pas possible, que son image était celle-là, qu’il valait mieux couper plutôt que de finir sur une image moins brillante. Eh bien, voilà une bonne manière de retourner sur soi, mais on retourne sur soi d’autant plus facilement que les gens vous y aident.
Michèle Chouchan : Il y a quand même ce besoin de ne pas décevoir, de pouvoir continuer à répondre à une demande, ça, c’est quelque chose d’important pour vous.
Hubert Curien : Oui, je crois que c’est important pour tout le monde.
Michèle Chouchan : Mais, il ne faut pas que vous y mettiez quand même une valeur très, très forte.
Hubert Curien : Pour moi, c’est un point essentiel.
Michèle Chouchan : Notamment d’avoir toujours une disponibilité à l’égard de toute une palette de gens, qui n’ont pas forcément directement dans votre discipline.
Hubert Curien : Oui, c’est tout à fait sûr, et ce qui est important, je crois, c’est qu’il arrive à un moment où dans tel ou tel type d’activité, on a le sentiment qu’on sera nettement moins bon, alors là, il faut avoir le courage de s’arrêter, de faire autre chose. C’est vraiment un courage, c’est difficile, c’est difficile.
Michèle Chouchan : Justement dans le domaine de la recherche, on dit souvent qu’au fil des années la curiosité et les possibilités s’émoussent. Vous l’avez ressenti, vous aussi ?
Hubert Curien : Oui, bien sûr, tout le monde le ressent. Quelquefois, c’est très difficile pour les chercheurs. Voilà un problème essentiel pour le chercheur, c’est qu’il arrive un moment, plus ou moins vite, ça varie aussi selon les disciplines, ça varie naturellement selon les constitutions de chacun, ou on voit bien que la recherche reste une grande joie pour l’acteur, mais que cet acteur ne peut plus garder le haut de l’affiche, pas tellement parce que d’autres sont venus, qui sont aussi bon que lui, mais parce qu’il est devenu moins bon, et c’est à ce moment-là qu’il faut savoir changer de braquet. Il faut aussi aider les gens à changer de braquet, ce n’est pas facile, mais là on peut faire autre chose, on n’est pas obligé de rester chercheur toute sa vie, on peut faire autre chose et mettre à profit tout ce qu’on a appris, pour en faire profiter les autres.

