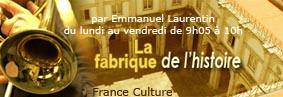.
Introduction par Emmanuel Laurentin : « Science et politique » dans « La Fabrique de l’Histoire » alors même que jeudi les chercheurs de l’enseignement supérieur se joindront, je crois, à l’appel de « Sauvons la recherche » aux enseignants dans leur manifestation, un peu partout en France. Demain, nous nous souviendrons qu’il y a 60 ans, en 1968, éclatait, dans notre pays, « L’affaire Lyssenko » du nom d’un agronome soviétique soutenu par le pouvoir stalinien contre les biologistes et les généticiens de son temps, qualifiés alors de réactionnaires et de valets de la science bourgeoise. Jean Rostand, comme Jacques Monod se dressèrent alors, à l’automne 48, contre les théories lyssenkistes dont le Parti communiste français se faisait l’écho dans notre pays. Mercredi, nous nous intéresserons à l’histoire du CNRS, comme lieu de croisement entre science et politique. Jeudi, nous reviendrons, avec Dominique Pestre, Alain Blum et Cédric Grimoult sur les rapports entre cette même science et la politique au XXe siècle.
Quant à ce matin, notre invité sera Jean-Louis Crémieux-Brilhac, connu de bien des historiens pour sa participation à la France-Libre puis son travail d’historien sur cette même France-Libre qui a donné lieu à un travail de référence en deux tomes en Folio Gallimard. Mais Jean-Louis Crémieux-Brilhac a eu une longue carrière entre son engagement à Londres auprès de de Gaulle et son travail d’historien, une carrière marquée par son intérêt pour la recherche scientifique. Il s’en approcha alors qu’il était un jeune conseiller de Mendès, puis fut un des organisateurs du fameux colloque de Caen sur la recherche scientifique en 56, avant d’être l’animateur pour l’association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique qui organisa, jusque dans les années 70, nombre de colloques sur ce sujet. Il fut également co-fondeur et directeur, pendant 12 ans, de la Documentation française, ce qui fait de lui un des meilleurs experts pour juger justement de l’évolution du rapport entre science et politique, depuis 50 ans, dans notre pays.
Pour commencer, un texte de tribune, pourrait-on dire, un texte politique, celui de Mendès-France justement lors de ce colloque de Caen, en 1965 : « L’intervention du pouvoir politique s’impose. Seul désormais, il est en mesure de donner une impulsion suffisamment vigoureuse. Je n’ignore pas les craintes qu’éveillent chez beaucoup de Français la seule apparence du dirigisme. Et vous seriez justifiés de vous élever par avance contre toute atteinte aux libertés universitaires et à la liberté du chercheur. Quant à moi, je ne conçois pas le rôle de l’État autrement dans le domaine de la science que je le conçois en matière économique. L’État doit exercer son rôle qui est de décider et d’arbitrer. Il ne lui appartient pas de tout régenter ni même de tout administrer, son intervention doit s’exercer dans le sens de la plus grande liberté et j’ajouterai de plus grande mobilité. C’est-à-dire qu’elle doit s’attaquer aux rouages inutiles, aux cloisons étanches, aux privilèges et aux féodalités de toutes sortes afin de permettre aux mécanismes de jouer plus librement à tous les échanges qui sont ceux de la vie, de s’effectuer sainement, à tous les hommes compétents d’être utilisés au service du pays quelle que soit leur formation, aux collectivités, aux établissements publics, aux sociétés nationales, aux universités d’avoir leur part entière de responsabilité, enfin aux entreprises et aux chercheurs privés de miser sur le risque et d’en récolter les bénéfices. »
Bonjour Jean-Louis Crémieux-Brilhac.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Bonjour.
Emmanuel Laurentin : Ce texte ne vous est pas étranger d’autant que vous avez dû participer à sa rédaction.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : En effet.
Emmanuel Laurentin : A sa préparation en même temps.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Sûrement
Emmanuel Laurentin : Ce texte date de la Toussaint 1956, présenté lors de ce colloque de Caen, par Mendès-France. On va parler, pour commencer, de la préparation de ce colloque qui fut si important dans l’histoire de la recherche scientifique, la politique de la recherche scientifique en France. Comment est-vous passé, de ce que je disais tout à l’heure, de l’engagement dans la France-Libre, à Londres, à cet intérêt que vous allez avoir, pendant plus d’une quinzaine d’années, pour ces questions de politiques scientifiques, au milieu des années 50.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : J’ai été au cabinet de Pierre Mendès-France, lorsqu’il a été pour 7 mois et 17 jours, Premier ministre, Président du Conseil, en 54-55. Et dès 1953, il avait commencé à dresser un constat accablant de l’état de la recherche scientifique en France.
Emmanuel Laurentin : Il avait fait une déclaration, un discours qui sollicitait l’investiture de l’Assemblée nationale. Pour devenir Président du Conseil, il avait une déclaration dont une des phrases est : « La République a besoin de savants ».
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Il avait affirmé dans sa première déclaration d’investiture, il n’avait pas été investi en 53, et il l’avait répété lors de son investiture en juin 54. Il considérait que la recherche scientifique en effet était un des moteurs de l’économie française, non seulement un élément du rayonnement mais un élément essentiel du développement économique d’un pays, que l’injonction scientifique représentait quelque chose de comparable à ce qu’était les grandes aventures outremer dans les siècles précédents, qu’il y avait là tout un domaine inconnu, comme étaient autrefois les continents lointains que des découvreurs allaient explorer puis ensuite exploiter. Il pensait, d’autre part, que le développement de la recherche scientifique était un élément capital pour assurer le développement du tiers-monde.
Emmanuel Laurentin : Il avait un regard porté évidemment dans ce contexte très particulier de la guerre froide, à la présence française dans ce domaine très particulier de l’invention technique, technologique et scientifique mais également un regard porté sur le Sud, de ce qu’on appellerait les rapports Nord-Sud, et justement dans cette particularité du rapport de la France à ses colonies, qui bientôt deviendraient ses anciennes colonies.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Il était très soucieux du développement du Tiers-Monde. Donc, il y avait dans sa critique une vision d’ensemble qui rejoignait sa culture de radical, très attaché, depuis toujours, à l’enseignement. L’enseignement c’est la République, la formation des citoyens. Et dans cet enseignement, il considérait que l’enseignement scientifique avait été dramatiquement négligé en France, que sur 155 000 étudiants que nous avions il y avait seulement 35 000 étudiants de science, que nous formions 4 000 ingénieurs alors qu’il en aurait fallu 10 000, 12 000, que donc, il y avait une sorte de laisser-aller dramatique qui coinçait, qui empêchait tout développement de la recherche scientifique.
Emmanuel Laurentin : Et vous-même, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, c’est par hasard qu’on vous nomme à ce poste de conseiller pour les questions d’enseignement et de recherche ? Vous étiez auparavant plutôt spécialisé sur les affaires internationales, les affaires étrangères, comment passez-vous justement dans ce nouveau domaine qui va devenir une de vos vraies passions en fin de compte ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Au cabinet de Mendès-France, dans la dernière phase, j’avais été chargé des questions d’enseignement, recherche et jeunesse. Mais ce qui a été le déclic, c’est que ma femme travaillait au Commissariat à l’énergie atomique et nous étions amis d’un personnage tout à fait remarquable, du Commissariat à l’énergie atomique, Étienne Bauer, qui était au centre de toute une constellation de scientifiques. Il était apparenté à Francis Perrin…
Emmanuel Laurentin : Donc, très proche de tout ce milieu autour de Joliot-Curie, de tous ceux qui avaient fondé le CEA.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : C’est ça. Il était ami de Jacques Monod. Ami de guerre de Résistance de Jacques Monod. Et il a eu l’idée que Mendès-France, qui s’intéressait tellement à la recherche, pourrait servir de porte-voix à un groupe de jeunes scientifiques qui eux-mêmes étaient en révolte contre l’université ou se sentaient brimés par la situation de l’université à l’époque.
Emmanuel Laurentin : Ces jeunes scientifiques, qui avaient mettons entre 35 et 40 ans, n’avaient plus tellement de preuves à donner de leur engagement scientifique et surtout des découvertes scientifiques, se sentaient brimés par ce qu’on appelait à l’époque les mandarins de l’université, cherchaient une sorte de sortie de secours pour pouvoir rejoindre les milieux politiques et développer, de façon différente, la recherche scientifique en France, c’est cela, Jean-Louis Crémieux-Brilhac ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Ils se trouvaient coincés parce que l’université française était monolithique et était restée structurée comme elle l’était au XIXe siècle, comme elle avait été voulue par Napoléon, refaçonnée par les premiers instigateurs de la IIIe République. Ils se trouvaient, à 35 ou 40 ans, coincés, sans pouvoir accéder à des chaires. Les chaires par discipline structuraient l’université française…
Emmanuel Laurentin : Elles n’avaient pas été transformées, pour beaucoup d’entre-elles, depuis le XIXe siècle.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Elles n’avaient pas été transformées. C’est-à-dire que c’était la culture du XVIIIe siècle, et les enseignements dispensés par les chaires créées au XIXe siècle qui continuaient de dominer l’université française. Ainsi, Jacques Monod s’indignait qu’il y ait une seule chaire de génétique en France…
Emmanuel Laurentin : Lui, qui deviendra Prix Nobel, il faut le rappeler.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Alors que dans toutes universités de France on enseignait la zoologie, la botanique, les sciences descriptives mais pas de sciences de recherche.
Emmanuel Laurentin : Donc, tous ces jeunes chercheurs viennent, d’une certaine façon, frapper à la porte de Pierre Mendès-France parce qu’ils ont entendu ce discours favorable à la recherche et ils se disent, c’est peut-être l’homme qui va nous permettre...
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Il pourrait être notre porte-parole. Notre porte-voix.
Emmanuel Laurentin : Il faut dire tout de même qu’il n’y avait pas que Pierre Mendès-France. Ils étaient peu nombreux, dites-vous, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, les hommes politiques qui s’intéressaient à ces questions de recherche au milieu des années 50. Il y en avait 1 ou 2 autres qui pouvaient s’intéresser à ces questions-là, et c’était à peu près tout.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : C’était à peu près tout.
Emmanuel Laurentin : Il y avait Michel Debré plus tard.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Michel Debré plus tard, s’y est intéressé très, très vivement et efficacement. A l’époque on s’y intéressait, mais un peu marginalement, des hommes comme Soustelle qui était, lui, universitaire de formation, Jules Moch, un ministre bien oublié du MRP, qui s’appelait Bichet…
Emmanuel Laurentin : Robert Bichet [1], qui était un des fondateurs d’une loi sur la presse...
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Après la Libération. Mais il ne devait pas y avoir une demi-douzaine. Dassault, le constructeur d’avion qui se mêlait de politique déjà, s’y intéressait. Mais il n’y avait pas plus d’une demi-douzaine d’hommes politiques qui s’y intéressaient et pas de façon vraiment très, très active. Ce qui est très curieux, c’est que parmi les grands industriels, qui pourtant pour certains avaient fait le voyage d’Amérique, très peu, très peu avaient la préoccupation d’une recherche fondamentale qui pourrait vitaliser somme toute la recherche appliquée et le développement industriel par la suite.
Emmanuel Laurentin : Alors, justement, vous avez cité le nom d’Amérique. Il faut tout de même effectivement se remettre dans ce contexte des années 50. Demain on parlera de l’influence de la pensée scientifique soviétique sur une partie des chercheurs français et de leur désamour pour certains d’entre eux qui étaient entrés au Parti communiste et qui le quitteront à cette occasion-là, des gens comme celui que vous avez déjà cité, Jacques Monod, ça sera « L’affaire Lyssenko », mais il y a de l’autre côté un attrait, un intérêt pour ce qui se passe au États-Unis, à cette fameuse Mission de protectivité qui ont été mise en place dans le cadre du Plan Marshall, dans la suite du Plan Marshall et qui permettent à des Hauts-fonctionnaires, à de jeunes chercheurs, à des gens disons des élites nationales de faire le voyage, un voyage assez long, aux États-Unis pour voir comment fonctionnent à la fois la recherche, la science et l’industrie américaine et peut-être tirer certaines leçons d’organisation, en particulier de management, comme on dirait aujourd’hui, de la recherche et de l’industrie. Ça a un rôle important ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Ça a un rôle très important et c’est tout à fait curieux parce qu’il y a deux tendances juxtaposées et qui se combinent. Cette tendance jacobine de Mendès-France à vouloir que la politique ait un rôle…
Emmanuel Laurentin : Que l’État soit central.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Que l’État ait un rôle d’incitation et d’arbitrage dans ce domaine et d’autre part, ces jeunes scientifiques ou industriels qui ont été en Amérique et qui ont été séduits par, non pas par le rôle de l’État, mais la liberté extraordinaire du fonctionnement des universités américaines.
Emmanuel Laurentin : C’est d’ailleurs le cas de ce même Jacques Monod dont on parle depuis le début de notre discussion puisqu’il vient du Parti communiste et aux États-Unis il découvre la liberté de la recherche, l’autonomie des centres de recherches, l’autonomie des universités dans ce domaine-là et il est assez bluffé, peut-on dire.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Il est absolument bluffé, sidéré par ces universités où des départements de recherche se géraient eux-mêmes avec une liberté d’utiliser les crédits considérables tandis qu’en France il fallait demander, pour la moindre des choses, pour acheter un appareil ou faire un voyage, au doyen qui lui-même devait les demander au Secrétaire de l’université, et d’autre part des départements de recherche où pas dans certains, dans un bon nombre même, le Président du département de recherche était élu par les chercheurs.
Emmanuel Laurentin : Et ça, ça le fascine ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Ça, l’a fasciné. Et si en 68, il est intervenu puissamment auprès d’Edgar Faure pour une libéralisation de l’université c’est bien parce qu’il conservait ce souvenir d’une université structurée en département de recherche et en département d’enseignement.
Emmanuel Laurentin : Alors, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, on voit donc qu’Étienne Bauer, par l’intermédiaire de votre femme, vient vous solliciter pour que d’une certaine façon vous serviez de truchement auprès de Mendès-France et au bout du compte, Pierre Mendès-France accepte cette idée, même s’il ne reste pas au pouvoir, d’être une sorte de parrain de la constitution progressive d’un colloque d’un nouveau genre, pourrait-on dire, qui finira par aboutir à la Toussaint 56, à Caen, avec ce discours entre autres que j’ai cité au tout début de notre discussion. Se met en place ce colloque, qui a une particularité, il y aura à peu près 200 à 250 participants, qui va mêler des industriels, des hommes politiques, des chercheurs qui vont débattre par commission de ce qu’il faut faire dans la recherche scientifique en France, c’est cela ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Exactement. Mendès-France, quand il avait été Président du Conseil, avait mis en place déjà des structures, recréé un secrétaire d’État à la recherche, c’était Longchambon, et créé un Comité de la recherche scientifique, qui a subsisté qui a maintenu d’ailleurs une activité jusqu’à 68, jusqu’à l’arrivée de de Gaulle. Mais tout cela était très fragile, Mendès était resté 7 mois et 17 jours au pouvoir, donc ça n’allait pas très loin.
Emmanuel Laurentin : Effectivement ces questions de politique de la recherche, il faut du temps pour les mettre en place.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Il faut du temps. Le ministère de l’éducation nationale dans cette phase, dont dépendait le CNRS, dont dépendait les enseignements supérieurs par conséquent une large partie de la recherche, était avant tout préoccupé par le baby-boom d’après-guerre, la nécessité de développer un enseignement secondaire…
Emmanuel Laurentin : De masse.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : De masse et débordé par ce problème, il ne se préoccupait que peu, si ce n’est par son conseiller, remarquable, Raymond Poignant, de l’enseignement supérieur et du développement de la recherche. Donc, le colloque de Caen, à la fois bizarrement, de façon ambiguë, en marge des pouvoirs publics…
Emmanuel Laurentin : Mais soutenu tout de même par les pouvoirs publics.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Soutenu tout de même par le pouvoir public puisque le gouvernement s’est fait représenter non pas par le ministre radical de l’éducation nationale, qui n’a pas voulu s’engager, bien que proche de Mendès, qui n’est pas venu…
Emmanuel Laurentin : Billères, c’était ça ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : René Billères.
Emmanuel Laurentin : Et c’était le secrétariat à la recherche, qui s’appelait Hamadoun Dicko, qui était un Soudanais.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Qui était un Soudanais.
Emmanuel Laurentin : Et qui vous a rejoint lors de ce colloque mais il y avait tout de même la présence d’un membre du gouvernement, même s’il était moins important que le ministre soi-même, mais il était tout de même là, ce qui vous donnait une sorte d’onction gouvernementale lointaine certes, mais tout de même.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Absolument, mais il faut ajouter qu’il était entouré par tous les directeurs du ministère de l’éducation nationale. Il y avait Gaston Berger, directeur des enseignements supérieurs, il y avait le directeur du CNRS, il y avait le directeur de la Bibliothèque nationale, il y avait l’administrateur du CEA, et pour ne pas parler de Louis Armand qui était président de la SNCF.
Emmanuel Laurentin : Louis Armand, c’est intéressant, parce que quand vous allez le voir dans le contexte de préparation de ce colloque de Caen, il est, dites-vous, le patron du clan des polytechniciens, une sorte de parrain de tous ceux qui ont fait l’X, et une des questions qui se posaient à vous, ainsi qu’à tous ceux qui réfléchissaient sur la question de la recherche scientifique en France, c’était - et là on peut dire il y a des échos récurrents de ces questions-là dans le débat public jusqu’à aujourd’hui – que doit-on faire de ces grandes écoles, de Polytechnique en particulier ? Doit-on la démanteler ? Lui faire faire des passerelles avec l’université ? Et là, vous rencontrez Louis Armand dans ce cadre-là, avec cette demande particulière de peut-être casser un peu ce monopole de la recherche de Polytechnique, cette excellence de Polytechnique, qu’est-ce qu’il vous répond, Louis Armand, sur ces questions-là ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Vous dites excellence de la recherche à Polytechnique, non ! Car justement, Polytechnique qui représentait l’élite, une élite scientifique française et mathématique ne faisait pas de recherche.
Emmanuel Laurentin : Exact.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Et les jeunes qui sortaient de Polytechnique à l’époque désertaient l’armée, comme c’est de plus en plus le cas pour les grandes écoles, et allaient prendre la direction de grandes entreprises et se vouaient à l’économie. Il y avait un gâchis d’une culture scientifique énorme, c’était très choquant.
Emmanuel Laurentin : Et lorsque vous proposez de casser un peu ce modèle à Louis Armand, qu’est-ce qu’il vous répond ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Louis Armand m’a dit : la France est un pays fragile, c’est un pays qui tous les 5 ans se remet en question, qui a besoin de noyau dur et Polytechnique est un des noyaux durs de la nation.
Emmanuel Laurentin : Et il vous dit que l’université de l’autre côté « est un corps mou rempli de cartilage »
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Rempli de cartilage. Ne touchez pas à Polytechnique, à moins qu’elle soit remplacée par quelque chose d’autre d’aussi solide.
Emmanuel Laurentin : On voit bien que les débats qui précèdent ce colloque de Caen, d’un nouveau genre, en 1956, sont des débats fondamentaux : enseignement de masse contre défense d’une recherche un peu élitaire dans le domaine scientifique, de l’autre côté grandes écoles / université, place du CNRS dans tout cela, comment avec 250 participants qui viennent de milieux très différents, puisqu’on a oublié de dire qu’il y avait là aussi des patrons d’entreprises,…
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Deux ou trois, mais ils étaient là.
Emmanuel Laurentin : Comment peuvent s’entendre toutes ces personnes sur une sorte de milieu commun, de déclaration commune qui ne soit pas une simple déclaration d’intention et qui permette justement d’aller un tout petit peu plus loin ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Le sentiment d’un vide, d’un manque était tout de même parmi tous ces participants quelque chose de fortement ressenti au moment où la reconstruction de l’après-guerre s’achevait et où il fallait aller vers, non pas une société nouvelle, mais une économie en développement, dans une France qui se reconstituait. Il a fallu d’abord une préparation très, très solide de ce colloque, à base de toute une série de rapports. Le rapport principal qui a été fait par Jacques Monod, Lichnerowicz, Edmond Bauer, le père d’Étienne dont j’ai parlé tout à l’heure, qui était collaborateur de Jean Perrin et professeur de physique fondamentale à la Sorbonne, a été discuté longuement justement sur les structures de la recherche, discuté en particulier avec Pierre Auger qui avait été directeur de l’enseignement supérieur et soumis ensuite à Mendès et discuté ensuite avec Mendès.
Emmanuel Laurentin : S’il y a un point sur lequel tout le monde semble s’entendre, c’est une discussion encore intéressante aujourd’hui, c’est celui du rôle de l’État dans cette affaire-là.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Absolument. La politique
Emmanuel Laurentin : La politique a quelque chose à voir avec la recherche et comme le dit dans son discours…
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : La recherche fait partie du politique.
Emmanuel Laurentin : Voilà. Et comme le dit dans ce discours que vous avez concocté et qui a été retravaillé par Pierre Mendès-France, on pourrait croire qu’il y a là une atteinte à la liberté des chercheurs mais c’est que l’État doit exercer son rôle qui est de décider et d’arbitrer, il ne lui appartient pas de tout régenter, ni même de tout administrer.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Absolument.
Emmanuel Laurentin : Son observation doit s’exercer dans le sens de la plus grande liberté, de la plus grande mobilité et l’État, dit Mendès et peut-être vous à l’époque, est aussi le garant de l’explosion des féodalités qui peuvent exister dans ce domaine de la recherche. Expliquez-nous ce dont vous vouliez parler quand vous parliez de cela.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Mendès-France était convaincu qu’une administration est incapable de se réformer par elle-même que donc seul le politique peut agir. Et dans le cas, agir, c’était casser la structure des facultés. Les universités étaient organisées en facultés avec, comme nous l’avons dit tout à l’heure, un certain nombre de chaires déterminées depuis le XIXe siècle. Il fallait donc dans notre esprit d’une part créer une instance politique responsable de la recherche, deuxièmement un fond financier permettant de répartir de l’argent autrement que le saupoudrage qui était fait à l’époque et troisièmement casser le cadre rigide des facultés et des chaires pour y substituer des départements d’enseignements et des départements de recherche et permettre par là même toutes les sciences interstitielles, toutes les sciences intermédiaires ou pluridisciplinaires qui étaient celles du développement nouveau, qui étaient celles des voies d’avenir.
Emmanuel Laurentin : Parce qu’il y avait effectivement des murs entre chacune des facultés et donc là il fallait faire des courants d’air d’une certaine façon.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Il fallait faire des courants d’air, des communications. Par exemple, une réaction, très intéressante, c’est celle de Stœtzel. Stœtzel était sociologue…
Emmanuel Laurentin : De la science politique en particulier.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Oui. Créateur des sondages en France, titulaire d’une des deux seules chaires de sociologie en France, incroyable à l’époque. Stœtzel disait : La sociologie, science humaine, a besoin de mathématique, elle est à base mathématique, les sondages sont à base mathématiques. Il faut enseigner les mathématiques aux sciences humaines »…
Emmanuel Laurentin : Et c’était impossible ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Interdit. Les mathématiques, c’est réservé aux domaines scientifiques. De même, en matière juridique, les économistes qui étaient brimés par les juristes, disaient : L’économie ne peut pas se développer – et Mendès approuvait naturellement les comptes de la nation étaient en partie à bases mathématiques – comment voulez-vous qu’on développe l’économie si l’on n’a pas des connaissances mathématiques statistiques ? Ah ! pardon, les mathématiques relèvent des facultés de sciences, elles n’ont pas le droit de rentrer dans les facultés de droit. Tout ça était d’une rigidité qu’il fallait absolument casser.
Emmanuel Laurentin : Alors, néanmoins ce colloque est important parce qu’il marque une sorte de premier jalon dans cette volonté d’organiser la politique de la recherche en France. Jalon qui avait été précédé par la création du CNRS d’une certaine façon et son développement après-guerre. Mais là, c’est un jalon plus large puisqu’effectivement il a l’ambition de réunir, à ce moment, à la fois l’industrie, la recherche dans les grandes écoles, la recherche à l’université, de penser globalement. C’est cela la question ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Globalement.
Emmanuel Laurentin : Et puis aussi, penser les effectifs. On est dans une période de croissance, on sort de la période de la reconstruction, on est en train de préparer ce qui va devenir le grand développement de la France dans les années 60, on a besoin de techniciens, d’ingénieurs, d’ingénieurs de recherche et de mettre en place une véritable structure, beaucoup plus large, qui touchent beaucoup plus de gens, c’est cela ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Absolument. Mendès-France radical, ayant le culte de l’enseignement et de l’école qui est à la base de la République qui doit former des citoyens ouverts, comprenant sur quoi ils ont à voter, ne séparait pas le développement de l’enseignement et considérait que pour avoir une grande politique il fallait mobiliser toutes les ressources intelligentes de la nation. C’est-à-dire développer un enseignement de masse au niveau du secondaire, qui devait être un enseignement dans la mesure du possible scientifique, et un enseignement supérieur largement ouvert…
Emmanuel Laurentin : Il fallait donc une élite nombreuse qui correspondait à cet enseignement de masse dans le secondaire…
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Les deux étaient inséparables.
Emmanuel Laurentin : Il fallait à la fois faire monter beaucoup plus de gens, des ouvriers, des enfants d’ouvriers, des enfants d’agriculteurs dans l’enseignement de masse mais aussi à un niveau supérieur développer en grand nombre ces ingénieurs, ces techniciens de recherche qui permettraient d’avoir une recherche qui tienne la route au niveau international, parce qu’il y avait toujours cette ambition internationale.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Exactement. L’ambition internationale. Nous n’avions plus de Prix Nobel. Mendès déplorait que, par exemple, le solde des redevances de fabrication atteigne 7 milliards de déficit pour la France. La balance des brevets qui était largement positive en 38 était devenue négative.
Emmanuel Laurentin : Donc, l’idée c’était de décupler l’encadrement professoral, augmenter le nombre d’étudiants bien évidemment mais aussi on commence à s’intéresser à ce moment-là, et ce colloque de Caen s’intéresse à ce moment-là, aux relations entre la recherche, le CNRS par exemple, et l’université. Et là, qu’elle est la position qui est choisie ? On évoque la possibilité que des chercheurs du CNRS participent à l’enseignement, que la recherche soit soutenue à l’université par l’intervention du CNRS, toutes choses qui sont encore en débat jusqu’à aujourd’hui.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Absolument.
Emmanuel Laurentin : Alors, ensuite on peut se dire, c’est bien beau, c’est un colloque, comment cela devient-il pérenne ? Est-ce que cela se transforme, malgré ou grâce à la présence d’un Secrétaire d’État à la recherche, en quelque chose de réel du point de vue gouvernemental parce que tout compte fait tous ceux qui sont là n’ont pas de pouvoir particulier ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Exactement.
Emmanuel Laurentin : On est en 56, à la fin 56, c’est la fin de la IVe République, on ne le sait pas encore bien évidemment, comment tout cela va-t-il se transformer ? Alors tout d’abord avec l’idée de renouveler l’expérience puisque tout compte fait vous êtes contents d’avoir organisé ce colloque.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Exactement.
Emmanuel Laurentin : Et ça a pas mal marché.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Ça a pas mal marché. Il y a eu un certain retentissement. Il y avait un journaliste du Monde, un journaliste du Figaro, un journaliste de l’AFP qui ont fait mousser la chose sans que ça n’ait tout de même un très grand retentissement en dehors des milieux enseignants.
Emmanuel Laurentin : Ça a tout de même fait grincer quelques dents dans le gouvernement à l’époque pour que quelqu’un se dise : qui sont ces gens-là ? Mendès n’est plus au gouvernement et il organise quelque chose, ça ne va pas très bien, ça.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Non, Non. Ça a fait grincer des dents en effet. Et l’année suivante nous avons organisé un colloque, à Grenoble, sur les relations université et industrie, qui était quelque chose de très nouveau car, comme le disait le nouveau directeur du CNRS, Coulomb, qui était venu inaugurer la première séance, au côté de Mendès : « Les relations entre l’université et l’industrie sont considérées comme une maladie honteuse, dans notre pays. »
Emmanuel Laurentin : Ce colloque de Grenoble qui a lieu à l’hiver 1957, pose quelques petits problèmes là aussi parce qu’on se dit : « Mais que vient faire encore Mendès dans cette affaire ? Il n’est plus aux affaires ». On vous pose des questions sur son invitation, doit-il venir ne doit-il pas venir ? Est-ce que s’il ne vient pas peut-être que les membres du gouvernement pourraient être présents ? S’il vient, ça va être plus compliqué. Ça pose quand même quelques problèmes d’origine politique tout de même.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Oui, oui. Et le président du Conseil en particulier n’était pas très favorable, néanmoins ce colloque a eu lieu.
Emmanuel Laurentin : Il a lieu en même temps que le lancement du premier Spoutnik.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Exactement au même moment, ce qui a été un choc.
Emmanuel Laurentin : Parce que vous voyez d’un seul coup que la science soviétique et la recherche soviétique avec effectivement ce moment très impressionnant qui est le premier lancement de ce satellite.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Et Mendès-France faisant valoir que les États-Unis et l’Union soviétique consacraient au moins 3% du produit national à la recherche alors que la France c’était 1,8%
Emmanuel Laurentin : Et d’ailleurs dans ce lien avec l’industrie de la recherche, vous êtes obligé, vous-même et ceux qui participent à ce colloque de Grenoble, de témoigner que lorsqu’il faut vraiment mettre de gros investissements sur la table on est obligé de passer par des sortes de bouts de ficelle, voire des crédits noirs, obtenir des États-Unis, de la Fondation Ford de l’argent quelquefois pour pouvoir faire des expériences qui concernent la recherche et qui ne peuvent pas être prise en compte par le budget de la recherche tel qu’il existe à ce moment-là.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Non, absolument. Le colloque a eu lieu à Grenoble où un homme tout à fait remarquable qui était devenu un très bon physicien, Louis Weil, qui est devenu d’ailleurs doyen de l’université, avait créé, avec Merlin-Gerin, un des premiers centres de formation continue pour la création de techniciens à partir d’ouvriers que l’on formait à mi-temps, moitié travail, en sandwich-cours. Toute cette organisation qui visait à former avec l’université, par collaboration entre l’université et les universitaires du Dauphiné, était financée au noir. Ils avaient créé une association qui finançait cette affaire. Au même moment, ma femme était passée à Orsay. Elle était administrateur du grand accélérateur de particules. Pour avoir des visiteurs étrangers, des techniciens de haut niveau, elle avait dû faire une caisse noire, ce qui était absolument scandaleux, condamnable par la Cour des comptes naturellement. Il fallait casser tout cela…
Emmanuel Laurentin : A ce moment-là, en parallèle se crée justement, un peu avant même d’ailleurs, à la sortie du colloque de Caen, une association qui va avoir un rôle essentiel, très important et qui va profiter d’une certaine façon des circonstances politiques on peut le dire, là.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Oui.
Emmanuel Laurentin : Cette IVe République qui a mis sur la touche Mendès-France, qui n’en voulait plus trop, va laisser la place à la Ve République, qui ne va faire plus de place à Mendès-France d’ailleurs, qui n’a pas a priori de politique de recherche extrêmement précise alors qu’aujourd’hui lorsqu’on regarde a posteriori on se dit mais c’est vraiment de Gaulle qui a lancé la politique de la recherche. Mais ce dont vous pouvez témoigner vous-même c’est que ces gens-là arrivent au pouvoir, n’ont pas vraiment de politique de recherche et en fait vous allez servir de centre de ressources un peu induit, en arrière de la main, avec cette Association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique (AEERS), qui a une revue, qui réfléchit à cette question de l’expansion de la recherche scientifique et qui va fournir, presque clefs-en-main pourrait-on dire, le fruit de 4 ou 5 années de recherche antérieures à ces nouveaux dirigeants qui arrivent avec la Ve République.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Oui. Les dirigeants de la Ve République sont arrivés, de Gaulle un peu par surprise, en mai 58. Il avait naturellement des idées politiques en ce qui concernait la Constitution et l’Algérie mais sur le reste rien n’avait été préparé. Presque aussitôt, curieusement Malraux, avant de devenir Ministre de la culture, était dans le gouvernement mais un petit peu flottant, avait demandé à se charger de problèmes de jeunesse et de recherche scientifique. Il y avait auprès de lui, la nièce de de Gaulle, Geneviève Anthonioz-de Gaulle, qui avait été déportée, dont on sait la haute valeur morale et les qualités merveilleuses. Geneviève Anthonioz m’a fait venir en me disant : Préparez-moi un décret. Sidérant, n’est-ce pas ! Moi, je ne suis pas en mesure de produire un décret mais tout le produit des réflexions du colloque de Caen et du colloque de Grenoble a été apporté, c’est-à-dire avant tout la volonté d’une responsabilité politique de défendre la recherche. C’était ça les deux choses.
Emmanuel Laurentin : Effectivement, ne jamais séparer la recherche et la politique, faire en sorte que ça aille ensemble, et puis de l’autre côté un fond de la recherche qui allait permettre déjà d’éviter ces caisses noires dont on parlait auparavant.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Qui permettait d’éviter les caisses noires d’une part et d’autre part d’aller plus loin que le CNRS. Parce que le CNRS était éducation nationale et recherche fondamentale mais depuis la Libération il s’était créée ou développé des organismes en marge. Le ministère de l’agriculture avait créé un Institut de la recherche agronomique très puissant, il y avait le CEA… Le CNRS, éducation nationale ou proche de l’éducation nationale n’avait pas le droit de distribuer de l’argent à ces organismes-là. Il fallait donc un pouvoir politique doté d’un fond qui domine et qui dans notre esprit détermine aussi, c’est là qu’il y avait un dirigisme qui a été contesté, des voies prioritaires de la recherche.
Emmanuel Laurentin : En même temps, on voit ce que ça peut donner ce dirigisme là dans le domaine de l’aérospatial, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de 2 ou 3 grands domaines qui seront les grands domaines de développement de la France des années 60. Il y a tout de même ça.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Absolument. De Gaulle, Pompidou, c’est surtout de Gaulle qui a vraiment voulu, Pompidou était très incertain dans cette affaire. Il avait d’abord voulu créé un comité simplement à responsabilité politico-scientifique, de Gaulle lui a dit : « A cette fusée, il faudrait un moteur ».
Emmanuel Laurentin : Et donc, ça sera la DGRST.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Ça a été un délégué à la recherche scientifique.
Emmanuel Laurentin : Pierre Piganiol, qui était un ancien déporté.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Pierre Piganiol. Et c’est lui qui a créé les structures qui sont devenues par la suite celles d’un ministère de la recherche.
Emmanuel Laurentin : Alors, là, on est en 59. Vous continuez tout de même votre travail de responsable de cette association, AEERS : Association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique et là, si on vient faire appel à vous dans cette affaire de préparation de décret, en 58-59, quand vous voulez faire un colloque à Dakar justement sur cette question, de ce qu’on appellera le Tiers-monde, de développement au Sud, là, on vous dit : C’est peut-être un peu plus délicat. Est-ce qu’il faut inviter Mendès ? Est-ce qu’il ne faut pas inviter Mendès ? Et là, le gouvernement, disons, est un tout petit peu circonspect sur vos prétentions dans ce colloque de Dakar.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Le colloque de Dakar qui était une très grosse chose parce que…
Emmanuel Laurentin : Décembre 69.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Décembre 69. Ça signifiait d’amener tous les représentants de la recherche française à Dakar et à Abidjan e de les faire discuter avec les représentants des 13 pays d’Afrique noire et de Madagascar, qui alors faisait partie de la communauté française.
Emmanuel Laurentin : Ce qui vous vaut cette phrase du directeur général du CNRS, Jean Coulomb, qui vous dit : « Si l’avion tombe, ça fera de l’avancement dans la recherche ».
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Là, il y a eu un incident qui n’a pas été bien agréable. Avant le départ, j’ai été convoqué chez le directeur du cabinet d’un ministre que je ne nommerai pas, qui m’a dit – j’avais prévu que viendraient 6 hommes politiques dont Mendès-France - : Nous vous serions très obligé d’ajouter un 7ème homme politique, Rémi Montagne, président des amitiés franco-africaines…
Emmanuel Laurentin : Or, Rémi Montagne était le tombeur de Mendès.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Le tombeur de Mendès-France aux précédentes élections.
Emmanuel Laurentin : Et là, que faire ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Moi, je voulais tout annuler. Mendès-France m’a dit : « Non, la recherche scientifique c’est au-dessus de tout. Il faut que cela soit au-dessus des partis ou l’objet de tous les partis. Je n’irais pas. N’emmenez pas d’hommes politiques et continuez. »
Emmanuel Laurentin : Ça veut dire tout de même que Mendès continuait à s’intéresser à cette affaire-là. Il était loin politiquement parce qu’il n’avait plus de responsabilité, en tous cas il n’était plus à l’Assemblée nationale à partir de ce moment-là, mais néanmoins il avait toujours un regard intéressé, porté sur cette question-là.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Absolument. Il n’a pas cessé de s’y intéresser au point que 3 ans avant sa mort, il aurait voulu que j’organise, en 78, alors que j’avais d’autres soucis et responsabilités, un colloque du 20ème anniversaire.
Emmanuel Laurentin : Sur ces questions-là. Justement, vous allez continuer à organiser des colloques tout au long des années 60. Vous allez organiser un colloque sur les rapports entre l’université et l’agriculture, c’était à Montpellier, qui est un grand centre de recherche en particulier en agronomie pour le Sud. Il y a également un deuxième colloque de Caen. Entre temps, il y aura un colloque à Bourges. Et ce deuxième colloque de Caen est un colloque important, c’est pour le 10ème anniversaire du premier, c’est donc en 66, on ne le sait pas mais on est deux ans avant 68 et quelques-unes des innovations qui apparaîtront comme très révolutionnaires du ministère Edgar Faure, après les événements de 68, voient leurs racines dans ce colloque de Caen, deuxième mouture en 1966.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Oui, ce colloque était intéressant parce que la réflexion avait progressé et c’est à ce colloque de Caen que Lichnerowicz, en accord avec Mendès-France, a lancé…
Emmanuel Laurentin : Grand mathématicien
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Grand mathématicien, professeur au Collège de France, a lancé l’idée de l’autonomie des universités. Le rapport fondamental qu’il avait préparé et sur lequel Mendès avait donné son accord, s’appelait pour « Pour des universités ».
Emmanuel Laurentin : L’idée, c’était 3 universités expérimentales…
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : L’idée de créer, pour commencer, 3 universités expérimentales, autonomes qui, dans la pensée de Lichnerowicz auraient été maîtresse de leur seuil, c’est-à-dire pouvant pratiquer la sélection à l’entrée.
Emmanuel Laurentin : La grande question c’est justement cette question de la sélection puisqu’en 1956 et 1966 il y a eu le fameux plan Foucher, le développement d’un enseignement de masse qui se met en place dans la France des années 60, et la question de l’accès à l’université, sélection ? Ou pas sélection ? Et là-dessus, une association comme la vôtre est divisée. Il y a ceux qui sont pour la sélection et ceux il y a ceux qui sont contre. Majoritairement, vous êtes contre la sélection mais il y a une forte minorité qui plaide pour la sélection.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : En effet. Il me paraît curieux aujourd’hui que la majorité ait été contre la sélection, mais il faut revoir les choses à l’époque. Les jeunes universitaires appuyés par les grands et nouveaux centres de recherche voulaient une élite française de haute qualité et pensaient que pour y arriver il fallait les grands nombres, une large ouverture des universités, des grands nombres qui leur permettraient d’avoir des postes, d’avoir des crédits et ceci contre les disciplines et les professeurs qui étaient malthusiens, spécialement les médecins et les juristes.
Emmanuel Laurentin : Pour les numerus-clausus d’une certaine manière.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : C’est ça. Les médecins et les juristes qui formaient des élites. Ce n’était pas les chercheurs, faculté de droit, on dit : « l’École de droit », faculté de médecine, on dit : « l’École de médecine », c’était les deux centres qui formaient des professionnels et qui étaient tout fait élitistes.
Emmanuel Laurentin : Par exemple, on peut trouver la défense de la sélection chez des gens auxquels on ne s’y attend pas forcément, par exemple Laurent Schwartz…
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Grand mathématicien.
Emmanuel Laurentin : Est favorable à la sélection à l’entrée de l’université ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Absolument. Il considérait qu’il fallait, pour une culture d’excellence, pour produire des élites, il fallait une sélection. Et Mendès n’était pas contre à la condition qu’il y ait pour tous ceux qui sortiraient de l’enseignement secondaire des enseignements supérieurs qui ne soient pas universitaires, qui soient professionnels et largement ouverts, sans sélection. Mais les universités elles-mêmes, qui devaient être des centres d’excellence, devaient…
Emmanuel Laurentin : Pratiquer la sélection.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Il l’admettait. Il était hésitant, mais il l’admettait.
Emmanuel Laurentin : Au bout du compte ce qui va arriver, c’est exactement l’inverse.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Ça a été exactement l’inverse.
Emmanuel Laurentin : En fait on a créé des instituts universitaires de technologie, les fameux IUT, qui normalement, dans cette pensée-là, devaient être ouverts au plus grand nombre...
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Pour lesquels on a institué la sélection.
Emmanuel Laurentin : Et de l’autre côté des universités, qui devaient être réduites, dans la pensée de quelqu’un en tout cas comme Laurent Schwartz...
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Et qu’on a ouvert à tout le monde..
Emmanuel Laurentin : Et alors qu’est-ce que c’est ce jeu de bonthos ? Qu’est-ce qui s’est passé pour cela soit comme ça ? C’est parce qu’il a une grande majorité de gens qui réfléchissaient à ces questions-là qui étaient favorables à l’ouverture la plus large ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Politiquement, sentimentalement, la gauche française était favorable à l’ouverture. Elle n’avait pas beaucoup réfléchi à ce problème mais était favorable à l’ouverture des universités, l’université pour tous, Parti communiste, Parti socialiste sans aucun doute. D’autre part, comme je vous le disais tout à l’heure, ces jeunes savants qui arrivaient au pouvoir, voulaient accueillir de grands nombres à l’université,
Emmanuel Laurentin : De grandes cohortes.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : De grandes cohortes, c’était avoir des postes scientifiques, des crédits pour la science ce qui leur permettrait de créer des troisièmes cycles dans lesquels ils formeraient es chercheurs. Ils étaient tous devenus des professeurs de troisième cycle, ils ne connaissaient pas bien, ou moins bien, les étudiants qui entraient dans l’université. Donc, ils ont plutôt milité pour l’ouverture large que Foucher s’est laissé aller à créer.
Emmanuel Laurentin : On voit très bien que vous, vous n’étiez pas très favorable à cette orientation-là. En y réfléchissant, en regardant même rétrospectivement ce qui s’est passé, vous étiez favorable au numerus-clausus, à la sélection à l’entrée à l’université ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Moi, j’étais très hésitant. Très hésitant, c’est vrai. Mais enfin, je trouvais que la formule proposée, que Mendès acceptait n’est-ce pas, d’un double enseignement : un enseignement extérieur, comme les juniors collèges américains, qui seraient ouverts à tout le monde et puis des universités pratiquant la sélection, je trouvais que c’était jouable. Enfin, ça a été écarté. Nous n’avons pas conclu dans ce sens. Les 3 universités test, témoins, expérimentales voulues par Lichnerowicz, maîtresses de leur seuil, c’était une voie. C’était quelque chose d’intéressant, qui allait dans ce sens.
Emmanuel Laurentin : Cette réflexion sur la recherche va petit à petit s’éteindre au début des années 70. Vous allez avoir d’autres fonctions, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, mais vous allez continuer à vous y intéresser encore et quand vous voyez les discussions qui se tiennent encore aujourd’hui autour de ces questions, que vous avez débattues, il y a 50 ans, vous avez quel regard ? Est-ce que vous avez l’impression que tout compte fait on rejoue et on rebat les mêmes cartes ? Ou est-ce qu’effectivement la recherche et la politique scientifique a tellement évolué depuis 50 ans que ce n’est pas exactement la même donne qu’il y a 50 ans lorsque vous faisiez le colloque de Caen, en 1956 ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Ce n’était pas exactement la même donne parce que tout d’abord on a vécu pendant 30 ans sur ce que de Gaulle a fait, les réformes qu’il a faites et puis la volonté d’injecter des crédits considérables. On a vécu 30 ans là-dessus. A nouveau, on se trouve devant une certaine sclérose de l’université et du CNRS, qui sont devenus des monstres, il faut bien le dire. Ces universités gigantesques où les premiers cycles sont dramatiquement abandonnés, qui constituent des universités garages, on peut dire, et ce CNRS qui est très lourd mais qui tout de même maintient la recherche fondamentale, qui est un des organismes essentiels de nos structures, tout ça ne va pas bien aujourd’hui. A nouveau il faut revoir les relations université – industrie. Le problème de l’autonomie des universités reste ouvert, comme il l’était à l’époque. Et le problème de la sélection reste encore aujourd’hui un problème très important. On ne peut pas éternellement laisser des centaines, des milliers de jeunes s’engouffrer dans les premiers cycles universitaires où la majorité d’entre eux n’aboutissent à rien et dont ils sortent sans diplômes. Ça, ce n’est pas possible. Donc, il y a nécessité d’une politique volontaire qui ne sera pas faite, comme le disait Mendès-France, par les administrations incapables de se réformer elles-mêmes.
Emmanuel Laurentin : Mais il y a une deuxième donne qui est une donne économique globale, pourrait-on dire. Lorsque vous pensez, le colloque de Caen et les années suivantes les autres colloques qui vont suivre, c’est dans un contexte de très fort développement économique du pays…
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Or, nous sommes en récession.
Emmanuel Laurentin : Et alors, là, ça change complètement la donne, j’imagine ? Ça doit changer totalement la façon dont on peut penser cette question de développement de la recherche, même si aujourd’hui ces nouveaux discours qui font écho aux discours que vous teniez à l’époque sur la recherche et l’industrie de demain, la recherche c’est le profit de demain, sont à nouveau remis en selle ?
Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Absolument. Mais enfin, nous voyons des choses consternantes. C’est-à-dire quantité de jeunes docteurs, de grande qualité, qui ne trouvent pas de travail. Quand je pense à celui qui a fait une thèse d’histoire, remarquable, sur le BCRA, l’année dernière et qui est réduit à être professeur de lycée, peut-être à vie professeur de lycée, alors qu’en Amérique on lui offrirait n’importe quoi, tous les crédits qu’il voudrait, il y a quelque chose, qui là est tout à fait scandaleux. Les domaines d’excellence de la recherche française se réduisent alors que les Anglais ont réussi à maintenir la plupart des leurs. Le nombre de Prix Nobel français s’est à nouveau réduit malgré quelques grands succès. L’évaluation ne fonctionne pas bien, en tout cas pour les sciences humaines. Il y a vraiment quantité de problèmes graves qui sont ouverts et qui sont à trancher.
Emmanuel Laurentin : merci en tout cas, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, d’avoir été notre invité, aujourd’hui pour cette histoire de relations entre science et politique et de nous avoir éclairé sur la préparation des réflexions contemporaine justement sur les rapports entre science et politique depuis une cinquantaine d’années.
Et puis précisons que vous travaillez actuellement à une biographie d’un personnage, dont il nous faudra reparler, très important, que vous avez connu à Londres et qui a été un des proches de Mendès, Georges Boris, sur lequel vous êtes en train d’écrire, on peut espérer votre livre d’ici peu.
Notre numéro de téléphone : 01 56 40 25 78. A la technique aujourd’hui Claude Cortou ( ?), à la réalisation Charlotte Roux.