LE « RAPPORT » CINQ ANS APRÈS
Les deux éditions qui ont été faites du rapport que j’avais rédigé en octobre 1979 sur le projet du Musée de la Villette sont épuisées depuis longtemps. Ce texte étant souvent demandé par les nombreux partenaires qui, de près ou de loin, travaillent en liaison avec nous, une réédition a été prévue dans la collection des « études » du Musée. Toutefois, au lieu de le publier tel quel, il a paru intéressant d’y ajouter un commentaire sur l’évolution du projet depuis cinq ans. Ce commentaire est volontairement concis : le projet n’est pas terminé, même si le parcours de la « dernière ligne droite » est maintenant entamé. Le moment n’est pas encore venu de faire une étude historique de ce grand projet, étude qui sera sûrement nécessaire un jour, compte tenu de son caractère novateur et de sa complexité.
La préface du Rapport montre clairement que tous les « acteurs » de 1979, les membres du Comité consultatif et aussi ceux de la « Mission du Musée », avaient pleine conscience de l’ambition du projet. La suite de l’histoire a bien montré que nous ne nous trompions pas, mais que peut-être nous avions sous-estimé les difficultés rencontrées, moins sur le « contenu » du projet lui-même (ces difficultés-là avaient été bien soulignées), que sur son environnement : le bâtiment d’abord, dont la complexité n’est apparue que progressivement, le contexte socio-économique ensuite, qu’il a fallu intégrer dans le projet tout en subissant les contrecoups.
Malgré tout, l’impression qui domine à la relecture du « Rapport » est que finalement, les objectifs, le contenu et les fonctions du Musée ont été remarquablement maintenus. Seules quelques inflexions nouvelles, que je soulignerai, et des fonctions supplémentaires, sont apparues nécessaires en raison de l’évolution des techniques de communication depuis cinq ans. Pour l’essentiel, le projet est resté le même, à travers bouleversements politiques qui sont intervenus depuis 1979, à travers les changements de ses responsables aussi : entre le hasard - l’existence du projet abandonné des abattoirs de La Villette - et la nécessité - celle de rattraper le retard pris par notre pays dans un domaine essentiel – c’est donc la nécessité, reconnue et soutenue par une volonté politique continue qui l’a emporté et qui a permis que soit maintenu, contre vents et marées, le cap défini il y a cinq ans.
LE PROBLÈME DU NOM
J’avais bien souligné dans le texte de 1979 la nécessité de trouver une autre appellation que celle du « Musée », et ceci pour deux raisons :
– Ce mot ne couvre pas la complexité et la variété des fonctions remplies par l’établissement, qui ne se contentera pas, bien entendu de présenter des expositions ;
– d’autre part, ce mot a en France une connotation passéiste qui ne reflétera pas du tout le caractère moderne et tourné vers l’avant du projet.
Faute de proposition réellement convaincante, j’avais distingué entre le « Centre », qui désignait l’ensemble de l’établissement et ses diverses activités, et le « Musée », qui désignait plus spécialement l’exposition permanente. Nous sommes maintenant assez près de trouver une alternative satisfaisante.
À la suite d’un concours interne à l’établissement Public du Parc de La Villette, la dénomination « Cité des sciences et de l’industrie » a émergé comme une alternative relativement satisfaisante. Une étude de public réalisée extérieurement et actuellement en cours permettra peut-être de trouver une dénomination complémentaire plus frappante pour l’esprit du public.
D’autre part, « La Villette » a commencé à s’imposer pour désigner un ensemble culturel unique en France, qui rassemble de façon originale et novatrice les sciences et les techniques, les arts plastiques et la musique.
LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET
Disons d’abord que les objectifs du projet n’ont pas changé. Deux nuances seulement apparaissent par rapport à la présentation que nous en faisons maintenant :
– Nous mettons l’accent encore davantage sur la nécessité de toucher de diverses manières tous les publics. Ceci est dû principalement à l’ampleur de la tâche de modernisation des esprits, dont le caractère prioritaire est maintenant compris.
– D’autre part, la place de l’industrie dans le projet est marquée encore davantage, et de façon plus structurée. En plus de l’exposition permanente, où l’industrie est très présente à l’intérieur des ensembles fonctionnels, et des expositions temporaires dont une proportion importante est réalisée en partenariat avec des entreprises, des espaces spécifiques ont été définis qui n’existaient pas – du moins explicitement- dans le projet de 1979.
Après mon retour à la direction du projet, en novembre 1983, beaucoup d’interlocuteurs m’ont pressé de définir une espèce de « grille de lecture » du Musée, dont les finalités et les « messages » n’apparaissaient pas clairement, en raison de la complexité qu’il avait acquis au cours du temps. Autrement dit, face à la diversité, de plus en plus perceptible des activités, face au foisonnement des « thèmes » de l’exposition permanente, une certaine unité dans les idées directrices était devenue nécessaire.
On sait qu’un musée, comme toute création culturelle, est œuvre personnelle, qui reflète d’abord l’esprit de ceux qui l’ont créé. Au risque donc de paraître arbitraire mais avec le souci de choisir des directions acceptables par le plus grand nombre, j’ai choisi trois orientations, qui sont logiquement liées et qui traduisent assez fidèlement, il me semble, les objectifs de la Cité des sciences et de l’industrie :
– L’aventure humaine, à laquelle la Science et l’industrie ont contribué de façon décisive et qui concerne absolument tout le monde, car chacun y contribue à sa manière, quelle que soit sa place dans la société. Cette « aventure humaine », que raconte le Musée, touche donc directement tous les visiteurs.
– Le risque, inhérent à toute aventure, vis-à-vis duquel nous devons faire preuve de lucidité et de responsabilité.
– La transition de la troisième révolution industrielle à laquelle nous devons nous préparer en comprenant bien les enjeux, les contraintes et les conséquences, et en acquérant la souplesse d’esprit nécessaire pour faire face aux changements que nous vivons nécessairement dans les prochaines décennies.
Pour le reste, on peut dire que la Cité des sciences et de l’industrie, créée cinquante après le Palais de la découverte, projet novateur en 1936, représente à son tour quelque chose de tout à fait neuf, le prototype d’une autre génération de « musées ». Elle tient son originalité, déjà soulignée dans le Rapport, de trois caractéristiques essentielles :
a) On s’efforce de ne pas séparer la présentation des sciences et des techniques de leurs conséquences socio-économiques (d’où l’importance d’une présentation des sciences humaines, sur laquelle je reviendrai). On ne fait pas une présentation triomphaliste des résultats de la technologie, mais on démontre au contraire de façon critique – au sens neutre du mot - les ambivalences du progrès.
b) La Cité prend en compte aussi complètement que possible, malgré des contraintes budgétaires inévitables, la révolution survenue depuis dix ans dans les techniques audio-visuelles et informatiques.
c) Enfin, c’est la première fois qu’on rassemble en un même lieu des moyens de communication aussi divers, ce qui devrait nous permettre de toucher d’une manière ou d’une autre, tous les visiteurs.
LA STRUCTURE DU PROJET
Le principal élément nouveau, par rapport à 1979, c’est le parti architectural qui était inconnu au moment du Rapport, même si j’avais bien présente à l’esprit la structure générale du bâtiment. Le projet d’Adrien Fainsilber, choisi en octobre 1980, avait me semble-t-il, sur ses concurrents, deux éléments de supériorité :
– Il n’essayait pas de dissimuler la structure existante, mais au contraire s’appuyait sur elle tout en la mettant en valeur ;
– Il avait, d’autre part, pleinement assimilé l’esprit du Rapport et s’était donc efforcé de la traduire le plus possible dans les structures architecturales.
Malgré cela, c’est la complexité du bâtiment qui, à partir de 1980, a dominé le contenu. Je crois que cette omniprésence architecturale sera particulièrement sensible au visiteur, comme à celui du Centre Georges Pompidou, mais par des voies sensiblement différentes. D’autres part, les délais considérables intervenus dans la construction (près de six ans après le début du projet ! …) ont pesé sur les réalisateurs du contenu, car les perspectives d’ouverture s’éloignant, l’urgence des choix et la nécessité d’un travail intensif en équipe ne sont apparues que tardivement.
Après le bâtiment, ce qui a changé le plus dans le projet c’est l’importance accrue donnée à la Médiathèque et à l’utilisation de la télématique, de l’audiovisuel, de l’informatique. Les responsables de ces secteurs ont choisi, et ils ont eu raison, un parti sensiblement plus ambitieux que celui que j’avais cru prudent d’adopter il y a cinq ans. Là où je pensais que La Villette pourrait éventuellement être connectée à une douzaine de points du territoire national, le réseau Télétel auquel est couplé le système SEVIL nous permet maintenant d’espérer être présents d’ici quelques années, dans trois millions de foyers oud d’établissements culturels. De même, le passage de la bibliothèque ou de la vidéothèque classique à une véritable Médiathèque, faisant largement appel au vidéodisque consultable de façon automatique et décentralisée, a été rendu possible par le progrès technique de ces dernières années. Enfin, une gestion technique centralisée à la fois du bâtiment et des expositions, dont l’expérience n’était qu’à ses débuts il y a cinq ans, est maintenant techniquement réalisable et financièrement avantageuse, dans la mesure où elle simplifiera la maintenance.
À l’intérieur des expositions, les enjeux informatiques, les produits audio-visuels interactifs peuvent maintenant être généralisés sans trop de difficultés, bien que leur entretien soit relativement compliqué et coûteux.
Si l’on laisse de côté pour le moment les espaces d’expositions sur lesquels je reviendrai, on trouve encore un certain nombre de changement qui représentent tous un accroissement fonctionnel, plutôt qu’une diminution par rapport aux idées de 1979. Mais ces choix plus ambitieux sont justifiés, car ils permettent de valoriser le bâtiment et les autres composants de la Cité. Citons les changements les plus importants :
- 1. Le centre international de conférences sera certainement très utilisé par nos partenaires extérieurs, car un tel centre, orienté vers les sciences et les techniques, fait grandement défaut à Paris. Il regroupe des salles de conférences qui étaient prévues mais dans un ensemble plus cohérent et plus facilement valorisable.
- 2. Les salles de découverte ont été étendues à la petite enfance, donnant ainsi naissance à ce que nous appelons l’Espace enfance.
- 3. En ce qui concerne la formation, le projet actuel, tout en conservant les orientations du Rapport, est plus ambitieux, car il inclut maintenant les « Classes Villette » qui s’intégreront dans le programme des classes de découverte du Ministère de l’éducation nationale, et permettront dans quelques années à quarante classes d’être présentes en permanence dans le Musée, avec une durée de rotation de deux semaines. D’autre part, la formation des animateurs – pour le Musée, mais aussi pour les centres du réseau national - constitue une mission renforcée.
- 4. Les moyens consacrés à l’industrie sont, comme je l’ai dit, accrus et davantage structurés. En plus des espaces d’exposition, nous prévoyons maintenant :
- une « Maison des industries », espace d’information de nature technique, économique et sociale sur les entreprises, où seront présents également les problèmes de carrière, de formation, de création d’entreprises ainsi que les événements industriels liés à l’actualité,
- un « Espace industrie » de 5000 m2 qui permettra de réaliser dans un lieu spécifique les « actions menées avec l’industrie et les grands établissements publics » qui avaient été proposées dans le Rapport.
- 5. Enfin la Géode, réalisation spectaculaire de la salle « Omnimax » prévue dans le Rapport, est à la fois une grande réussite architecturale, un « signal » pour la Cité et un moyen probablement très efficace d’attirer le grand public et les visiteurs du Parc vers le Musée lui-même.
L’EXPOSITION PERMANENTE
Ce que j’appelais « exposition quasi-permanente » dans le Rapport s’est trouvé réduit par la sage volonté du Gouvernement à un espace de 30 0002 situé sur trois travées dans la partie haute du bâtiment.
La proposition essentielle du Rapport a été conservée, celle d’abandonner la division disciplinaire, de partir au contraire des données concrètes connues du visiteur et d’utiliser des présentations intégrées, regroupant les aspects scientifiques, techniques et industriels.
De même, les trois niveaux de « lecture » du musée, les niveaux visuels, interactif et conceptuel, ont été maintenus, ainsi que la présence d’éléments « phares », c’est-à-dire d’éléments spectaculaires destinés à attirer et à frapper les visiteurs.
La différence essentielle tient à l’organisation générale. Le Rapport proposait une trentaine de thèmes. La nécessité s’était vite imposée à nous de regrouper ces thèmes en quatre grandes « sections » pour éviter un fourmillement dans lequel le visiteur aurait risqué de se perdre. À l’heure actuelle, si les thèmes – tels qu’ils avaient été conçus en 1979, et sur lesquels les équipes du musée ont travaillé jusqu’en 1983 – ont été plus ou moins abandonnés, la division en secteurs a été maintenue, leur contenu n’étant finalement pas tellement différente de ceux qui avaient été proposés dans le Rapport : « De la terre à l’univers » au lieu de « l’univers », « l’aventure de la vie » au lieu de « la vie », « la matière et le travail de l’homme » au lieu de « la matière et la technique », « langage et communication » au lieu des « sociétés humaines ».
Pour la réalisation, on a été amené à définir des « ensembles fonctionnels » qui ne recouvrent pas les thèmes prévus au départ mais qui, dans leur esprit n’en diffèrent pas tellement non plus. Il y en a au total vingt et un, ce qui représente exactement le même nombre que celui des thèmes retenus après la réduction de surface d’exposition permanente. La différence tient surtout au fait que le contenu des ensembles fonctionnels est encore plus multidisciplinaire que celui des anciens thèmes, et que les domaines correspondant sont encore plus proches des préoccupations du public.
L’évolution du projet a donc conduit à une véritable radicalisation du parti que j’avais adopté. Il faut reconnaître en effet, dans la liste des thèmes que j’avais suggérée à titre indicatif, plusieurs d’entre eux étaient encore très proches des disciplines traditionnelles. Je n’avais pas eu assez de temps pour réfléchir profondément au contenu des thèmes : en poursuivant mes réflexions, je serais presque certainement arrivé au système actuel, étant entendu que le choix des ensembles fonctionnels est nécessairement un peu arbitraire, car il est impossible d’être encyclopédique et que par ailleurs d’autres ensembles seront créés dans les années qui suivront l’ouverture car l’exposition « permanente » est, on doit l’espérer, destinée à évoluer.
Une heureuse révolution de l’exposition permanente a, d’autre part, conduit à intégrer davantage dans les présentations les préoccupations issues des sciences humaines, sans pour cela faire de cette présence un « gadget » qui ne respecterait pas leur problématique propre. Il s’agit en particulier de l’histoire, de l’ethnologie, de la psychologie, de l’économie et de la linguistique. Il n’est pas facile de concrétiser dans des éléments de présentation les résultats des sciences humaines. L’expérience dira si nous avons réussi. De toutes manières, c’est certainement l’un des aspects du Musée qui suscitera le plus de discussions et de controverses … !
Dans le chapitre sur la réalisation du Musée, j’avais préconisé l’utilisation d’une architecture intérieure modulaire, afin de donner de la souplesse aux expositions. Cette proposition a été traduite dans les faits d’une façon tout à fait remarquable, qui constituera probablement l’une des grandes originalités de la Cité : c’est ce que nous appelons « les systèmes internes » qui permettront de mettre en scène les expositions permanentes et temporaires d’une façon souple et originale. Cependant, le choix qui a été fait - celui d’une architecture métallique issue du concept de « container » - devrait accentuer encore le caractère très technologique des espaces du Musée, déjà imposé par la structure architecturale du bâtiment.
J’avais beaucoup insisté dans le Rapport sur la nécessité de préfigurations, destinées à confronter les réalisations avec les réactions du public. Cette demande a été largement entendue car après Janus I, après un certain nombre d’expositions faites dans différents points du territoire national et mêle à l’étranger, l’année 1985 verra se réaliser un nombre important de nouvelles préfigurations du Musée. On a même été, de façon très pertinente, un peu loin que ce que j’avais demandé, puisqu’une équipe d’évaluation analyse, à propos de chaque préfiguration, les réactions du public afin d’en tirer des enseignements ensuite.
De même, l’accent mis dans le Rapport sur l’importance de l’animation a été bien compris, et nous nous préparons actuellement à former les premières dizaines d’animateurs qui, après avoir été mis à l’épreuve à l’occasion des préfigurations, constitueraient l’encadrement des futures équipes d’animation du Musée.
LE PARC ET LA CITE DE LA MUSIQUE
Je ne terminerai pas cette brève analyse sans dire quelques mots des autres projets qui vont s’édifier sur le site de La Villette. Aucun de ces projets n’était vraiment défini en 1979. On savait qu’il y aurait un Parc, mais on l’envisageait de façon très conventionnelle. Le projet original est ambitieux de Bernard Tschumi va constituer, quand il sera réalisé complètement, un environnement incomparable pour la Cité des sciences et de l’industrie : un élément d‘attraction supplémentaire et une grande richesse de complémentarités. Au moment où j’écris mon Rapport, on discutait beaucoup du sort des trois halles qui se trouvaient sur le site. Le parti qui a prévalu, celui de ne garder que la plus grande et la plus représentative, a permis d’édifier un espace remarquable, la « Grande Halle » qui, elle aussi, permettra des actions concertées et complémentaires avec le Musée, et surtout étendra le domaine culturel de la Villette à tous les arts.
En fin, la décision de transférer sur le site le Conservatoire national de musique et le Musée des instruments et de compléter par des salles de concerts, va permettre de rassembler à la Villette une véritable masse critique et donc d’accroître les chances de succès de ce projet. Je trouvais, en 1979, que le projet du Musée était ambitieux. Je n’aurais pas osé espérer, à l’époque, que s’y édifierait l’un des plus grands culturels européens.
PRÉFACE
Le 19 février 1979, un Conseil restreint sur les espaces verts décidait de la création du Parc de La Villette et arrêtait le principe de la réalisation, dans son cadre, d’un Musée nationale des sciences et de l’industrie. Il m’était alors demandé de réfléchir aux objectifs de celui-ci, ainsi qu’à ses modalités d’action et de réalisation.
Parallèlement, Madame le Ministre des universités, à qui était confiée la tutelle du futur établissement, mettait en place un Comité consultatif chargé de m’assister dans ce travail de réflexion, particulièrement en ce qui concerne la mission du Musée et l’étendue de ses activités. Ce Comité, qui m’était demandé de présider, était composé des personnalités suivantes :
– Monsieur Édouard BONNEFOUS, président de la Commission des finances du Sénat, chancelier de l’Institut, président du Conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers ;
– Monsieur François de CLOSETS, journaliste ;
– Monsieur Paul DELOUVRIER, membre du Conseil économique et social, président de l’Établissement public d’aménagement du Parc de La Villette ;
– Monsieur Gilbert GANTIER, député de Paris, adjoint au maire de Paris ;
– Monsieur Jean HAMBURGER, membre de l’Institut, professeur à l’Université René Descartes, directeur du Centre de recherches néphrologiques de l’hôpital Necker ;
– Monsieur Alfred KASLER, membre de l’Institut, Prix Nobel, professeur honoraire à l’Université Pierre et Marie Curie ;
– Madame Hélène MISSOFFE, député de Paris ;
– Monsieur Louis NEEL, membre de l’Institut, Prix Nobel, professeur honoraire à l’Université de Grenoble ;
– Monsieur Roger TAILLIBERT, architecte en chef du Grand Palais.
Le Comité consultatif a souhaité par la suite que deux personnalités du monde industriel pissent se joindre à ses travaux. Il s’agit de :
– Monsieur jean PANHARD, président de la Chambre syndicale des constructeurs d’automobiles ;
– Monsieur Antoine RIBOUD, président directeur général de BSN –Gervais –Danone.
Le Comité consultatif a tenu cinq réunions entre mars et octobre 1979. Les avis qu’il a formulés au cours de ces réunions, les discussions que j’ai eues par ailleurs avec la plupart de ses membres, ainsi que les contributions écrites de certains d’entre eux, m’ont considérablement aidé dans ma tâche de réflexion, et je voudrais les en remercier très vivement.
Nous avons à tenir compte au départ d’une donnée fondamentale : les caractéristiques de la « grande salle » de la Villette, qui est destinée à abriter l’essentiel du futur Musée, est d’abord la superficie disponible, c’est-à-dire environ 140 000 2, sans compter les sous-sols.
L’échelle du projet nous conduit donc nécessairement à prendre un parti ambitieux, ce qui n’exclue pas d’ailleurs la prudence dans la méthode de réalisation ni la recherche de solutions raisonnables du point de vue économique.
Une autre donnée est non moins importante : les réalisations étrangères, et le retard pris par notre pays dans ce domaine. Il ne nous paraît pas possible de proposer un projet qui ne soit pas au moins comparable aux établissements étrangers les plus significatifs. Il nous a semblé même que les progrès faits au cours des dernières années dans les méthodes de communication, ainsi que l’expérience acquise par notre pays dans le domaine muséologique, nous permettent d’aller plus loin, et de concevoir un projet qui soit, de plusieurs manières, tout à fait novateur.
Le rapport qui suit, et qui constitue ce qu’on appelle d’habitude une « étude de faisabilité » [1], concerne les caractéristiques générales du projet, les fonctions du futur Établissement, ainsi que son organisation, son fonctionnement et la méthodologie de sa réalisation. Il est assez détaillé, afin de permettre au lecteur de se faire une idée précise du type de Musée qu’il est proposé de créer. D’autre part, il a semblé qu’un document de ce genre pouvait se révéler utile, par la suite, quand il s’agira de bâtir un programme architectural, en incluant, bien entendu, les modifications et adaptations qui paraîtraient nécessaires en fonction des décisions du gouvernement. Le lecteur qui veut se faire une idée synthétique et rapide de nos propositions peut se reporter au chapitre intitulé : Conclusions et recommandations, pages 87 et 92. Le présent rapport en contient pas l’analyse des propositions relatives au statut juridique envisagé pour le Musée, ni les prévisions budgétaires correspondant à sa réalisation et à son fonctionnement. Ces éléments sont, à ce stade, très difficiles à formuler de façon certaine. Nous avons préféré les inclure dans un document séparé, qui sera disponible ultérieurement.
Je voudrais en terminant exprimer ma reconnaissance à tous les organismes et à toutes les personnes qui m’ont apporté leur aide dans l’accomplissement de ma mission. Plus particulièrement, je voudrais remercier le Conservatoire national des arts et métiers qui nous a accordé son hospitalité et son appui logistique, la Direction, les Comités scientifiques et les chefs de sections du Palais de la découverte qui ont participé à notre effort de réflexion, le Centre national de la recherche scientifique qui a mis à notre disposition des moyens en personnel ainsi que le Secrétariat d’état à la recherche et le Ministère des universités sans l’aide matérielle desquels ce travail n’aurait pas pu être fait.
INTRODUCTION
Pourquoi un nouveau musée ?
L’aventure scientifique
La science, c’est-à-dire la recherche de la connaissance, la réalisation du désir éternel de savoir et de comprendre, est sans doute l’un des destins les plus spécifiques, les plus nobles et les plus excitants de l’aventure humaine. Faire comprendre cet accomplissement extraordinaire, dont l’essentiel a été obtenu en moins de deux siècles, est une tâche aussi importante que celle qui consiste à présenter au public les œuvres les plus significatives de la création artistique, cette autre poursuite fascinante du génie de l’homme.
Développer l’esprit critique
D’autre part, la méthode scientifique est d’exceptionnelle vertu pour la formation de l’esprit critique, le développement lucide lui permettant de se défendre contre la montée des illusions et des confusions qui caractérise un monde devenu chaque jour plus vaste et plus compliqué. La démonstration de cette démarche rigoureuse, dans le cadre d’une présentation des résultats de la recherche scientifique, aurait une valeur élevée de formation de l’esprit du public, et permettrait en même temps à celui-ci d’acquérir le recul nécessaire sur le sens de l’aventure humaine et de sa propre histoire.
Mieux comprendre le présent pour mieux gérer le futur
Par ailleurs, et plus qu’à aucune autre époque, notre vie est influencée par les applications de la science et de la technique. Celles-ci sont devenues chaque jour plus complexes et leurs conséquences plus difficiles à évaluer. À l’exception d’une minorité, la population de notre pays n’a pas l’impression de maîtriser les usages qui sont faits de la technologie, en particulier leur impact sur sa propre vie. Elle ne peut pas non plus avoir une vue d’ensemble qui lui permette de juger des décisions à prendre. Dans une démocratie, si le développement des sciences et des techniques est le fait d’une petite partie de la population, la gestion de leur utilisation doit être prise en charge par la totalité. Nous vivons actuellement une période de transition entre une gestion technocratique et même aristocratique des applications de la science, et une véritable gestion démocratique. Il faut faciliter cette transition. Pour cela, il faut que chaque individu puisse se familiariser avec chacun des éléments de notre civilisation technologique, et apprendre à se servir des plus importants d’entre eux.
Développer la créativité et l’innovation
Enfin, le monde traverse une crise économique grave qui engendre une compétition implacable entre les pays industrialisés. Jamais l’essor de notre pays n’a tellement dépendu de mobilisation de toutes ses ressources, et particulièrement de ses ressources humaines. Il est donc nécessaire de faire un effort accru pour développer la créativité et l’innovation, pour sensibiliser les jeunes générations à tout ce que les sciences et les techniques ont de passionnant et aussi de fondamental pour le développement de nos sociétés.
Contribuer à la promotion de notre industrie
Pareillement, il apparaît nécessaire désormais de pouvoir modifier rapidement l’image de la France à l’étranger, pour qu’elle puisse jouer un rôle plus dynamique encore dans les échanges industriels, essentiels pour notre économie ; celle-ci doit conquérir en particulier de nouveau de nouveaux débouchés au niveau des industries de pointe. Il faut démontrer que notre pays, sans abandonner ses traditions essentielles, est aussi devenu un pays moderne qui apporte sa contribution dans de nombreux domaines scientifiques et techniques avancés. Dans beaucoup de cas, il l’apporte de façon originale par rapport aux autres pays industrialisés. Il faut donc faire découvrir à nos partenaires, notamment à ceux qui sont en voie de développement, cette nouvelle image de la France qui veut réaliser un équilibre entre ses traditions, son art de vivre et l’appartenance à son siècle, ses qualités d’imagination, sa contribution à la découverte, au progrès technique et aux réalisations industrielles de qualité.
Réciproquement, d’ailleurs, il serait utile de faire connaître au public français ce qui se fait de plus intéressant à l’étranger afin de stimuler l’émulation dans les domaines les plus compétitifs.
Des besoins nouveaux pour lesquels les méthodes d’éducation traditionnelles sont insuffisantes.
Pour que l’ensemble des Français prenne conscience de ces nécessités et pour modifier l’image de notre pays, les méthodes traditionnelles sont insuffisantes. Il est nécessaire de créer, en particulier, des formes diversifiées d’éducation qui complètent celles de l’école et de l’université. Il est devenu indispensable que cette éducation se prolonge pendant toute la vie, et non pas seulement pendant une période limitée. Mais il faut également familiariser le plus grand nombre avec des domaines très variés de la connaissance à des niveaux différents. Il n’est pas question de former des hommes et des femmes universels, mais des individus qui, en plus de leur spécialité propre, aient des vues synthétiques relativement claires et simples sur des domaines essentiels pour leur vie personnelle et pour l’avenir du pays. On ressent donc le besoin de nouveaux types d’établissements très évolutifs, où seraient réalisées d’autres formes d’éducation, parallèle et complémentaires à celles de l’école, mais préservant la liberté de chacun, suscitant sa curiosité, son besoin de comprendre, et lui permettant de s’adapter à son environnement.
Au cours des vingt dernières années, de nombreux pays ont créé pour cela des centres scientifiques et techniques, que l’on a baptisés, faute d’un autre terme, du nom de « musée » mais qui se distinguent à de multiples égards des musées traditionnels. Ces centres ont dans l’ensemble un immense succès. Ceux qui ont su devenir modernes, actifs et vivants attirent trois à quatre fois plus de visiteurs que les muées traditionnels. Ils sont d’ailleurs en pleine expansion, se diversifient et inventent de nouvelles méthodes de présentation.
La France qui, par la création du Conservatoire national des arts et métiers à la fin du 18ème siècle, puis par celle du Palais de la découverte en 1937, avait fait figure de pionnier dans ce domaine, n’a pas maintenu son effort. Ces établissements n’ont pas été en mesure de se développer et se renouveler comme il aurait été nécessaire pour suivre l’évolution des besoins et pour se maintenir au niveau des progrès faits dans les autres pays. Il est certain qu’un vigoureux effort est nécessaire non seulement pour rattraper le retard qui, en matière de muséologie scientifique et technique, a été pris par notre pays, mais aussi pour répondre aux exigences nouvelles décrites plus haut. La nécessité de regrouper les deux domaines, celui de la science et celui de la technologie, complémentaires en eux-mêmes et liés de vue des objectifs aussi bien que les difficultés matérielles rencontrées par les centres existants, conduisent tout à la fois à rechercher un autre emplacement où pourrait être établi un Centre nouveau et à lui assigner des objectifs plus ambitieux en le dotant pour ce faire de moyens adaptés.
Rattraper notre retard en créant de nouvelles structures tenant compte du progrès des techniques et de l’évolution des idées.
Par ailleurs, l’époque présente est particulièrement favorable à la création d’un Centre qui, dans le domaine de la muséologie scientifique et technique, serait tout à fait novateur. En effet, les méthodes de communication audio-visuelles et informatiques ont fait et font encore des progrès foudroyants. Peu d’établissements étrangers ont eu la possibilité de prendre en compte cette évolution. D’autres part, la façon dont la science et la technique sont perçues par le public a elle aussi profondément changé au cours des dix dernières années. Les progrès scientifiques et techniques ne sont pas acceptés comme un bien en soi, mais seulement dans la mesure où leur impact sur la vie de chacun, sur la structure sociale et sur l’environnement sont bénéfiques. L’analyse de cet impact, qui devrait maintenant faire partie des présentations d’un tel Centre, est, ici encore, peu développée dans la plupart des musées étrangers qui ont été conçus à l’époque où l’on croyait au progrès indéfini de la technique et de l’économie et au mieux-être qu’il devrait naturellement contribuer à apporter.
Nous avons donc, si ces principes ambitieux sont retenus et si des moyens correspondants sont attribués au projet, la possibilité de bâtir le prototype d’une nouvelle génération de centres scientifiques et techniques, actifs, vivants et polyvalents.
Les objectifs
Les objectifs du projet considérés dans ce rapport découlent tout naturellement de l’analyse que nous venons de faire :
1) Aider le public à se familiariser avec le développement de la science et des applications techniques, à les comprendre, à les utiliser. Lui faire réaliser qu’il est acteur aussi bien qu’utilisateur et qu’une meilleure connaissance peut lui permettre de maîtriser la technique qu’il utilise dans sa vie quotidienne et qu’il gère dans sa vie de citoyen.
2) Encourager l’innovation, la créativité, l’esprit inventif technique dans le cadre réaliste ; familiariser le public avec la démarche scientifique, et développer son esprit critique
3) Améliorer l’image que le public se fait de la science et de l’industrie : montrer la place de la science et de la technique dans la culture et présenter dans un cadre approprié l’image de la France moderne à travers ses réalisations scientifiques, techniques et industrielles les plus intéressants.
4) Stimuler les vocations scientifiques et techniques dans la jeunesse, et familiariser celle-ci avec les aspects les plus intéressants du travail manuel.
5) Favoriser le renouvellement des méthodes d’enseignement des sciences et des techniques ; encourager la recherche de nouvelles méthodes.
6) Montrer que la science est une œuvre collective, non seulement nationale mais internationale, et permettre l’établissement de liens favorables à des nouvelles formes de coopération dans deux directions : avec nos partenaires industrialisés, européens ou non, dont la contribution dans les domaines scientifiques et techniques est une source d’élargissement et d’enrichissement ; avec les pays en voie de développement, à qui l’on doit proposer une vision plus complète et plus objective de ce que notre pays peut leur apporter.
Pour atteindre les objectifs qui viennent d’être énumérés, il faut que les présentations qui seront réalisées dans le Centre soient à la fois pédagogiques, intéressantes et diversifiées. Il faut que l’image que présente le Centre soit attrayante, sinon on aboutira à l’effet opposé à celui recherché. À cet égard, un résultat inférieur à ceux qui sont obtenus en Allemagne, en Grande Bretagne, ou même aux Pays-Bas, aurait un effet désastreux. Enfin, il est souhaitable, comme nous le verrons, que le centre ait en plus des fonctions multiples, pour pouvoir valoriser son capital.
Plan de ce rapport
Ce rapport comporte trois parties et un chapitre de conclusions et recommandations.
La première partie analyse les caractéristiques générales du projet. Elle étude en particulier la place de celui-ci par rapport aux autres musées scientifiques et techniques, l’approche pédagogique qui serait suivie et définit le type de public auquel il pourra s’adresser.
La deuxième partie est consacrée aux différentes fonctions du centre : les fonctions du type « Musée », c’est-à-dire les présentations quasi permanentes et les expositions temporaires ; les fonctions de valorisation du Musée, c’est-à-dire principalement celles qui sont liées à la formation et à l’information ; les fonctions de support enfin, c’est-à-dire les activités de recherche, les activités de production et les relations que le Centre devrait avoir avec l’extérieur, en particulier dans le cadre d’un réseau national.
La troisième partie décrit schématiquement les structures du Centre et la méthodologie de sa réalisation, ainsi que les caractéristiques essentielles du fonctionnement proposés.
PREMIÈRE PARTIE
LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET
UN NOUVEAU TYPE DE MUSÉE
La dénomination « Musée scientifique et technique » désigne souvent des établissements très différents, que l’on peut cependant regrouper en deux grandes catégories :
a) Ceux qui mettent l’accent sur l’histoire des sciences et des techniques, se rapprochant ainsi de la notion traditionnelle de musée. Ils se préoccupent avant tout de la conservation d’objets ayant une valeur d’authenticité et représentant un tournant particulièrement important dans l’évolution des sciences ou de la technologie. Ils s’efforcent d’être complets et peuvent, d’ailleurs, être tout à fait remarquable dans leur présentation (un bon exemple est le Deutsches museum à Munich).
Conservation…….
b) Ceux qui s’efforcent surtout de donner une image de la science et de la technologie actuelles, de montrer leurs réalisations essentielles, de les expliquer au public et de faire participer celui-ci aux démonstrations qui conduisent à une meilleure compréhension des principes sous-jacents. Pour ces établissements, l’histoire des sciences joue un rôle, mais seulement dans la mesure où elle permet d’éclairer le présent. Les objets authentiques, anciens ou non, sont considérés comme très importants mais sont intégrés dans un ensemble explicatif plus large. Des systèmes de démonstration sont construits spécialement pour le musée et conçus pour mettre en évidence, de façon simple pour un public non spécialisé une loi scientifique, les principes d’une technologie, la façon dont fonctionne une machine, etc.
…… où explication ?
Alors que, pendant la première moitié du vingtième siècle, on a surtout fait des musées du premier type, on a tendance maintenant à créer des établissements du second type qui ne prennent pas toujours d’ailleurs le non de musée. C’est que, comme on l’a vu, les besoins ont changé.
En France, le Musée des techniques ou Conservatoire national des arts et métiers serait plutôt un établissement du premier type qui, faute d’une politique de développement claire et soutenue, faute de moyens aussi, présente des lacunes importantes - à côté d’objets tout à fait remarquables - et laisse beaucoup à désirer dans la présentation de ses collections. Le Palais de la Découverte, créé en 1937 et donc très en avance par rapport au reste du monde, est un centre du second type, qui, ici encore, faute d’une continuité suffisante dans son développement, et ne disposant que de locaux et de moyens très insuffisants, n’a pas pu suivre le mouvement considérable qui s’est produit dans ce domaine depuis 1945. Il a cependant, sur le plan pédagogique, développé une approche originale d’explication des sciences fondamentales qu’il est souhaitable de conserver, tout en l’élargissant aux aspects techniques et aux applications industrielles.
En ce qui concerne le projet de La Villette, l’énoncé même de ses objectifs montre que c’est surtout un Centre du second type qu’il faut créer. Cependant, les surfaces disponibles devraient permettre de ne pas négliger l’approche historique, et d’intégrer avec discernement dans les présentations un certain nombre d’objets anciens d’une grande valeur historique qui permettraient de mieux comprendre le chemin qui a conduit au présent. Il importe, en effet, de ne pas montrer seulement les réalisations actuelles, mais aussi de mettre en évidence la démarche intellectuelle qui y a conduit. Ceci permet au visiteur attentif de faire jouer son imagination et constitue un moyen de stimuler la créativité et l’innovation.
Deux philosophies que le Musée de La Villette pourrait associer à travers une approche résolument novatrice.
Un nom à trouver
Le futur établissement de La Villette n’est donc pas destiné à être un musée au sens traditionnel du terme, d’autant plus qu’il conviendrait, comme nous le verrons, de lui adjoindre d’autres fonctions que celles de la simple présentation de collections. La question se pose donc de choisir une appellation qui donne une meilleure idée du rôle qu’il est destiné à jouer. C’est une question difficile à laquelle nous n’avons pas trouvé de réponse évidente. Le mieux serait peut-être de lui trouver un nom spécifique – comme l’Exploratorium de San Francisco ou l’Evoluon de Eindhoven – en y ajoutant une mention explicite qui pourrait être par exemple « Musée national des sciences et de l’industrie ».
Dans la suite de ce rapport, nous utilisons tantôt le mot « Musée », tantôt le mot « Centre », le premier désignant plus spécialement la partie dévolue aux expositions quais-permanentes, le second l’ensemble de l’établissement et de ses diverses activités.
Les présentations du Palais de la Découverte devraient pouvoir s’intégrer sans difficultés dans le futur Musée, car la différence entre lui et ce qu’il est proposé de créer à La Villette et moins une question de nature que de mode de présentation et de moyens, étant entendu que l’approche exclusivement scientifique devrait être très largement complétée par une plus grande ouverture vers la technologie et les réalisations industrielles.
La situation du Musée des techniques du CNAM est différente. Il est clair que le centre de La Villette aurait un grand intérêt à avoir accès à une collection historique assez complète d’objets techniques, afin de pouvoir intégrer selon les besoins et pour des périodes plus ou moins longues, certains de ces objets dans la présentation de ses thèmes. Cependant, la rénovation du Musée du CNAM pose un problème plus complexe qui demanderait à notre avis une étude sérieuse.
Un travail de recherche sur l’histoire de la technologie
Il y a certainement place en France pour un grand Musée d’histoire de la technologie, et les collections du CNAM pourraient en constituer le noyau. Cependant, beaucoup de recherches sont encore nécessaire dans ce domaine, si l’on veut identifier les étapes qui ont marqué, depuis le XVIIIe siècle, l’évolution de la technologie dans chacun des secteurs les plus importants, et incorporer les objets associés à ces mutations dans des ensembles explicatifs cohérents. Ce travail de recherche, qui nous paraît constituer un préalable à la définition d’une politique en la matière, pourrait être entrepris par le CNAM lui-même, où se trouve à l’heure actuelle une grande partie des compétences nécessaires, en liaison bien sûr avec le travail de conception qui sera par ailleurs pour la création du Centre de La Villette. D’autres part, un effort de présentation complète des aspects historiques de la technologie devrait nécessairement inclure beaucoup de ce qui existe en province, où se produit actuellement un mouvement extraordinaire d’intérêt pour la mise en valeur du patrimoine industriel. Ce problème est tout à fait passionnant et devrait être analysé de façon approfondie pendant les deux années 1980-81. Lorsqu’on sera en possession de cette analyse, il sera possible de prendre une décision réfléchie sur le type de relations qui pourraient exister entre le Musée des techniques du CNAM et celui de La Villette : intégration totale ou partielle, ou bien seulement collaboration étroite permettant un accès facile aux collections et l’échange d’éléments appartenant à celles-ci, en même temps que la réalisation en commun d’ensembles explicatifs. Ce travail se ferait en parallèle avec l’établissement du Réseau national, dont il sera question plus loin, à l’intérieur duquel l’ensemble devrait, de toutes manières, trouver sa place.
Un problème analogue, quoique moins difficile, est posé par les archives considérables et d’une grande valeur que possède l’Académie des sciences. Il semble que, là encore, des relations puissent s’établir qui permettraient au futur Centre d’avoir une bonne connaissance de ses archives, et d’y faire des emprunts pour les intégrer à certaines de ses présentations.
Il faut remarquer que, même si le parti pris pour La Villette est d’en faire un centre de présentation de la science et de la technique modernes, un problème de conservation se posera de toutes manières car la totalité des objets contemporains qu’il sera possible d’acquérir ne trouvera pas simultanément place dans les présentations quais-permanentes. D’autre part, le processus de renouvellement de ces présentations créera nécessairement une collection qu’il y aura lieu de conserver au moins en partie. Il faut donc prévoir dès le départ, à cet effet, un nombre suffisant de locaux en sous-sol, bien aménagés, permettant une conservation dans des conditions matérielles satisfaisantes et un accès facile pour le personnel et les chercheurs.
UNE APPROCHE ORIGINALE
LA NATURE DES PRÉSENTATIONS
Du point de vue du futur Musée, qu’est-ce que la science et la technologie modernes ? Il faut voir, en effet, que par nécessité, le renouvellement des présentations ne peut pas être très rapide. Il n’est pas question, par conséquent, de suivre autrement que par des expositions légères d’actualité, sur lesquelles nous reviendrons, les développements au jour le jour dans les domaines scientifiques et techniques.
L’état actuel des connaissances ?
Il existe, cependant, un « état actuel des connaissances » reconnu par l’ensemble des scientifiques, qui n’évolue globalement que relativement lentement. C’est cet état actuel qu’il faut essayer de reproduire en faisant en sorte qu’il ne soit jamais sérieusement en retard sur le progrès scientifique. De même, en matière de technologie, il faut s’efforcer de donner une idée de ce qui est en cours d’utilisation, même si une certaine hétérogénéité existe en la matière, des techniques un peu anciennes étant utilisées en même temps que d’autres plus avancées.
En pratique, une certaine souplesse est possible dans la mesure où de toutes manières il n’est pas question d’être encyclopédique. Il faut que les présentations donnent une idée équilibrée et bien représentative des aspects les plus importants de la science et de la technique. L’existence d’une composante historique et la possibilité de donner quelques éclairages sur des domaines d’avenir encore en formation permettent d’être toujours relativement en phase avec l’évolution scientifique et technique, sans pour cela introduire un bouleversement permanent du Musée.
Un double souci de vérité et d’objectivité
Il ne faut pas craindre, d’autre part, de donner au public une idée des débats scientifiques qui ont lieu en permanence avant qu’un consensus s’établisse, au moins provisoirement, sur une interprétation des phénomènes observés. La science est quelque chose d’humain et de vivant et l’on rapprocherait certainement des objectifs du Musée en aidant le public à en prendre conscience. De même, il existe un certain nombre de technologies qui font l’objet de controverses aussi bien en ce qui concerne leur efficacité ou leur rentabilité, que les conséquences qu’elles peuvent avoir sur l’environnement ou sur le mode de vie des individus. Il ne conviendrait évidemment pas de faire du Musée un forum permanent pour ces controverses. Mais, d’un autre côté, il serait un peu étrange que les présentations du Musée en fassent totalement abstraction. Beaucoup de prudence et de discernement seront nécessaire pour arriver à une présentation honnête et éclairante de ces problèmes. L’essentiel sera évidemment d’axer celle-ci sur l’exposé d’objectif des faits scientifiques et techniques, en laissant au public le soin d’en tirer ses propres conclusions. Dans certains cas, une approche pluraliste pourra être tentée, à condition que soit respectée l’honnêteté scientifique : pas de déformation, pas d’idées fausses. C’est ce critère qui devrait guider d’ailleurs l’ensemble des présentations, en particulier quand il s’agira d’expliquer au public de façon simplifiée des phénomènes complexes qu’il n’est pas possible d’analyser en totalité.
L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Une autre forme de pédagogie
Un Musée est quelque chose de très différent de l’école. Son approche est plus qualitative et fait appel à la fois au sens et au raisonnement. Il permet au public de doser lui-même le degré d’information qu’il souhaite acquérir en même temps qu’il lui donne une vision pluridisciplinaire plus conforme à la réalité. Il permet également une formation plus souple qui peut s’adapter aux circonstances et évoluer, puisse prête aussi à des approches étalées dans le temps et répétitives. Il crée une atmosphère de liberté et ne demande au visiteur qu’un engagement limité et variable d’un individu à l’autre. Enfin, par l’absence de compétitive et de récompense extérieures – la seule récompense étant l’enrichissement personnel procuré par la visite elle-même-, par la possibilité de faire participer le public aux démonstrations, il permet de développer l’initiative et l’imagination.
Autonomie, liberté, souplesse
On sait depuis longtemps que ces méthodes de formation sont plus efficaces que les méthodes traditionnelles. Malheureusement, elles peuvent difficilement être introduites dans un enseignement destiné à un grand nombre d’élèves, limité dans le temps, sanctionné par des examens et des diplômes et nécessairement très formalisé. Et pourtant, le besoin n’en a jamais été aussi grand qu’à notre époque où les domaines à étudier sont devenus de plus en plus complexes, où les individus ressentent, d’autre part, un besoin accru d’autonomie. C’est ce qui explique, à notre avis, l’importance prise par les musées scientifiques et techniques, et leur succès auprès d’un public de plus en plus large : ils fournissent, en effet, un correctif essentiel à un mode d’éducation contraignant et limité dans le temps.
Du complexe vers le simple
Cette analyse montre d’ailleurs quels sont les aspects qu’il est important de privilégier dans un centre comme celui de La Villette :
– Des niveaux de présentation souples et adaptés à des publics différents.
– Une approche pluridisciplinaire utilisant une démarche allant du complexe (la réalité du monde extérieur connue par le visiteur) vers le simple (le niveau d’explication analytique), alors que l’école emploie la démarche inverse, créant ainsi dès le départ un hiatus avec le monde extérieur.
– Une atmosphère de liberté et la possibilité pour le visiteur de participer activement à la recherche de l’explication.
Il faut également remarquer qu’un Musée peut compléter l’école de façon directe et d’une autre manière : il permet, en effet, de réaliser globalement un ensemble d’expériences relativement coûteuses qu’il ne serait pas possible de faire séparément dans le contexte scolaire. Le musée est donc aussi un moyen pour les enseignants de compléter la formation scolaire en l’illustrant de façon appropriée.
L’approche muséologique est différente de la vulgarisation
S’agissant d’un musée, nous ne pensons pas qu’on puisse parler de vulgarisation au sens où ce mot est employé quand on parle, par exemple, d’articles destinés au grand public. Il s’agit d’une approche différente : plus globale, plus qualitative, plus concrète, plus participative. Elle ne vise évidemment pas à informer des spécialistes, mais elle peut donner une connaissance pratique assez complète. Surtout, elle permet au visiteur, s’il le souhaite, de comprendre chacun des domaines abordés à un niveau suffisant et d’en retirer des notions synthétiques claires.
UN PUBLIC LARGE
Répondre aux besoins d’un public diversifié……
La plupart des musées, même si ce n’était pas leur intention initiale, ont été amenés à s’adresser surtout au public scolaire. Celui-ci est certes important et ne doit pas être négligé, mais il est évident que si l’on veut atteindre tous les objectifs énoncés, le Centre de La Villette devra s’adresser à un public plus large, comprenant aussi bien des jeunes que des adultes exerçant une activité professionnelle ou non, ou encore des personnes âgées qui pourront trouver dans le Centre un lien vivant avec le monde extérieur. La science et la technique influençant, comme on l’a dit, la vie de chacun, il n’est pas souhaitable de se limiter à un public ayant déjà une culture scientifique ou technique. Toutes les études qui ont été faites ont montré qu’un intérêt existe à presque tous les niveaux, mais que les méthodes d’approche doivent être différentes. On peut distinguer en fait dans le public trois sortes d’attitudes :
…en s’adressant à lui à des niveaux différents.
– Une attitude contemplative et passive : il s’agit alors de développer le niveau visuel au moyen d’objets particulièrement impressionnants, ou de phénomènes insolites conduisant à de fortes impressions ou bien à des chocs émotifs ou de nature esthétique. Ceci peut d’ailleurs déclencher chez ce type de visiteur une réflexion ou un intérêt plus actif.
– Une attitude éveillée, interactive, manuelle : il s’agit d’un type de public qui a besoin de faire, d’agir pour comprendre. Il faut alors développer le niveau actif et participatif.
– Enfin, une attitude motivée, exigeante, réfléchie : il faut pour y répondre développer le niveau de compréhension des phénomènes sous-jacents.
Voir, toucher, comprendre, ces trois modes d’approche doivent pouvoir dans tous les cas conduire le visiteur à une réflexion personnelle sur des sujets dont l’importance ou l’intérêt ne lui étaient pas apparus jusque-là.
Ces trois niveaux correspondent évidemment à des degrés de connaissances très différents. Il est important que, dans la « lecture » du Musée, ils soient simultanément présents, et que l’on puisse passer sans difficultés de l’un à l’autre. Ceci est possible à l’époque actuelle, grâce aux progrès réalisés dans le domaine audio-visuel et l’utilisation judicieuse des micro-ordinateurs.
Attirer un grand nombre de visiteurs
Au total, et sans être d’une ambition excessive, on peut prendre comme objectif pour le Centre un nombre annuel de visiteurs de l’ordre de trois millions, ce qui correspond à peu près à celui des visiteurs du Louvre. Parmi ces trois millions, on peut évaluer à 500 000 le chiffre des visites de groupes scolaires. Les visiteurs de province et les étrangers devraient être également assez nombreux, peut-être de l’ordre de 1 000 000. Un gros effort est nécessaire pour attirer les visiteurs étrangers, d’autant plus que l’un des objectifs du Centre est justement d’être une vitrine des réalisations françaises. En particulier, il serait souhaitable que les textes les plus importants qui accompagnent les présentations soient rédigés en plusieurs langues.
Penser aux catégories spécifiques : les étrangers, les handicapés, les jeunes
Une fréquentation annuelle de trois millions correspond à une moyenne journalière de 10 000 visiteurs. Ceci implique nécessairement des « pointes » qui peuvent atteindre facilement 20 000 le samedi et le dimanche. Compte tenu des surfaces disponibles, ces chiffres n’ont rien d’excessif, mais ils impliquent des contraintes du point de vue de la sécurité et des modes de circulation, dont il faudra tenir compte.
Il existe enfin une composante du public qu’il faut avoir à l’esprit dès la conception du Centre, en raison des contraintes qui s’en déduisent : il s’agit des handicapés, pour qui la visite du Musée scientifique et technique est source d’enrichissement et moyen de contact avec le monde extérieur.
La jeunesse
S’il est nécessaire de s’efforcer de viser un public aussi large que possible en variant le niveau auquel on s’adresse à lui, il faut accepter cependant l’idée que la jeunesse reste numériquement le public le plus important d’un musée (la plupart des musées étrangers indiquent un pourcentage de l’ordre de 60% dont la moitié environ constituée par les groupes scolaires sur lesquels nous reviendrons).
Il est donc important de garder à l’esprit ce phénomène lorsqu’on concevra le contenu du Musée, aussi bien sur le plan physique et matériel que sur celui de la présentation. Il faut, en particulier, penser aux enfants jeunes (entre 8 et 14 ans), que l’on peut, d’autre part, davantage familiariser avec le monde extérieur, et d’autres part, sensibiliser à certains aspects de la science et technique à une époque essentielle de leur développement.
Encourager l’intérêt pour la technologie
À partir de 14 ou 15 ans, et même avant, il existe chez beaucoup de jeunes un intérêt très vif pour la technologie. Le Centre de La Villette devrait être conçu pour être un pôle d’attraction de ce point de vue, en présentant de façon claire et active les technologies les plus appropriées. D’autre part, cet intérêt devrait être un moyen de capter l’attention du jeune public pour l’attirer vers des domaines plus difficiles. C’est ici que la possibilité de conjuguer les présentations scientifiques et les présentations techniques à l’intérieur d’un même thème apparaît particulièrement utile.
Réhabilité le travail manuel
Enfin, il faut voir que le Centre pourrait être un lieu privilégié pour familiariser la jeunesse avec le travail manuel, dont les différents aspects sont souvent très mal perçus par la jeunesse, ce qui explique en partie la désaffection dont il est l’objet et contre laquelle il faut lutter. Il serait donc souhaitable de montrer de façon concrète l’utilisation d’un certain nombre de techniques simples et compléter cette présentation par l’implantation sur le site d’ateliers d’artisans convenablement choisis.
D’autre part, les infrastructures qui sont la base du fonctionnement même du Centre (ateliers, imprimerie, salles de contrôle, studio de réalisations audio-visuelles, etc.) pourraient être conçues de façon à être, au moins partiellement, visibles par le public, ce qui accroîtrait le caractère vivant du Musée.
DEUXIÈME PARTIE
LES DIFFÉRENTES FONCTIONS
On peut diviser les fonctions proposées pour le Centre de La Villette en trois grandes catégories :
– Celles qui constituent l’activité principale du centre : ce sont les fonctions de type « Musée », qui sont réalisées par les présentations quasi-permanentes, et les expositions temporaires.
– Celles qui permettent de valoriser le capital constitué par le Musée : ce sont essentiellement les activités de formation et d’information.
– Celles enfin, qui doivent fournir le support indispensable aux activités du Musée : la recherche, la production et les réalisations extérieures.
I. LES FONCTIONS DE TYPE « MUSÉE »
Des présentations quasi-permanentes…….
Dans la conception du Musée de La Villette, on peut s’interroger sur la structure générale des expositions. Doit-on réserver une surface importante aux expositions quasi-permanentes, dont le renouvellement est relativement lent, entre 10 et 15 ans en moyenne, ou alors au contraire concevoir le bâtiment comme un ensemble de surface « à tout faire », permettant des actions considérées au coup par coup en fonction des besoins et de l’actualité ? Il nous semble que, pour un certain nombre de raisons, il est préférable de réserver d’abord une surface importante, entre 50 000 et 60000 m2 sur un total d’au moins 120 000 m2, à des présentations quasi-permanentes donnant une idée bien représentative mais non exhaustive de différents domaines couverts par la science et la technique actuelles, l’accent étant mis évidemment sur ceux auxquelles la France a apporté une contribution significative.
…pour des raisons de méthode,
La première est d’ordre pratique : comme nous l’avons vu, la méthodologie de présentation à des publics différents est chose difficile ; la conception de chaque exposition représente donc un gros effort qu’il n’est pas possible de recommencer à intervalles trop rapprochés, ou alors on prépare des présentations hâtives et superficielles qui n’atteignent pas l’objectif recherché.
…de coûts,
D’autre part, ces expositions sont coûteuses si l’on veut qu’elles soient compréhensibles et efficaces, et un renouvellement trop rapide impliquerait qu’il y ait dans le budget annuel courant du Centre, une part importante réservée aux nouveaux investissements (la plupart des musées étrangers ne réservent guère plus de 10% de leur budget annuel aux investissements de renouvellement).
…d’équilibre,
Il y a, cependant, une raison plus fondamentale : la présentation des sciences et des techniques doit être équilibrée entre disciplines d’une part, et entre la partie scientifique et la partie technologique d’autre part. En outre, il faut que suffisamment de domaines soient ouverts, de façon complète et équilibrée, sans qu’il soit nécessaire d’être exhaustif, pour que le musée donne au public une idée juste et représentative de la science et de la technique actuelles. De même, il est nécessaire de planifier le renouvellement de façon à ne pas créer de déséquilibre entre les parties anciennes et les parties nouvelles (c’est ce qui se passe, par exemple, au Musée de Chicago où seules ont été renouvelées les parties du Musée pour lesquelles un financement extérieur par l’industrie a pu être obtenu).
…complétées par des actions temporaires
Cependant, il est clair que des expositions quasi-permanentes n’en permettraient pas de remplir la totalité des objectifs assignés au Centre. Il est souhaitable de réserver en outre une partie des surfaces disponibles, de l’ordre de 15 000 à 20 000 m2, pour des « actions » et manifestations liées à l’actualité et décidée en fonction des besoins. Une partie importante de ces « actions », réalisées en collaboration avec l’industrie, devrait permettre en particulier de présenter les réalisations industrielles françaises les plus significatives au moment où cette présentation peut avoir le maximum d’impact.
A. LES PRÉSENTATIONS QUASI-PERMANENTES
La partie centrale du Musée de La Villette pourrait donc être constituée d’un ensemble d’expositions quasi-permanentes destinées à donner une idée équilibrée des sciences et des techniques modernes, et des activités industrielles avancées. Ceci ne doit pas être nécessairement fait de manière exhaustive, mais doit tout de même constituer un ensemble représentatif.
Intégrer étroitement la science et la technique dans des présentations thématiques pluridisciplinaires
D’autre part, nous pensons qu’il n’est pas souhaitable de séparer dans cet ensemble la science proprement dite, c’est-à-dire les résultats de la recherche, de ses applications techniques et industrielles. Celles-ci dérivent directement de l’activité scientifique et c’est ce lien qui doit être perçu par le visiteur. Il est d’ailleurs intéressant d’illustrer les mécanismes par lesquels ces applications naissent des découvertes scientifiques et les étapes qui conduisent de ces découvertes jusqu’à la production de l’industrie. En outre, il convient que le public comprenne directement et simplement comment, dans un domaine donné, les découvertes scientifiques et les applications technologiques engendrent des conséquences économiques et sociales importantes.
Enfin, il nous paraît préférable de ne pas diviser les présentations en catégories correspondant aux disciplines scientifiques traditionnelles (mathématiques, physiques, chimie, biologie, etc.) mais au contraire de rechercher un mode de présentation qui illustre bien le caractère pluridisciplinaire de la plupart des activités scientifiques actuelles. Nous proposons donc d’adopter, pour cette partie du Musée, une approche thématique intégrée. C’est cette approche, qui constitue l’un des éléments principaux de nos propositions, que nous allons maintenant analyser.
1. L’approche thématique
La réalité, connue et vécue, point de départ d’une démarche plus approfondie
Le cadre du Musée, nous l’avons vu, ne doit pas être scolaire. Il est important de partir, pour atteindre le visiteur, de la réalité qui lui est familière, qui est liée à son expérience quotidienne, et donc de définir une division des présentations dont la signification soit immédiatement perceptible par lui. Par exemple, au lieu de parler de physique ou de biologie, on organisera les présentations sur des thèmes comme « la lumière », les « sons », « le corps humain », etc. Ceci ne veut pas dire, cependant, qu’il faille se contenter d’une présentation superficielle et appréhensible de façon immédiate. Une fois le point de départ acquis, il doit être possible de traiter le domaine correspondant à une thème donné de façon assez complète, c’est-à-dire aussi bien du point de vue de ses aspects historiques (en illustrant, en particulier, le rôle joué par les grands savants et les grands inventeurs) que de son contenu scientifique, de ses applications technologiques et industrielles, du rôle que les concepts liés au thème et les résultats de ces applications jouent dans la vie individuelle ou collective.
Guider le visiteur par une topologie appropriée sans entraver sa liberté.
Pour cela, le traitement d’un thème nécessitera un ensemble de présentations distinctes, dont chacune illustrera une partie du sujet traité. Pour pouvoir toucher des publics différents ou répondre à des demandes multiples suivant les préoccupations de chaque visiteur, il faut que le « volume thématique », c’est-à-dire l’ensemble des salles ou le thème est traité, puisse être organisé de façon à ce que des types de visites différents soient possibles. C’est dire que, si le choix des éléments du thème est capital, l’organisation topologique et les schémas de circulation ne le sont pas moins. On peut penser à des schémas différents d’organisation et il est probable que, suivant la nature des thèmes et selon les moyens choisis pour les illustrer, chacun de ces schémas sera plus ou moins adapté. Nous donnons, en annexe, en même temps qu’une analyse détaillée de certains thèmes, quelques exemples de schémas d’organisation auxquels on peut penser. L’idée commune est de créer d’abord un circuit de visite simplifiée et très « visuelle » autour duquel s’organisent des éléments plus spécialisés permettant d’entrer plus profondément dans quelques-uns parmi les sujets abordés. L’important est de préserver, cependant, la liberté du visiteur, qui doit émouvoir aller vers ce qui l’attire ou l’intéresse, sans pour cela créer un amalgame confus dont le plan n’apparaîtrait pas clairement. Il faut arriver, et la simulation que nous avons faite pour quelques thèmes particuliers montre que c’est chose possible, à ce que le visiteur puisse choisir ce qu’il veut regarder ou comprendre, tout en ayant à chaque instant une bonne idée de la place occupée par ce qui a retenu son attention par rapport à l’ensemble du thème.
Un effort important devra être fait pour informer le public, dès l’entrée du Musée, sur la topologie de celui-ci et sur la spécialisation des thèmes. Des plans situés de manière judicieuse dans tout le bâtiment rappelleront au visiteur l’endroit exact où il se trouve. Des consoles rattachées à des micro-ordinateurs lui permettront de rechercher les renseignements complémentaires qui lui manqueraient pour se faire une idée d’ensemble, indépendamment de la salle thématique qu’il est en train de visiter.
Des ensembles explicatifs...
Le lecteur qui se fait d’un Musée scientifique et technique l’image conforme à la tradition aura sans doute des difficultés à comprendre la véritable nature de ce qui constitue un thème. Il ne peut s’agir, en effet, d’une série d’objets étiquetés et exposés dans des vitrines, illustrant par exemple les étapes d’une technologie donnée. Cette présentation ennuyeuse et peu éclairante est maintenant abandonnée partout. Les objets, anciens et modernes, sont importants et il faut qu’il y en ait, mais ils doivent être intégrés judicieusement dans « un ensemble explicatif ». Ce dernier peut, suivant les cas, être constitué de plusieurs éléments choisis parmi la liste suivante (qui n’est d’ailleurs pas exhaustive) :
…utilisant des méthodes de communication multiples et participatives.
– Des panneaux contenant des textes dont le caractère et la disposition peuvent correspondent à des niveaux différents d’explication. Il faut apporter un soin extrême apporter un soin extrême au contenu et à la présentation de ces textes qui peuvent complètement manquer leur but s’ils sont trop longs, si les caractères ne se distinguent pas de façon attrayante, et s’ils renferment des termes trop techniques dont l’explication n’est pas donnée ou bien est trop difficile à comprendre. D’une manière générale d’ailleurs, il faut limiter l’usage de l’écriture. Elle est indispensable, certes, car on n’a rien trouvé de mieux jusqu’ici pour faire passer rapidement un message simple, mais elle finit à la longue par lasser le visiteur et lui donner, s’il ne lit pas tous les textes, un sentiment de culpabilité.
– Des présentations audio-visuelles qui peuvent être composées soit de succession de diapositives, soit d’une séquence plus attrayantes mais elles sont coûteuses et fragiles. Elles peuvent être présentées de façon permanente, avec un commentaire parlé, ou bien au contraire être « commandées » par le visiteur.
– Des ensembles animés qui peuvent être, par exemple, des objets techniques ou des expériences scientifiques authentiques en état de marche. La mise en route de ces ensembles peut être commandée par le visiteur avec, bien entendu, un complément d’explications audio-visuelles ou écrites. En pratique, ce système n’est possible que pour des objets ou des expériences simples. La plupart des éléments authentiques de l’activité scientifique et technique sont devenus de nos jours trop complexes pour que leur fonctionnement ou leur signification puissent être aisément perçus dans leur totalité par le public non spécialisé.
– Des ensembles ou des maquettes conçus et exécutes spécialement pour la présentation dans le Musée, destinés justement à illustrer de façon schématique un ou deux concepts simples qui sous-tendent une loi scientifique ou le fonctionnement d’une technologie moderne. C’est la plus ou moins grande richesse de ces ensembles, leur originalité, la réflexion plus ou moins approfondie qui a permis de les concevoir qui constituent le caractère distinctif d’un Musée scientifique moderne. Ce sont les éléments essentiels d’un thème et nous donnons quelques exemples en annexe.
Intégrer le visiteur dans la présentation
Ces ensembles et maquettes demandent, comme nous l’avons dit, énormément de réflexion et d’originalité de la part des concepteurs pour atteindre leur but, qui est de faire comprendre simplement et de façon analytique un phénomène qui, s’il était présenté tel quel, serait plus complexe. Dans la plupart des cas, cette compréhension est obtenue grâce à la participation du visiteur, qui doit pouvoir effectuer les gestes qui lui sont expliqués, et réagir à certains stimuli incorporés ; il doit pouvoir également répondre à des questions. C’est cette intégration du visiteur dans la présentation qui est la partie la plus efficace du procédé. L’inconvénient est que les ensembles dont nous parlons doivent être réalisés de façon extrêmement solide pour pouvoir subir sans trop de dommage la manipulation par un grand nombre de personnes pendant des périodes longues. Leur entretien est chose absorbante et leur coût intervient pour une part non négligeable dans la réalisation du Musée. Mais, s’il doit en être fait un usage judicieux, il paraît difficile de s’en passer, compte tenu des objectifs que nous avons énoncés.
Quelques éléments très spectaculaires
Parmi les éléments composants les thèmes, il faudra s’efforcer de réunir, dans certaines salles du Musée, quelques ensembles très spectaculaires qui constitueront en quelque sorte la « carte de visite » du Centre. Ce sont les éléments dont on parle, qu’on vient voir, qui ne sont visibles nulle part ailleurs. Tous les musées étrangers importants proposent, chacun à sa manière, des pôles d’attraction de ce genre qui font naturellement beaucoup pour leur succès.
D’autre part, un effort de réflexion sera nécessaire pour déterminer la manière dont seront présentés, à l’intérieur des thèmes, les produits de l’industrie et leur évolution dans le temps. Pour que le résultat soit à la fois attrayant et éclairants, il faut résoudre des problèmes de choix et de mode de présentation ainsi que des problèmes pratiques, car les dimensions des éléments les plus significatifs de l’activité industrielle sont, dans beaucoup de cas, mal adaptés et à l’approche muséologique. On peut espérer néanmoins que certains e ces produits parmi les plus grands pourront prendre place au Musée. Le parc pourra, par ailleurs, offrir des possibilités d’exposition, au moins temporaire, pour ceux qui n’auraient pas pu, pour des raisons pratiques, être inclus dans le bâtiment principal.
Une ouverture sur le monde de demain
Enfin, on ne se contentera pas dans certains des thèmes de montrer l’état actuel de la science et de l’industrie : il faudra s’efforcer de créer des ouvertures vers le monde de demain, en montrant, en particulier au visiteur comment le choix technologique d’aujourd’hui conduisent à différents types d’avenir possibles.
Les thèmes peuvent être illustrés de façon plus ou moins complète. On peut, s’agissant du Centre de La Villette, s’interroger sur la surface occupée par chacun d’entre eux. Celle-ci est destinée à varier, bien entendu, d’un thème à l’autre, mais il conviendrait de veiller à ce que les thèmes ne soient pas étendus, au risque pour le visiteur de se sentir perdu dans un ensemble trop vaste et trop détaillé. A priori, une surface de l’ordre de 1000 à 2000 m2 par thème paraîtrait raisonnable. L’important est que l’ensemble forme un tout cohérent et conduise le visiteur à quelques idées synthétiques simples.
2. Sa mise en œuvre
4) Les liaisons entre les thèmes
Retrouver les éléments unificateurs de la représentation scientifique du monde.
L’approche thématique est sans doute celle qui permet d’intéresser le plus grand nombre de visiteurs, en raison de la simplicité du point de départ et de la souplesse qu’elle permet de conserver dans l’exposition. Elle comporte, cependant, quelques inconvénients. D’une part, le public scolaire, habitué à une approche à une approche disciplinaire traditionnelle, risque d’être dérouté s’il la retrouve éclatée entre plusieurs thèmes. D’autre part, et c’est plus important, les thèmes pris isolement ne permettent pas de faire appréhender facilement un certain nombre d’éléments unificateurs fondamentaux qui sont à la base de la compréhension scientifique.
L’approche thématique risque donc de ne pas donner au visiteur une vision correcte de l’étende de la synthèse que constitue la représentation scientifique du monde. Il risque de ne pas percevoir des constantes qui apparaissent dans différents domaines pluridisciplinaires : par exemple, les transformations de l’énergie, les structures, la régulation des systèmes, le traitement de l’information, etc.
Ces inconvénients ne sont pas cependant de nature à remettre en cause notre proposition d’une approche thématique. Un parti pris unificateur ne toucherait qu’un public limité : il convient de donner la priorité à la possibilité de toucher un public très large. D’autre part, on peut remédier aux inconvénients décrits ci-dessous de deux manières :
– par la topologie, qui permet d’établir des liaisons entres les thèmes aux nœuds qui correspondent à des relations entre eux (voir les exemples donnés en Annexe) ;
– par l’introduction de thèmes « horizontaux » qui recouvrent et unifient plusieurs thèmes.
Il faut remarquer que la topologie et le schéma de circulation sont dans un Musée choses très importantes et qui devraient retenir toute l’attention des réalisations de la partie quasi-permanente. Ils permettent, en effet, non seulement de faire apparaître les liens qui existent entre les thèmes, mais également de visiter le musée à des niveaux variables correspondant aux intérêts des différents publics que nous avons analysés. Cependant, il faut veiller à ce que les schémas de circulation ne soient jamais contraignants car il faut préserver la liberté du visiteur, faute de quoi le Musée perd rapidement tout attrait pour lui.
b) Les thèmes horizontaux
Des thèmes unificateurs consacrés à quelques grands problèmes contemporains
Comme nous l’avons dit, il existe des concepts unificateurs fort importants qui ne peuvent être traités correctement à l’intérieur des thèmes dont il a été question jusqu’ici. Il convient donc de ne pas être systématique et d’essayer de résoudre ce problème en consacrant des surfaces, convenablement situées, à un regroupement de certaines composantes communes à plusieurs thèmes. Il n’y aurait, cependant, pas du tout de duplication : pour illustrer un thème, il faut, comme nous l’avons dit, un grand nombre d’éléments. Certains de ceux-ci, convenablement choisis, se trouveraient dans les ensembles horizontaux au lieu d’être dans les thèmes verticaux proprement dits. Si on prend, par exemple, le cas de l’énergie, il est possible de décrire les différentes sources d’énergie à l’intérieur des thèmes : les énergies fossiles apparaissent avec « la terre », l’énergie nucléaire avec « l’atome », l’énergie solaire avec « la lumière », etc. Mais une fois qu’on a présenté ses différentes sources, on est loin d’avoir traité véritablement le problème de l’énergie : les transformations, la mesure, les économies d’énergie, les conséquences économiques et internationales, etc. étant donné l’importance de ces différents aspects, il convient donc d’établir un thème horizontal qui permette de les aborder.
D’autres thèmes horizontaux sont envisageables : la liste devra en être arrêtée plus tard, et même probablement en cours de développement du Musée. Donnons cependant quelques exemples :
– L’industrie et le travail humain : ici encore, les produits de la technologie apparaissent tout naturellement avec les thèmes. Mais quand on a vu ces produits, on est encore loin de se faire une idée exacte de qu’est l’entreprise industrielle, ses méthodes de production, les problèmes économiques, techniques, sociaux qu’elle a à résoudre. Il faut également montrer que le travail industriel peut offrir, s’il est conçu à l’échelle humaine, des possibilités d’autonomie, d’accomplissement et de dépassement de soi ; expliquer aussi tous les changements que le développement accru de l’automatisation apporte dans l’industrie au niveau des structures, de la formation et de l’emploi. Nous pensons donc qu’il y aurait intérêt à essayer de présenter ces aspects dans un thème unificateur, à la réalisation duquel l’industrie devrait d’ailleurs être étroitement associée.
– L’impact de la science et de la technique sur l’environnement et sur la société, qu’il serait important d’analyser d’une manière unifiée, car ceci conduirait sans doute à une attitude plus objective de la part du public qui réagit souvent aux conséquences partielles d’une technologie donnée. On doit pouvoir lui montrer, en particulier, que c’est dans la plupart des cas par un développement accru de la science et de ses applications que l’on pourra combattre les effets négatifs qui peuvent apparaître sur l’environnement.
– L’information, enfin, dont le traitement constitue une approche unificatrice dans la plupart des sciences et des techniques, et à propos duquel le Musée devrait prendre une valeur d’exemple.
c) L’arrangement des thèmes
De grandes sections reliées par des thèmes « charnières »
Si l’on convient d’appeler thème un sujet comme « la lumière » ou « les sons », couvrant comme nous l’avons dit, de 1000 à 2000 m2, il apparaît que l’ensemble du Musée devrait en comporter un assez grand nombre. Il faut, cependant, éviter que ces thèmes constituent un ensemble trop dispersé où le public se sentirait perdu. D’autre part, l’étendue même des surfaces fait qu’il sera difficile à un visiteur de voir vraiment tout le Musée en une seule fois. La structure générale du Musée doit par conséquent être bien apparente pour que le visiteur puisse facilement choisir ce qu’il souhaite plus particulièrement regarder. Il paraît donc souhaitable de regrouper les thèmes en quelques thèmes « charnières ». Il est sans doute prématuré de choisir ces sections dès maintenant de façon définitive : des discussions approfondies devront encore avoir lieu auparavant. Cependant, les quatre grandes sections suivantes paraissent assez naturelles (nous avons indiqué entre parenthèses l’ordre de grandeur approximatif des surfaces qui pourraient leur être consacrées :
– L’univers (environ 9 000 m2)
– La vie (environ 10 000 m2)
– La matière et la technique (environ 15 000 m2)
– Les sociétés humaines (environ 6 000 m2)
– Les thèmes horizontaux occupant eux-mêmes environ 10 000 m2
À l’intérieur de chacune de ces sections, qui pourraient être clairement individualisées, prendraient place les thèmes proprement dits (voir Annexe), dont il faut rappeler qu’ils recouvrent eux-mêmes à la fois les aspects scientifiques, techniques et industriels. Par ailleurs, certains thèmes se trouveraient tout naturellement à la frontière de ces grandes sections et pourraient donc constituer des transitions. Par exemple, l’Eau pourrait être un thème charnière entre la Vie et l’Univers, le Temps assurer la transition entre l’Univers et la Matière et la Technique, la Communication constituer une liaison entre la Matière et la technique d’une part, et les Sociétés humaines d’autre part, etc. nous avons présenté sur la figure 1 un essai de disposition logique, mais non spatiale, d’arrangement entre les thèmes à l’intérieur des quatre grandes sections ci-dessous.
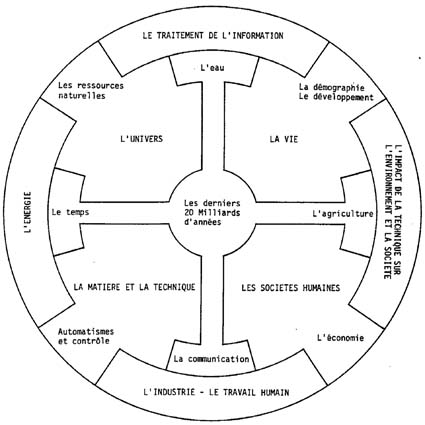
B. LES ACTIONS DE NATURE TEMPORAIRE
Un musée qui vit avec son temps et son environnement.
Nous n’avons pas conçu le projet de La Villette comme devant constituer une enveloppe souple destinée uniquement à abriter des activités liées à l’actualité. Dans notre esprit, l’ensemble des présentations quai-permanentes, ce que nous avons appelée « le Musée », constitue une pièce maîtresse du dispositif. Cependant, il ne saurait suffire si d’une part, on veut atteindre tous les objectifs ‘en particulier, celui d’être une « vitrine » des réalisations françaises les plus importantes), si d’autre part, on veut que le Centre soit quelque chose qui vit, qui évolue avec son temps, qui réagit aux besoins nouveaux et aux problèmes posés par l’actualité. Si ce Centre veut pouvoir jouer pleinement son rôle, il doit donc être véritablement intégré dans le tissu technico-économique du pays. Par ailleurs, ce deuxième type d’action peut renforcer la fonction « Musée », dans la mesure où l’on peut profiter de l’intérêt provoqué par l’actualité pour attirer le public à l’occasion d’événements particuliers. Réciproquement, la présence du Musée constituerait un environnement exceptionnel pour nombre des activités qu’il est possible d’envisager.
Les actions auxquelles on peut penser sont assez nombreuses. Nous avons isolé quatre particulièrement importantes, qui couvriront sans doute l’essentiel des activités de l’établissement qui seraient tournées vers l’extérieur, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, car il est probable que des besoins nouveaux seront susceptibles d’apparaître par la suite. Ce sont :
– Les actions menées avec l’industrie
– Les expositions temporaires et les salles d’actualité
– Les actions destinées à expliquer les processus de la recherche et de la technologie
– Les actions de rayonnement.
Nous dirons quelques mots de chacun de ces quatre types.
1. Les actions menées avec l’industrie et les grands établissements publics
– Des actions de promotion à moyen et long terme…
Ces actions peuvent avoir pour but, par exemple, de sensibiliser le public à des problèmes liés à l’actualité, ou bien de promouvoir un certain type d’activité ou de production, ou bien encore de présenter à l’occasion d’un événement extérieur ou d’une date particulièrement significative, l’ensemble du secteur technologique ou industriel. On, peut sans doute, imaginer pour elles d’autres objectifs, leur caractéristique essentielle étant que le centre leur fournit un instrument, par ses surfaces disponibles, par ses moyens de production et de réalisation, par la valorisation, enfin, que procure l’environnement de ses présentations quai-permanentes. Les actions dont nous parlons doivent se distinguer, cependant, de manifestations dont la fonction serait purement commerciale, de type « foire d’exposition », qui n’auraient sans doute pas leur place à La Villette. Il doit s’agir, en effet :
– De présentations approfondies, abordant sérieusement et de manière assez large un problème donné ;
– De manifestation s’étendant, en général, sur une durée assez longue (de quelques mois à deux ou trois ans) ;
– D’actions enfin, d’où le mercantilisme serait banni (elles ne devraient pas, en particulier, donner lieu à des ventes sur place).
…menées en liaison étroite avec l’industrie et les grands établissements publics…
Il nous semble, en effet, que l’industrie et les grands établissements publics peuvent avoir besoin, à côté de leur promotion commerciale habituelle, d’actions à moyen et long terme destinées à favoriser des évolutions dans les habitudes du public, dans la façon d’aborder une certaine forme de production, ou encore dans la manière dont certain type d’activité industrielle est perçu par le pays ou par l’étranger. On peut aussi imaginer des manifestations à base scientifique et technique destinées à accompagner des campagnes d’intérêt général, liées à la santé publique ou à la diététique par exemple.
Les partenaires du centre pour ces actions pourraient être :
– Soit des établissements industriels individualisés ;
– Soit des groupements industriels (fédérations, syndicats, chambre de commerce et d’industrie) ;
– Soit enfin, des organismes dépendant directement de l’État.
Dans beaucoup de musée étrangers, l’industrie est invitée à financer directement l’élaboration des expositions quasi-permanentes (l’exemple le plus frappant est fourni par le Musée des sciences et de l’industrie de Chicago). Le Musée lui-même a peu ou même pas du tout de moyens indépendants pour créer ou renouveler ses expositions. Il en résulte deux inconvénients majeurs, qui ont été mis en lumière aux États-Unis dans un rapport récemment :
– Il s’introduit des distorsions dans la présentation, dans la mesure où seuls les secteurs pour lesquels un financement a été obtenu sont convenablement présentés ;
– La présentation de la science et de la technique est étroitement commerciale, ce qui ne donne pas une vue suffisamment impartiale de l’activité scientifique et industrielle.
…. sans créer de déséquilibre préjudiciable au Musée.
La présence dans le Musée de La Villette d’un important secteur quasi-permanent supprime très largement ces difficultés. L’industrie et les Établissement publics devraient évidemment être étroitement associés à la réalisation de celui-ci, mais la conception d’ensemble, les équilibres, les messages incorporés doivent procéder d’une vision dégagée de préoccupations commerciales. C’est la présence de ce secteur qui permet, par contraste, une grande liberté dans les actions de type industriel qui existeront à côté et qui probablement ne devraient pas couvrir plus de 15 000 à 20 000 m2, soit au maximum le tiers de la partie quasi-permanente. Le caractère limité dans le temps de ces actions, même si elles doivent dans certains cas s’étendre sur plusieurs années, réduit également les risques de déséquilibre dans les présentations.
Des critères à respecter
En ce qui concerne le financement, sur lequel nous reviendrons par ailleurs, il est clair que l’essentiel devrait être fourni par les commanditaires, ce qui contraste dans notre esprit avec le financement des présentations quasi-permanentes dont une part importante devrait provenir de l’État. La réalisation pourrait dans la plupart des cas être assurée par le Centre, dans la mesure où celui-ci disposera de moyens qui permettraient une réduction des coûts, mais en étroite association avec les organismes « clients ». Ceux-ci pourraient, cependant, s’ils le désiraient, réaliser ou faire réaliser eux-mêmes tout ou partie des éléments qui constituent la présentation d’ensemble. De toutes manières, un certain nombre de critères devraient être respectés et en particulier :
– Un critère d’homogénéité avec le reste du Musée, assurant la qualité de la présentation et la clarté pédagogique des explications ;
– Un critère d’objectivité, afin que l’action ne soit pas perçue comme directement au service d’intérêts particuliers conduisant à certaines déformations ;
– Un critère assurant que les présentations ne sont pas trop commerciales, évitant en particulier une publicité trop directe pour telle firme ou tel produit.
Ces critères, il nous semble, sont parfaitement compatibles avec l’objectif utilitaire qui peut être celui de l’organisme client dans la mesure où il s’agit essentiellement d’une action en profondeur et à moyen terme. Ils devraient naturellement être précisés et élaborés par la suite. Leur application, dans chaque cas, devrait pouvoir être contrôlée par le Conseil de l’établissement où l’industrie sera représentée.
Le centre devrait conserver la possibilité de prendre en fin de compte une décision sur l’opportunité d’une action et sur son contenu. Ceci devrait être le cas, en particulier, pour les actions entreprises avec les industries étrangères, ou avec les filiales françaises d’industrie étrangères, vis-à-vis desquelles une certaine prudence est nécessaire, sans qu’une règle générale puisse être établie.
Malgré les contraintes nécessaires qu’ils imposeront, les actions que nous envisageons ici resteraient, il nous semble, très attrayantes pour l’industrie ou les Grands établissements publics dans la mesure où elles bénéficieraient de l’environnement du Musée et du Parc et constitueraient une forme de présentation qui n’a pas d’équivalent en France à l’heure actuelle. Leur réalisation devrait, dans chaque cas, faire l’objet d’une convention ou d’un contrat entre le Centre et l’organisme client.
Les trois niveaux de la participation de l’industrie
Pour terminer, et pour que les choses soient bien claires, nous voudrions expliquer que l’industrie devrait, dans notre esprit, intervenir à trois niveaux différents dans le Centre de la Villette :
– Par une participation aux activités de l’établissement lui-même, à son Conseil et à sa politique générale.
– En s’associant étroitement à la réalisation de la partie quasi-permanente du Musée par l’intermédiaire de ses hommes ; ou par des prestations en nature (objets, éléments de présentation, etc.)
– Par les actions industrielles dont nous venons de parler
Un moyen de valorisation des services techniques du Musée
Le but principal de ces dernières n’est pas d’obtenir des revenus destinés à faire vivre le Musée, mais surtout d’enrichir le potentiel d’influence de l’Établissement et d’utiliser au mieux son capital. Cependant, leur réalisation devra être plus ou moins autofinancée, le Musée s’efforçant, par l’utilisation de ses moyens techniques propres, de rendre ces actions suffisamment rentables pour les utilisateurs. Celles-ci constituent donc un moyen de valorisation des services techniques du Musée et des occasions d’étendre leur expérience dans des domaines nouveaux. Elles ne devraient pas, cependant, dans leur réalisation être une charge insupportable pour le personnel de l’Établissement. Il y aurait donc peut-être intérêt à créer une Société filiale de l’établissement chargée des relations avec l’industrie.
2. Les expositions temporaires et les salles d’actualité
Le musée, dans ses expositions quasi-permanentes, évolue nécessairement lentement, pour les raisons que nous avons déjà données. Cependant, il doit pouvoir suivre l’actualité, pour deux raisons :
– Il doit, d’une part, conserver un caractère vivant, moderne, intégré à l’évolution scientifique et technique du monde ;
– D’autre part, l’actualité fournit des événements qui permettent d’attirer le public vers le Musée.
Les manifestations sur des thèmes d’actualité
Cette fonction peut être réalisée de deux manières :
a) Par des expositions temporaires de caractère scientifique ou technique liées soit à des thèmes importants non couverts complètement par la partie quasi-permanente (donc complètement à celle-ci), soit à des événements d’actualité (par exemple, pour parler de 1979, le centenaire de la naissance d’Einstein ou celui de la lampe électrique à incandescence d’Edison). Il ne faut pas confondre ces expositions temporaires avec les actions de type industriel décrites plus haut car elles seront réalisées à l’initiative du Musée lui-même et financées principalement par lui, ce qui n’empêche pas évidemment de faire appel à des partenaires convenablement choisis pour la réalisation, en particulier au niveau de la collecte d’objets.
Une fois les expositions temporaires terminées, certains de leurs éléments pourront éventuellement fournir matière à enrichissement des thèmes quasi permanents.
Le « vient de paraître » de la science et de la technique
b) Par la création de « salles d’actualité » situées dans la partie la plus accessible du Musée permettant de rendre compte rapidement des nouveautés scientifiques et techniques. Il pourrait s’agir, par exemple, de la dernière découverte importante en biologie ou en physique, des derniers Prix Nobel, d’une opération chirurgicale spectaculaire, d’une mission, d’une émission spatiale récente pour l’exploration du système solaire, etc. il peut s’agir aussi de nouveaux systèmes techniques ou industriels non encore accessible au public : visiophones, micro-ordinateurs particulièrement perfectionnés, applications de la télématique, dispositif de sondage humain par ultrasons, etc. Il faudrait pour cela disposer de panneaux relativement légers et assez bien présentés, et objets en état de marche dont la démonstration peut être faite sur place, de façon à ce que le public puisse venir voir fonctionner les nouveautés techniques dont il a entendu parlé mais qui ne seront disponibles dans la vie courante que plus tard.
L’important est que ces présentations puissent être réalisées rapidement. Chaque fois que c’est possible, les quelques mois où tel ou tel élément sera présent dans une salle d’actualité devraient permettre, par un travail plus approfondi, son intégration ultérieure dans l’un des thèmes de la partie quasi-permanente du Musée. Cependant, il nous semble que la réalisation de ces salles d’actualité devrait être confiée au service en charge des informations scientifiques, celui-ci pouvant évidemment faire appel aux services de production pour leur réalisation ; ceci afin de faire bénéficier les salles d’actualité des sources d’information les plus récentes et de leur conserver une certaine rapidité d’action.
3. La science telle qu’elle se fait
La présentation des résultats de la science ne suffit pas. Dans la plupart des cas, le public ignore la façon dont ils ont été obtenus. Il faut s’efforcer de lui montrer comment la recherche se fait effectivement. D’autre part, un contact direct entre les scientifiques et le public est chose très souhaitable, bénéfique pour les deux parties ; les scientifiques ressentent en effet de plus en plus le besoin de fournir eux-mêmes des informations sur la nature de leurs recherches et sur leurs conséquences.
Faute de pouvoir ouvrir au public un laboratoire en activité, on peut essayer de s’inspirer d’expériences tentées au cours des dix dernières années à l’occasion des Conférences internationales qui se sont tenues en France et qui ont eu un très grand succès.
Opérations portes ouvertes
À intervalles réguliers, par exemple tous les deux ou trois mois, on demanderait à un groupe de chercheurs de venir au Centre avec leur matériel et leurs résultats et les présenter pendant deux ou trois jours au public. Les disciplines varieraient évidemment d’une fois à l’autre, chaque type de recherche ne revenant au Musée que tous les deux ou trois ans. Ces présentations seraient considérées comme des événements auxquels les médias seraient associés, et on leur adjoindrait des conférences et des débats publics sur les problèmes d’actualité liés à la discipline concernée (les manipulations génétiques s’il s’agit de la biologie moléculaire, la production d’électricité solaire, s’il s’agit de physique du solide, etc.)
Conférences, entretiens et débats
Une autre formule, peut-être plus adapté à certaines disciplines, pourrait consister à installer dans le Centre un type donné de matériel pendant deux ou trois mois, les démonstrations par les scientifiques ayant lieu par exemple un jour par semaine.
De ce genre d’activité, on peut rapprocher des actions plus légères liées aux événements : par exemple, la présentation et la signature d’un livre par ses auteurs, l’organisation de tables rondes sur le sujet de ce livre, etc. De ce point de vue, il est important que le Centre puisse rester ouvert le soir au moins jusqu’à 21 heures.
4. Actions de rayonnement du Centre
Le centre de la Villette ne saurait être conçu comme un projet purement parisien. Son action devrait pouvoir s’étendre de diverses matières à l’ensemble du territoire national. D’autre part, comme nous le verrons, il devrait être l’élément pilote d’un Réseau national en voie de constitution.
Les expositions itinérantes
Parmi les actions de rayonnement du Centre lui-même, nous pensons d’abord naturellement aux expositions temporaires organisées dans le Musée et qui pourraient être présentées ensuite dans d’autres centres ou musées en France et à l’étranger : ceux-ci pourraient d’ailleurs les compléter ou les modifier avec leurs moyens propres. Réciproquement, le Musée de La Villette sera conduit de façon assez naturelle à présenter des expositions réalisées ailleurs, en les adaptant éventuellement – par des objets ou des présentations audio-visuelles – à ses propres besoins. Une grande souplesse est nécessaire dans ce domaine, ainsi qu’un effort d’harmonisation des formats des expositions, afin de permettre une circulation plus faciles.
Diffusion de matériels de démonstration.
D’autre part, la réalisation des expositions du Musée permet de fabriquer également, comme un sous-produit, des matériels légers qui peuvent être utilisés, dans leur environnement propre, par des écoles ou des groupements à caractère culturel, comme les Maisons de la culture. Ces matériaux peuvent être regroupés en « modules » couvrant un sujet donné, et conçus de façon légère de manière à être compacts et transportables. Leur réalisation devrait être rationalisée pour fournir des supports suffisamment économiques. On pourra s’inspirer pour ce type d’actions des résultats obtenus en Suède où la Fondation Riksustallinger, financée par l’état, réalise plusieurs centaines de modules de ce genre, de taille très variable et qui sont utilisés par un nombre considérable de centres, musées et écoles pour leurs objectifs propres.
II. LES FONCTIONS DE VALORISATION
Dans le chapitre précèdent, nous avons analysé les fonctions qui constituent la raison d’être du Centre, c’est-à-dire la réalisation d’exposition et des présentations quasi-permanentes ou temporaires. Cependant, le résultat de ces activités, c’est-à-dire l’ensemble des salles d’expositions, constitue un acquit incomparable qui peut être utilisé pour d’autres actions, celles-ci valorisant en quelque sorte dans des domaines différents le capital accumulé. Ces actions, qui ne feraient d’ailleurs que prolonger et étendre l’action principale du Musée, peuvent être divisées en deux grandes catégories : la formation et l’information.
A. LES ACTIONS DE FORMATION
Valoriser et prolonger l’action du Musée
L’intérêt et l’originalité de formation axées sur le Musée, à condition bien entendu que celui-ci ne soit constitué seulement par une collection d’objets sans cadre explicatif étendu, est qu’elles permettent de s’adresser simultanément à des publics différents, en utilisant les mêmes méthodes que celles employées pour la fonction « Musée » elle-même. Elles prolongent de façon plus systématique et organisée les manifestations quotidiennes du Centre. Elles se distinguent, par les méthodes employées, des formations de type scolaire ou universitaire qu’elles peuvent compléter dans certains cas. Elles constituent un mode original, car extrêmement souple, de formation permanente.
On peut distinguer deux formations de ce type dans le Musée :
– L’action en milieu scolaire
– L’action de formation générale
1. L’action orientée vers les écoles et les établissements secondaires
Un âge décisif pour la formation scientifique
Beaucoup de Musées sont orientées essentiellement vers la population scolaire, qui en constitue la clientèle traditionnelle. Le Centre de la Villette, tout en menant une action largement tournée vers le public adulte, ne devrait pas négliger lui non plus le public scolaire. C’est en effet entre 8 et 14 ans que se précisent certaines orientations intellectuelles, scientifiques ou non. Si l’on veut sensibiliser la jeunesse aux différentes formes de la science et de la technique, c’est à partir de cette catégorie d’âge qu’il faut commencer. Il ne s’agit pas, bien entendu, de faire de sorte que tous les enfants deviennent des scientifiques, mais de donner à chacun les éléments objectifs qui lui permettront de choisir sa voie sans barrières psychologiques accidentelles. D’autre part, il est bon que même ceux qui ne s’orienteront pas ultérieurement vers des carrières scientifiques ou techniques aient une vue réelle de ces domaines et des relations détendues et familières avec eux. Il faut limiter la coupure en deux cultures qui se produit souvent à un âge relativement jeune.
Beaucoup de Musées ont été amenées à concevoir des programmes particuliers pour la population scolaire. Ces programmes sont conçus comme des compléments à la formation donnée dans les écoles et lycées, à la fois sur le plan des sujets abordés et sur celui des méthodes. En France, l’introduction dans les programmes scolaires d’une fraction libre égale à 10% du temps disponible facilité évidemment cette interaction entre école et Musée. Une bonne méthode en ce qui concerne la Villette, serait de prévoir qu’en semaine et pendant l’année scolaire, le Musée soit ouvert exclusivement pour les écoles le matin, par exemple entre 9h et 12h. Le public adulte, qui de toutes manières fréquente les Musées dans la journée en semaine, serait admis à partir de 12h et jusqu’à 21h par exemple. Pendant les vacances scolaires et en fin de semaine, l’ouverture au public général se ferait ès 9 heures.
Des programmes adaptés aux visites scolaires, préparés en liaison et avec la collaboration des enseignants.
Des programmes particuliers pourraient être préparés pour les classes élémentaires et secondaires le matin. Ces programmes seraient précédés par des séances d’information pour les maîtres, afin que ceux-ci puissent préparer leurs élèves à la visite du Musée. Des textes spécialement conçus à cet effet leur seraient remis pour les aider dans cette tâche (ainsi, d’ailleurs, que pour les séances de conclusion qui pourraient éventuellement avoir lieu dans les écoles après la visite). Naturellement, les classes admises dans le Musée le matin pourraient prolonger librement leur visite pendant le déjeuner et même l’après-midi (ceci offre un intérêt particulier pour les établissements scolaires de province ou de la banlieue parisienne). Les programmes devraient être conçus en fonction du niveau des classes correspondantes. Si on tient compte de l’expérience du Palais de la découverte et celle des Musées étrangers comparables, il devrait être possible d’accueillir à la Villette en moyenne 2000 à 2500 élèves par jour, à condition bien entendu, que le personnel d’encadrement soit suffisant. Celui-ci peut-être cependant un peu plus limité si l’on peut faire participer activement aux présentations les enseignants eux-mêmes. S’agissant des jeunes enfants, le Musée pourrait être doté de moyens particuliers dont l’usage dans les Musées étrangers a montré qu’ils étaient spécialement efficaces :
Des équipements adaptés aux jeunes enfants, pour éveiller leur curiosité et développer leur imagination
– Les salles de découvertes, qui sont des salles de 200 m2 environ contenant un grand nombre d’objets permettant des expériences simples, des manipulations techniques, des jeux ou même se prêtant à des assemblages laissant libre cours à l’imagination. Dans certains cas, des animaux vivants sont également disponibles. Les enfants, sous la surveillance de leur maître, passent une heure dans l’une des salles en s’adonnant librement aux activités de leur choix. Pendant les heures d’ouverture libre du Musée, le public, parents et enfants, y est admise à tour de rôle pendant une durée déterminée, en veillant à ce qu’un nombre maximum ne soit pas dépassé dans chaque salle. Ces salles de découverte, qu’on peut concevoir d’ailleurs pour les niveaux d’âges différents, sont extrêmement utiles pour familiariser l’enfant avec le monde extérieur et stimuler son imagination, sa créativité. Elles facilitent également le processus d’éducation familiale, la communication entre parents et enfants.
– Un théâtre de marionnettes qui pourrait être animé par des personnes capables d’écrire des scénarios adaptés au but recherche : les séances ainsi conçues peuvent familiariser l’enfant avec des phénomènes physiques simples, avec son environnement technologique, et lui en faire percevoir l’intérêt et les limitations. En pratique, ce système peut avoir d’ailleurs un impact aussi grand sur les adultes.
Il ne faut pas oublier enfin, s’agissant de la Villette, l’intérêt d’avoir un planétarium sur lequel nous reviendrons, et le Parc lui-même qui peut être à la fois un lieu de détente et un endroit où des éléments techniques peuvent être exposés et utilisés.
Les moyens à utiliser pour le public des classes supérieures des lycées sont évidemment différents mais beaucoup mieux connus : plusieurs d’entre eux ont été développés avec succès par le Palais de la découverte, et pourraient être, bien entendu, repris en compte à la Villette. En particulier, la création de clubs scientifiques est très souhaitable, car elle va tout à fait dans le sens des objectifs du Musée. Peut-être conviendrait-il de les orienter non seulement vers les lycées mais aussi vers les établissements techniques, afin de profiter de l’intérêt particulier, dont nous avons déjà parlé, des jeunes pour la technologie et certaines formes de travail manuel et d’artisanat.
Une action qui dépasse le cadre de la région parisienne
Il conviendrait enfin que le centre puisse fournir à la jeunesse de la région parisienne l’occasion d’établir des relations sérieuses et un véritable dialogue avec les enfants de province et de l’étranger. Il serait donc utile d’organiser, pendant les vacances scolaires, des séminaires réservés à la jeunesse, et centrés sur certains des thèmes du Musée, qui fournirait pour cela un cadre très approprié. Le problème matériel à résoudre est celui de l’hébergement, que l’on pourrait sans doute organiser sans trop de difficultés dans la zone Nord-Est de Paris (le Deutsches Museum, par exemple, a établi des relations étroites avec une auberge de jeunesse située à proximité).
2. Les actions de formation permanente
Un public très ouvert, une formation libre et souple, centrée sur le Musée lui-même
La façon dont il est proposé de concevoir le centre lui permettra de s’adresser à des publics très différents et à des niveaux variables. Une valorisation particulièrement intéressante des expositions du Musée consisterait don à en faire le support d’une action de formation permanente orientée vers le public postscolaire. Cette action devrait conçue de manière à respecter les caractères essentiels du Musée, qui le distinguent des écoles et universités traditionnelles, en particulier la souplesse, l’ouverture et la liberté. Dans notre esprit, cette formation ne requerrait aucun diplôme préalable et ne donnerait lieu à la délivrance d’aucun diplôme. (Dans le cas où il s’agirait de stages financés par les entreprises ou par la formation professionnelle, des certificats d’assiduité pourraient être délivrés si nécessaire). La caractéristique principale serait la possibilité, grâce au matériel disponible dans le Musée, de s’adresser simultanément à un public relativement hétérogène. À la base du système proposé seraient placés ce que nous appelons des modules de 8 à 12 séances d’une heure chacune, réparties sur 2 à 3 mois à raison d’une heure par semaine. Ces séances auraient lieu essentiellement le soir ou en fin de semaine. Elles concerneraient soit un sujet ponctuel scientifique ou technique précis, soit la revue générale d’un des thèmes du Musée. Il s’agirait dans tous les cas d’un système d’explication et de démonstrations utilisant les moyens du Musée, l’accent étant mis plus spécialement sur la formation pratique et beaucoup moins sur l’enseignement théorique (qui pourrait exister sans doute, mais de façon limité). En elles-mêmes, ces conférences permettraient :
Des programmes adaptés aux visites scolaires, préparés en liaison et avec la collaboration des enseignants.
– soit, d’acquérir des connaissances précises sur un sujet particulier, scientifique ou techniques,
– soit, de servir d’introduction plus approfondie au Musée lui-même.
Cependant, les modules pourraient être groupés de façon adaptée à chaque cas individuel de manière à constituer une formation plus large sur un domaine scientifique ou technique particulier. Pendant une année, par exemple, il serait possible à un individu donné d’acquérir jusqu’à 10 modules, à raison de 3 heures par semaines, ce qui permettrait de couvrir l’équivalent d’un enseignement déjà élaboré, mais dispensé dans un esprit différent.
Le problème principal que l’on pourrait rencontrer dans l’organisation de ce système de formation proviendrait de la difficulté de trouver des enseignants capables de s’adapter à un public hétérogène et de comprendre l’esprit dans lequel l’enseignement doit être donné. À mon avis, le système devrait être organisé en liaisons avec un ou plusieurs établissements existants, qu’il s’agisse du Cnam, de certaines grandes Écoles ou d’Instituts universitaires de technologie. Il conviendrait de ne le mettre en place que progressivement en commençant, à titre expérimental, avec un petit nombre de modules.
Un système de formation organisé en liaison avec des établissements d’enseignement
Il faudrait réfléchir attentivement aux difficultés qui pourraient résulter de la mise en œuvre généralisée de ce système. La formation permanente ne découle pas directement de la vocation du Musée mais permet, comme nous l’avons dit, de valoriser son capital et de concourir à nombre de ses objectifs les plus importants. D’ailleurs, plusieurs Musées français ou étrangers (à commencer par le Louvre) ont été conduits à organiser un système de formation complémentaire utilisant les moyens du Musée.
Une mise en œuvre progressive
Au démarrage et pour montrer l’intérêt de ce type d’action, le personnel du Musée pourrait mettre en place un nombre limité de modules à titre expérimental, en commençant par ceux qui prolongent directement les présentations : par exemple, quelques modules technologiques et quelques revues de thèmes particulièrement attrayants pour le public.
Il serait important que le financement de cette action soit auto-équilibré, les ressources provenant soit des droits perçus directement ou par l’intermédiaire des établissements responsables, soit des subventions spécifiques fournies par les organismes intéressés (entreprises, centres de formation professionnelle, ANPE, etc.)
Un régime de croisière, un organisme indépendant
Une fois démontrée la faisabilité de ce type de formation et d’intérêt qu’il est susceptible de susciter dans le public, une organisation particulière pourrait être mise en place qui prendrait la relève et dégagerait le Musée du souci d’une gestion qui pourrait se révéler trop lourde, notamment en personnel. Plus précisément, il nous semble que la gestion des actions de formation, une fois atteint un régime de croisière, pourrait être assurée par un organisme indépendant du Musée qui passerait avec celui-ci une convention prévoyant les moyens qui pourraient être mis à sa disposition et la rétribution correspondante.
La recherche de nouvelles formes d’éducation
On peut penser néanmoins qu’une activité limitée pourrait subsister dans le Musée pour la réalisation régulière de modules expérimentaux. Il serait intéressant, en effet, de conserver au Musée un rôle de laboratoire où pourraient être élaborée de nouvelles formes d’éducation. Cette action serait alors essentiellement appuyée sur le groupe de recherches sur l’éducation scientifique dont il sera question le prochain chapitre.
B. LES ACTIONS ORIENTÉES VERS L’INFORMATION DU PUBLIC
Répondre à la curiosité du public
La visite du Musée devrait normalement provoquer chez beaucoup de visiteurs curieux et intéressés la formulation d’un certain nombre de questions et plus généralement le besoin « d’en savoir plus » dans tel ou tel domaine. Si la vocation du Centre de la Villette est justement de rapprocher la science et la technique du public, de le sensibiliser à des différents aspects, de créer peu à peu une composante « science et technique » dans la conscience de chaque individu, il doit être possible de répondre à ces questions, d’aider le visiteur à aller plus loin dans les domaines qui l’intéressent. Il est donc important que le Centre mette en place un certain nombre de moyens permettant de satisfaire à la curiosité du public. À la limite, il serait excellent que chacun sache, lorsqu’il se pose une question liée à la science ou à la technique, qu’il peut trouver à la Villette, sinon une réponse complète, ce qui impliquerait une tâche trop lourde – au moins quelques éléments et des indications sur la façon de procéder pour en savoir davantage. Nous donnons ci-dessous quelques suggestions sur ces moyens, qui devraient évidemment être étudiés plus en détail au cours de la réalisation du Centre. Dans notre esprit, ces moyens ne seraient mis en place que progressivement en fonction du développement du Musée lui-même.
1. La bibliothèque
Il nous paraît assez évident que le Centre devrait être doté d’une bibliothèque largement ouverte au public et d’accès gratuit. Cependant, une réflexion s’impose sur l’étendue de ses réserves, car il n’est pas possible de créer un ensemble exhaustif, en particulier pour les domaines techniques spécialisés et pour les résultats de la recherche fondamentale.
Une bibliothèque largement ouverte et d’accès gratuit
Dans la mesure où le budget le permettrait, il serait intéressant de couvrir trois types de besoins :
– Une bibliothèque de référence, qui contiendrait la plupart des textes de base, en particulier les encyclopédies, et les manuels scolaires et universitaires. Cette bibliothèque pourrait être prolongée par un système d’information sur ordinateur qui permette d’accéder à des bibliothèques plus étendues, ainsi que par une photothèque regroupant, dans chaque domaine technique, les reproductions des objets les plus importants situés en France ou dans certains pays étrangers. Cette collection pourrait avoir un caractère historique plus marqué que le reste du Musée, et permettrait de créer un lien avec les centres techniques industriels régionaux.
– Une bibliothèque de vulgarisation qui serait dans la ligne directe des activités muséographiques en permettant au public non spécialisé de trouver écrit des informations plus détaillées sur les sujets abordés dans le Musée. Cette bibliothèque contiendrait les ouvrages généraux sur la science et la technique, et la plupart des volumes qui paraissent régulièrement pour en présenter au public les résultats et leurs implications. Il faudrait y ajouter toutes les revues de vulgarisation scientifique et technique.
– Enfin, si possible, une bibliothèque de prêt contenant un choix des textes de base et des ouvrages de vulgarisation les plus significatifs. Le public aurait accès à cette bibliothèque de prêt moyennant le versement d’une caution, ou en devenant membre de l’Association de soutien du Musée.
2. La cinématique et la vidéothèque
Rassembler les films et les séquences audio-visuelles à caractère scientifique et technique
On réalise chaque année en France et dans les pays francophones un grand nombre d films, en général de court métrage, à caractère scientifique ou technique. Ces films ne sont nulle part, à notre connaissance, conservés et répertoriés de façon complète. Or, beaucoup d’entre eux sont fort bien faits et mériteraient d’être rassemblés et diffusés plus largement. Il conviendrait donc :
a) dans un premier temps rechercher le plus possible de films existants, de les inventorier, et d’en accumuler un certain nombre dans le Musée, en particulier, d’assurer par des copies nouvelles la conservation des plus intéressantes.
b) D’obtenir, par ailleurs, l’institution d’un dépôt légal des nouveaux films scientifiques et techniques dont pourraient bénéficier le Centre de la Villette, à charge pour lui de permettre l’accès à ces films à d’autres établissement et institutions d’intérêt public. Les films en question pourraient être projetés dans le Musée pendant un certain temps.
Enfin, il existe de nombreuses séquences audio-visuelles réalisées soit pour la télévision, soit pour des expositions et des présentations diverses. Il s’agirait dans ce cas de créer à la Villette une banque de séquences, dont certaines seraient conservées, d’autres simplement répertoriées.
3. Les publications
Le problème des publications du Centre est également une question qui devrait faire l’objet d’une étude approfondie. Il ne nous paraît pas souhaitable que le Centre de la Villette édite à grands frais une revue à caractère scientifique, qui ferait double emploi avec les revues d’information du public qui existent déjà, sans pour autant atteindre le niveau des revues spécialisées.
Il nous semble que le Centre pourrait, dans un premier temps, se limiter à :
Un bulletin mensuel
– La publication d’un bulletin mensuel donnant des informations scientifiques et techniques courtes et rapides, ainsi que le détail des activités du Centre.
Des textes spécifiques
– L’édition de texte à caractère « permanent » destinés à expliquer les différentes présentations du Musée. Certains de ces textes seraient disponibles pour les visiteurs ; d’autres seraient destinés aux enseignants afin qu’ils puissent préparer leurs élèves à la Visite du Musée. On pourrait ajouter des fiches courtes et synthétiques sur chacune des présentations situées à l’intérieur des thèmes, et que le visiteur pourrait se procurer par groupes thématiques. De même, il pourrait y avoir dans certains cas des monographies recouvrant l’ensemble d’un thème, ces monographies faisant périodiquement l’objet d’une remise à jour.
Un rapport annuel
– L’édition d’un rapport annuel détaillé donnant, outre le compte-rendu des activités du Musée, des informations synthétiques sur le contenu scientifique et technique des réalisations de l’année écoulée. Ce rapport serait principalement destiné aux administrations, à l’industrie, aux collectivités locales, etc.
Utiliser les médias
D’autre part, le centre pourrait passer des accords avec les principales revues de vulgarisation scientifique pour que des rubriques régulières y soient consacrées à ses activités, et que des articles de fond y soient publiés sur les nouveaux thèmes abordés dans le Musée, soit dans des expositions quasi-permanentes, soit dans les expositions temporaires ou les actions industrielles. De même, le centre devrait s’efforcer de réaliser, avec les établissements compétents, des émissions régulières d’information télévisée et radiodiffusée.
4. Le service de presse et le centre d’information du public
Participer à la diffusion de l’information
Le Musée de la Villette pourrait travailler en liaison étroite avec les journalistes scientifiques, qui devraient être pour lui des interlocuteurs privilégiés. Il serait donc possible de constituer pour eux une structure d’accueil qui les aiderait dans leur travail, dotée de moyens matériel et d’information.
D’autres part, un système de réponse aux questions du public, largement informatisé, permettrait d’orienter les visiteurs vers les sources d’information spécifiques dont ils pourraient avoir besoin. Il ne s’agit pas, ici encore, de fournir directement des données trop spécialisées mais des informations générales, complétées par l’indication précise de l’endroit où il est possible de trouver des renseignements complémentaires plus détaillés. Une collaboration avec les organismes concernés par l’information scientifique permettrait d’utiliser, pour ce service, les banques de données existantes ou en voie de constitution. Après rodage, ce système pourrait être étendu à certains points du territoire national, en le couplant à un mécanisme d’interrogation à distance.
III- LES FONCTIONS DE SUPPORT – LE RÉSEAU NATIONAL
Dans ce chapitre, nous nous proposons de décrire rapidement certaines des fonctions de support qui seront nécessaires à la vie du Centre, tout au moins celles qui peuvent apparaître comme spécifiques. Il n’est pas nécessaire, en effet, de décrire de façon explicite l’organisation de l’administration - qui ne devrait pas être, bien entendu, trop lourde, afin de conserver au Centre sa souplesse et sa créativité – ni celle de fonctions naturelles comme le gardiennage ou l’entretien.
Nous parlerons donc plus particulièrement :
– De la recherche ;
– Des ateliers de production ;
– Des relations extérieures, et plus particulièrement des rapports avec les autres Musées scientifiques et techniques (« le réseau national »).
A. LA RECHERCHE
Il n’est pas dans la vocation du Centre de la Villette d’être à proprement parler un établissement de recherche. Cependant, certaines de ses activités, dans la mesure où elles seront originales et difficiles supposent un certain nombre de réflexions et d’approfondissements. D’autre part, il n’est pas possible d’attirer dans le personnel du Centre des hommes et des femmes de qualité si on ne leur donne pas la possibilité de consacrer une partie de leur temps à la création. Dans des domaines très proches des objectifs du centre, il existe actuellement en France des groupes de chercheurs de haut niveau qui n’ont pas d’existence reconnue, dans la mesure où leurs activités ne figurent dans aucun programme officiel ni ne font pratiquement l’objet d’aucun enseignement. Ces chercheurs dépendent du CNRS, des universités ou de certains autres organismes (École pratiques des hautes études, Grandes Écoles). Les domaines plus particulièrement concernés sont :
– l’histoire des sciences et des techniques ;
– La pédagogie scientifique ;
– les rapports de la science ou de la technique avec l’économie, les affaires sociales et l’environnement.
Une structure d’accueil et un support matériel, en échange d’un service dans le cadre du Musée
Des travaux très intéressants sont élaborés mais trouvent rarement leur utilisation pratique. Nous proposons donc que le Centre de la Villette offre à quelques-uns parmi les meilleurs de ces chercheurs une structure d’accueil et un support matériel, en échange d’un service sur le Musée, soit dans le cadre des présentations quasi-permanentes soit dans celui des expositions temporaires. Il ne s’agit pas de constituer un nouveau corps de chercheurs : les personnes concernées resteraient rattachées à leur administration d’origine et ne figureraient pas dans les effectifs du Musée. Seul le personnel technique et de secrétariat nécessaire à leur fonctionnement serait pris en charge par celui-ci. De toutes manières, il ne faudrait pas que le nombre de ces chercheurs soit trop élevé : un effectif maximum de 25 ou 30, réparti en trois groupes serait largement suffisants. Rappelons que plusieurs Musées étrangers abritent les travaux de chercheurs en beaucoup plus grand nombre. Ceci aurait l’avantage d’aider au développement des disciplines qui concourent aux objectifs que nous poursuivons de donner au centre une possibilité de création originale, de renouvellement. Par ailleurs, le groupe de pédagogie scientifique participerait directement aux activités de formation permanente expérimentale dont nous avons parlé au chapitre précédent.
B. LES ATELIERS DE PRODUCTION
Des besoins spécifiques
Il existe en France un certain nombre de firmes privées qui sont spécialisées dans la réalisation d’exposition de nature diverse. Il est probable que, dans la phase de développement du Musée, il sera nécessaire de faire appel à elles dans une large mesure. Une partie des travaux pourrait, par ailleurs, être confiée à des spécialistes, des professionnels ; des artisans, qui ne travaillent pas d’ordinaire pour ce genre d’activités. Cependant, il faut bien le dire, à part quelques-uns au Palais de la découverte, il n’existe pas à l’heure actuelle en France de compétences spécifiques, dont les besoins sont souvent différents de ceux des expositions de nature commerciale :
– par la complexité du message à transmettre ;
– par le caractère d’authenticité requis ;
– par la solidité indispensable, si l’on veut que les présentations puissent « résister » à un public nombreux pendant très longtemps.
Développer ses propres moyens
Il faudra donc que le Musée développe peu à peu ses moyens dans un domaine en pleine évolution. Ceux-ci lui permettront d’ailleurs de faire face ensuite lui-même à une grande partie de ses propres besoins, et de produire également des matériels qui pourront être utilisés à l’extérieur, par les écoles, par les centres culturels et éventuellement, sur une base de réciprocité, par les autres musées scientifiques et techniques français et étrangers.
Outre les ateliers de type classiques : dessin, travail du métal, du bois, du plastique, peinture, électricité et électronique, etc., il nous paraît nécessaire de prévoir un studio de production audio-visuel et, bien entendu, un service d’informatique pour l’entretien et le fonctionnement des installations du Musée, la programmation de ses activités et la mise en œuvre de la partie informatique de ses expositions. Un atelier de production est également indispensable.
Des ateliers visibles par le public
Dans la mesure du possible, ces ateliers devraient être utilisés également comme des lieux de démonstration pour le public. Autrement dit, au moins une partie des ateliers en activité devraient être situés de façon à être visibles, au moins à travers une paroi vitrée. La variété des productions nécessaires pour un Musée, et le talent dont doivent faire preuve les techniciens qui y travaillent seraient, en effet, autant de raisons d’intérêt pour un public attiré par le vrai travail professionnel.
D’une façon générale, d’ailleurs il faudrait s’efforcer de rendre visible le plus possible d’activités du Centre, qui doit être en lui-même une démonstration vivante (nous reviendrons ultérieurement sur ce point en ce qui concerne l’énergie et l’automatisation.
C. LES RELATIONS EXTÉRIEURES
Les musées scientifiques et techniques constituent actuellement une grande communauté internationale. Le centre de la Villette devra naturellement y prendre sa part et s’engager en particulier activement dans des échanges d’expositions, qui sont un moyen naturel de créativité et de renouvellement.
Il existe en outre deux domaine vers lesquels il nous semble que, sur le plan international, le centre devrait diriger une attention toute particulière :
L’Europe
– Les relations internationales, car les programmes de recherche et la production industrielle sont de plus en plus conçus à cette échelle, ce dont le public doit prendre conscience.
Les pays en voie de développement
– Les relations avec les pays en voie de développement, car il nous semble que le centre de la Villette pourrait fournir un cadre particulièrement approprié à la présentation, hors de toute pression commerciale, de ce que notre pays peut offrir de mieux dans les domaines technologiques et industriels. Ce point est d’ailleurs si important que nous pensons qu’il devrait orienter également la conception même des scénarios thématiques du Musée, de façon à ce qu’y soient incluses les applications les plus intéressantes pour les pays en voie de développement (en particulier en ce qui concerne l’énergie, l’agriculture, l’industrie agro-alimentaire, le développement des ressources en eau, etc.).
Sur le plan national, les objectifs même du Musée l’obligeront naturellement à entretenir des relations avec toutes les forces vives qui dans les domaines scientifiques, techniques et industriels auront intérêt à l’utiliser pour faire connaître leurs activités et leurs réalisations. Il n’est donc pas nécessaire de parler en détail de ce type de relations. Cependant, il est un problème plus particulier qui se pose actuellement de façon urgente, qu’il est nécessaire d’évoquer : c’est celui des autres musées scientifiques et techniques, spécialement en province, dont la plupart en sont seulement à la phase de conception mais qui sont certainement appelés à beaucoup se développer dans l’avenir.
D. LE RÉSEAU NATIONAL
L’archéologie industrielle
Nous ne pensons pas, nous l’avons dit, que le centre de la Villette doive être conçu comme un établissement purement parisien. Sa création coïncide avec un extraordinaire mouvement, sur l’ensemble du territoire, pour le développement des musées techniques basés souvent sur des installations industrielles très intéressantes, témoins de l’évolution technologique depuis le début de la révolution industrielle. L’idée que la technique et son histoire font partie de notre patrimoine culturel commence à être acceptée. On peut dire d’ailleurs que, dans a mesure où notre projet ne devrait pas conduire à un centre de conservation, tous ces efforts sont plutôt complémentaires de ce qui qui se fera à la Villette. Des relations doivent donc pouvoir être organisées.
Les relations avec les musées spécialisés
D’autres part, un certain nombre de Centres spécialisés existent déjà, ou sont appelés à se développer. Certains sont d’ailleurs fort illustres, tel le Muséum national d’histoire naturelle, ou le musé des techniques du Cnam. D’ailleurs, comme le Musée de l’air et de l’espace du Bourget sont des créations récentes. Il est indispensable qu’ici encore des relations soient organisées, en particulier, il ne nous paraît pas nécessaire que le Centre de la Villette reproduise de façon détaillée les domaines couverts par ces centres spécialisés. La présentation des sciences et des techniques offre un domaine immense, la duplication serait donc tout à fait absurde. Il suffira que, dans les domaines où existent des musées spécialisés, la Villette se contente d’être une vitrine limitée qui renverra aux établissements plus complets. Nous avons déjà parlé des relations avec le Cnam. En ce qui concerne le Muséum nationale d’histoire naturelle, les frontières seront faciles à définir. Dans le domaine biologique en particulier, le Centre de la Villette devrait se concentrer plus particulièrement sur la biologie fondamentale et sur la biologie humaine. Des expositions conjointes pourront d’ailleurs être organisées lorsque des sujets débordant du cadre des activités de chacun des deux établissements paraîtront intéressantes à traiter.
Des relations décentralisées dans le cadre d’un schéma directeur
Une idée essentielle nous paraît devoir gouverner les relations du Centre de la Villette avec tous les autres établissements à Paris et en province : il faut que ces relations soient décentralisées. Il n’est pas du tout souhaitable que se créent en province ou ailleurs des « antennes » de la Villette. Il voudrait mieux, au contraire, que les initiatives individuelles soutenues par l’État, aussi bien au niveau des collectivités locales qu’à celui du gouvernement, puissent se développer librement. Il conviendrait cependant que, passée la phase de bouillonnement actuelle, un schéma directeur apparaisse de façon à ce que les établissements les plus aptes à représenter tel ou tel aspect de la technique soient plus particulièrement encouragés et aussi que les centres couvrent le territoire national de façon suffisamment homogène. D’autres part, il nous paraît que les centres actuellement en formation devraient, autant que possible, associer l’archéologie industrielle à des activités scientifiques un peu plus larges, incorporant des préoccupations pédagogiques vis-à-vis du public, peut-être en relation avec les établissements d’enseignement supérieur de leur région.
L’association nationale des Centres scientifiques et techniques
La meilleure manière d’organiser de façon simple et décentralisée les relations du Centre de la Villette avec les autres Musées scientifiques et techniques serait, à notre sens, de créer une Association nationale des centres scientifiques et techniques, analogue à celle qui existe actuellement, et qui fonctionne de façon très satisfaisante aux États-Unis.
Cette association pourrait :
– définir de façon claire et les compétences de chacun ;
– organiser une certaine compatibilité dans la conception des présentations, de façon à faciliter l’échange d’expositions sur une base généralisée ;
– organiser en commun la formation du personnel d’animation des centres.
L’échange du matériel logiciel d’exploitation
En particulier, s’agissant des présentations modernes des expositions, il faut voir que c’est toute la partie logicielle, c’est-à-dire les séquences audio-visuelles et les programmes informatiques, qui est longue, coûteuse et difficile à développer. Or, cette partie, une fois réalisée, peut-être reproduite avec un coût pratiquement nul. L’échange de toutes ces productions serait donc particulièrement utile et facile. Les centres pourraient alors compléter les présentations avec les objets dont ils pourraient disposer localement, ce qui permettraient aux expositions d’être beaucoup plus adaptées à chaque situation. C’est ici que l’on saisit toute la différence qu’il y a entre une exposition scientifique ou technique et une exposition artistique : l’œuvre d’art est unique, c’est la contemplation et les émotions qu’elle suscite qui créent la communication, tandis que sur le plan scientifique et technique, c’est d’abord un concept rationnel qu’on veut transmettre, naturellement, la différence réelle est moins tranchée : il y a d’une part le « Musée imaginaire » et d’autre part, il ne faut pas minimiser le pouvoir suggestif et la beauté de l’objet scientifique et technique lui-même.
L’association nationale, qui devrait être un organisme très souple, pourrait également tenir régulièrement des réunions où seraient débattues les questions d’intérêt commun, et organiser des stages consacrés à des problèmes techniques de muséologie.
TROISIÈME PARTIE
ORGANISATION ET MÉTHODOLOGIQUE
I. LES STRUCTURES
La structure intérieure du Centre, dans ses grandes lignes, découle assez naturellement des fonctions que nous avons proposées. Nous bornant pour le moment à l’ensemble qui devrait être édifié autour du bâtiment principal (la "Grande Salle" de La Villette), nous pouvons définir un certain nombre de besoins qui devront naturellement être précisés à mesure que le contenu de chaque fonction aura été déterminé de façon plus détaillée.
A. LES SALLES D’EXPOSITION QUASI-PERMANENTES
Ces salles, comme nous l’avons dit, constituent l’élément central du Musée. Elles seraient organisées autour de quelques grandes divisions regroupant un certain nombre de thèmes intégrés. L’agencement de ces thèmes, leur spatialisation et les circulations correspondantes, devraient être calculées de façon à mettre en évidence les relations entre ces thèmes, à suggérer ainsi au visiteur des rapprochements synthétiques qui permettent d’éclairer sa visite et lui donner une idée d’ensemble des domaines auxquels il s’intéresse.
… une spatialisation à la fois verticale et horizontale….
L’ordre de grandeur des surfaces à réserver à ces salles d’expositions pourrait être d’environ 60 000 m2 répartis sur plusieurs niveaux. Étant donné la structure générale du bâtiment, il serait bon de développer les thèmes correspondant à des domaines voisins selon une structure verticale, de façon à éviter au visiteur des déplacements trop longs. (Un des problèmes principaux posés par les grands Musées provient des longueurs de chemin à parcourir qui conduisent rapidement le visiteur à renoncer à poursuivre plus avant, en raison de sa fatigue). Le développement vertical permet également d’introduire de la diversité dans la présentation des thèmes, les hauteurs sous plafond n’étant pas les mêmes à chaque étage. D’autre part, on aura dans certains cas des objets lourds à présenter qui pourront avantageusement trouver place au rez-de-chaussée, là où la charge au sol peut être la plus grande. Au contraire, les arrangements que nous avons appelés « thèmes horizontaux » pourraient être présentés sur un seul niveau, les deux objectifs essentiels étant :
– d’utiliser la spatialisation pour suggérer au visiteur des rapprochements et des relations entre les thèmes,
– de permettre des types de visite différents qui minimisent dans chaque cas le chemin à parcourir.
…Rechercher la diversité des structures intérieures.
Sur le plan architectural, il conviendra d’utiliser le niveau supérieur qui possède une grande hauteur sous plafond pour des présentations spectaculaires et d’autre part, d’y installer des structures en forme de balcons ou de mezzanines, car celles-ci permettent de stimuler l’intérêt du visiteur et de créer un environnement particulièrement actif et attrayant. Il faudra trouver des solutions adaptées aux visiteurs handicapés, à qui une structure verticale diversifiée pourrait poser des problèmes.
Dans les volumes thématiques, des structures d’architecture intérieure, adaptées à chaque présentation, permettront de varier l’impression visuelle et d’éviter la monotonie, source de fatigue. Il pourra s’agir de cloisons partielles, de différences de niveaux, de structures en balcons, etc. Des petites salles à des exposés, des discussions, des présentations plus détaillées, et pouvant accueillir entre 15 et 25 personnes, seront disséminées au cœur même des grandes salles d’exposition. Elles pourront être transparentes, mais isolées sur le plan phonique, ce qui accroît l’intérêt pour le visiteur de l’impression d’activité donné par le Musée.
… Des espaces équilibrés et harmonieux…
Les structures d’architecture intérieure devraient être conçues autant que possible à partir d’éléments modulaires qui peuvent être assemblés de façon variable en fonction des besoins. Ceci permettrait de faire des économies d’échelle dans la réalisation et faciliterait les modifications à apporter aux présentations thématiques en fonction de l’évolution du Musée.
… une atmosphère agréable…
D’une manière générale, l’atmosphère de ces salles permanentes doit être agréable et donner une impression propice au calme et à la réflexion. Ceci est possible, même si le nombre de visiteurs est élevé, à condition d’éviter l’entassement des présentations. Il faut utiliser l’avantage fourni par les grandes surfaces disponibles à La Villette pour réaliser des présentations suffisamment « aérées », où la circulation est relativement libre et facile. S’agissant du sujet même des expositions, il faut s’efforcer également d’alterner les zones « tendues », où les sujets traités, les expériences présentées peuvent demander un certain effort au visiteur ou bien créer en lui une tension psychologique, avec des zones plus détendues, aménagées même pour prendre un repos temporaire. La décoration doit concourir I cette impression, aussi bien par le choix des couleurs et des éclairages, que par les tableaux, les présentations audio-visuelles, les objets qui décoreront chaque salle, etc. Un rapprochement entre les cultures, scientifique et artistique, est souhaitable, de plusieurs manières : dans la sélection des sujets traités, comme nous l’avons vu, mais aussi dans la décoration. Des tableaux, des sculptures choisis en fonction du caractère scientifique et technique du Musée, concourront au rapprochement souhaité tout en créant une atmosphère plus agréable.
B. LA ZONE LIBRE
Dans notre esprit, et nous reviendrons là-dessus en étudiant le budget de fonctionnement du Centre, l’accès à la plus grande partie des salles d’expositions permanentes devrait être payant. Cependant, il paraît souhaitable d’aménager au rez-de-chaussée une zone libre d’environ 6 000 m2, qui traverserait tout le bâtiment dans la direction Nord-Sud. Ceci permettrait :
– d’accéder au Parc à partir de la Porte de La Villette, ainsi qu’aux autres structures qui pourraient s’y trouver ;
– de canaliser l’accueil du public et de lui permettre de se diriger vers les différents services du centre : Musée, Salles d’expositions temporaires, Bibliothèque, Planétarium, Théâtre, etc.
…une zone libre aux fonctions multiples…
Dans cette zone libre seraient placées les installations d’accueil et les différentes entrées. Il y aurait en outre le service d’information sur le Musée lui-même, les salles d’attente, etc. Y prendraient place également les boutiques qui paraissent un complément indispensable au Musée : librairie scientifique, boutiques de souvenirs et de jeux scientifiques, etc. Enfin, c’est dans cette zone libre que nous proposons de placer les salles d’actualité, dont il a été question plus haut, qui seraient donc accessibles à un large public. On pourrait y ajouter quelques échantillons, renouvelés de façon périodique, des présentations du Musée lui-même. La périphérie de la zone libre serait transparente de façon à permettre au passant d’apercevoir quelques-unes des salles d’expositions - au rez-de-chaussée et à l’étage inférieur - et lui donner ainsi l’envie d’entrer dans le Musée proprement dit.
En d’autres termes, la zone libre aurait pour fonctions :
– d’accueillir et de diriger le public entre les différentes activités du Centre ;
– de l’attirer vers les expositions du Musée ;
– de l’informer sur le Centre et sur les dernières actualités scientifiques et techniques.
C. LES SALLES D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Ces salles pourraient couvrir, comme nous l’avons dit, environ 15 000 ou 20 000 m2. (Étant donné que nous proposons, comme nous le verrons, de ne réaliser le Musée que par étapes, il est possible que les surfaces relatives consacrées aux expositions permanentes et temporaires soient modifiées en cours de développement du Musée, en fonction des demandes qui apparaîtront à mesure que les structures seront mises en place). Elles seraient destinées aussi bien aux expositions organisées par le Musée lui-même, ou en relation avec d’autres Établissements, qu’aux « actions industrielles » dont nous avons parlé. Les surfaces indiquées ici sont des ordres de grandeur qui montrent tout de même clairement le parti de privilégier les salles permanentes par rapport aux « surfaces à tout faire ». Du point de vue de l’activité, il n’y a pas grande différence entre ces deux types de surfaces, ce qui ne devrait pas compliquer l’élaboration du programme architectural.
Sur le contenu, par contre, il y a des différences notables. Dans notre esprit, les expositions temporaires sont plus légères, plus mobiles, moins coûteuses et construites avec des matériaux qui n’ont pas besoin de résister aux manipulations du public pendant de longues périodes. Les salles correspondantes, qui seraient polyvalentes, contiendraient beaucoup moins d’éléments d’architecture intérieure.
D. LES AUTRES INSTALLATIONS DU CENTRE
Des équipements nécessaires à la vie du Centre.
Il est évidemment nécessaire de prévoir des surfaces destinées aux différentes fonctions dont nous avons parlé. En complément des salles d’expositions, il faudrait donc trouver :
– Un grand planétarium (de 32 mètres de diamètre) situé de préférence à proximité de la zone consacrée à l’Univers, et pouvant accueillir entre 800 et 1 000 personnes ; ce planétarium destiné à des présentations assez spectaculaires de type "grand public" pourrait être complété par un ou deux petits planétaires contenant chacun au maximum 50 personnes destinés à des séances du type éducatif, avec participation de l’auditoire. Il serait également utile d’installer, en liaison avec le thème astronomique, un petit observatoire ouvert au public.
– Un auditorium, d’environ 500 places, dans lequel on pourrait aussi bien organiser des conférences et des réunions que présenter des films. Il serait souhaitable que cette salle soit équipée en théâtre « Omnimax » permettant la projection de films très spectaculaires sur un grand écran en forme de coupole. Il s’agit d’une technique nouvelle, maintenant bien développée aux États-Unis et au Canada, et particulièrement adaptée aux présentations scientifiques et techniques destinées au grand public.
– Plusieurs salles de conférences plus petites (100 à 200 places) destinées à des exposés, des réunions plus restreintes, et aux séances de formation permanente.
En d’autres termes, la zone libre aurait pour fonctions
– d’accueillir et de diriger le public entre les différentes activités du Centre,
– de l’attirer vers les expositions du Musée,
– de l’informer sur le Centre et sur les dernières actualités scientifiques et techniques.
À ces salles d’animation spécifiques, il faudrait ajouter :
– la bibliothèque et la vidéothèque,
– les ateliers et services techniques,
– les locaux réservés au contrôle,
– les surfaces nécessaires pour les bureaux et l’administration,
– des facilités pour la restauration,
– enfin, en sous-sol, un certain nombre de locaux pour les collections, les réserves, les magasins, etc.
Dans la « Grande Salle » de La Villette, outre les sous-sols qui seront assez étendus, puisqu’on pourra conserver les sous-sols des bâtiments frigorifiques et d’abattage, qui communiquent avec le premier niveau des sous-sols de la Grande Salle, il sera possible d’utiliser également pour certains de ces services l’étage technique qui se prête mal à des activités ouvertes au public.
E. LE PARC
Un lieu d’attraction qui doit prolonger le Musée et servir de trait d’union avec son environnement.
Il n’est pas dans notre mission de proposer une structure détaillée pour le Parc qui doit être aménagé dans la zone de La Villette. Cependant, il nous paraît souhaitable que des liaisons existent entre le Parc et le Musée. Il faut penser, en effet, que beaucoup de visiteurs du Musée seront d’abord attirés par l’idée d’une promenade dans le Parc, qui sera l’un des plus grands espaces verts de Paris. Il est probable aussi que, surtout en fin de semaine ou pendant les vacances scolaires, beaucoup de familles y feront des visites s’étendant sur la majeure partie d’une journée, combinant la détente dans le Parc, la visite du Musée et un repas pris au restaurant.
Un atout pour le centre.
Une certaine unité devrait donc être recherchée à la fois par le dégagement des perspectives et par l’implantation d’objets scientifiques et techniques, de jeux à caractère technologique, et même d’expériences et de démonstrations en vraie grandeur (nous pensons à des utilisations de l’énergie solaire par exemple). Une grande serre tropicale, qui pourrait être placée dans l’une des Halles existant actuellement sur le terrain, compléterait heureusement les présentations de certains thèmes du Musée.
Dans notre esprit, la présence du Parc est un atout spécifique qui compenserait largement le handicap lie à l’excentricité du site de La Villette. Elle permet aussi de préparer psychologiquement le visiteur pour qui la technologie surtout dans ses manifestations les plus spectaculaires, revêt souvent un caractère dramatique. Elle facilitera également l’organisation des visites scolaires, surtout celles des enfants des classes élémentaires.
Enfin il ne faut pas oublier que le site de La Villette sera une composante importante de la vie de la population du Nord-Est de Paris. Il importe donc d’installer dans le Parc, et peut être dans l’une des Halles, des éléments qui puissent répondre spécifiquement à ses besoins. Le Centre lui-même ne devrait pas, d’ailleurs, ignorer cette population au milieu de laquelle il sera implanté, et devrait donc s’efforcer d’établir avec elle des relations particulières.
II LEUR RÉALISATION
A. LA MÉTHODE
Ne pas sous-estimer l’impact visuel, recenser les moyens existants, adopter une démarche progressive
La conception du contenu des thèmes qui constituent l’essentiel des expositions permanentes est une chose difficile et qui demande une approche pluridisciplinaire. Dans chaque cas, il convient, en effet, de trouver d’abord des éléments qui attirent l’attention du visiteur sans créer de discontinuité avec la réalité extérieure qui lui est familière. Ces éléments très « visuels » doivent faire l’objet d’une réflexion, et même d’une recherche sérieuse. À partir de ce « chemin » central, des branchements plus spécialisés permettent d’approfondir les divers éléments qui composent l’illustration du thème. Ces éléments doivent être d’une part déterminés à partir des moyens disponibles (objets, composantes technologiques, maquettes, etc.) et d’autre part, conçus pour illustrer des propositions simples et décomposées afin de faire comprendre au visiteur l’essentiel du sujet traité. Les éléments composant le thème doivent de plus intégrer les aspects scientifiques, la technologie sous-jacente et illustrer les applications industrielles les plus significatives. Enfin, ils doivent être compréhensibles par le public au niveau choisi et obtenir l’effet recherché.
Des groupes de travail très ouverts
Un comité de haut Niveau
Il sera donc nécessaire pour chaque thème, ou chaque groupe de thèmes voisins, de constituer des groupes de travail incluant à la fois des scientifiques, des ingénieurs, des représentants significatifs du public et enfin des spécialistes des méthodes de présentation (architecture intérieure, décoration, audio-visuel). Il ne nous paraît pas bon d’établir dès le départ un schéma trop institutionnalisé, c’est-à-dire de véritables comités scientifiques et techniques par disciplines, qui risqueraient de scléroser rapidement le processus de réalisation. Ces comités consultatifs existeront probablement par la suite, lorsque le fonctionnement du Centre aura atteint un régime de croisière. Dans la phase de réalisation, il vaudrait mieux faire animer des groupes de travail relativement informels par un petit état-major multidisciplinaire dirigé par une seule personne responsable de la réalisation effective, sous l’autorité du Président de l’Établissement Public d’aménagement L’ensemble du système pourrait être supervisé et conseillé par un Comité de personnalités qui pourrait être le prolongement du Comité consultatif qui a été mis en place pour l’élaboration de ce Rapport. De toutes manières, il est essentiel d’instituer une unité de conception du Musée à l’intérieur de l’Établissement Public chargé de réaliser le projet. Une féodalisation des différentes fonctions du Centre, telle qu’elle s’est produite dans une large mesure au moment de la conception du Centre Pompidou, donnerait un résultat désastreux. Le Musée de La Villette diffère profondément des Musées traditionnels, car il faut concevoir le contenu en même temps qu’on réalise le contenant. L’ensemble doit donc être le fruit d’un travail d’équipe très maîtrisé, car la conception détaillée d’un grand nombre de thèmes relevant de disciplines différentes fait nécessairement intervenir un nombre important de personnes (la conception de l’Evoluon de Eindhoven, par exemple, pourtant beaucoup plus petit, a fait intervenir 120 personnes pendant 2 ou 3 ans), et il faut à tout prix éviter que le système diverge et conduise à un résultat totalement informe et dispersé.
Une unité de conception, un travail d’équipe très maîtrisée
Une fois la conception de chaque thème achevée, il faudra passer à l’exécution. Ceci implique qu’au préalable aient été recensés les moyens existants correspondant à chaque groupe de thèmes (il doit y avoir un compromis entre les moyens à rechercher en fonction de chaque « scénario » et l’infléchissement de ceux-ci en fonction de ce qui existe). Ce devra être, parallèlement à la consultation des groupes d’experts, la tâche du petit état-major multidisciplinaire dont il a été question plus haut.
Sous-traiter l’exécution au début, puis utiliser les moyens propres du Musée.
En ce qui concerne les travaux d’exécution destinés à réaliser l’architecture intérieure, les dispositifs de présentation, les éclairages, les textes, les audio-visuels, les programmes informatiques correspondant - autour des objets existants - à chaque scénario thématique, il faudra nécessairement dans un premier temps les sous-traiter à des entreprises extérieures sous la responsabilité de spécialistes (ceux qu’on appelle en anglais « designers »). Il est d’ailleurs souhaitable de faire appel à plusieurs spécialistes pour éviter une monotonie de présentation. Une fois le musée ouvert, et dès que des moyens internes (concepteurs, dessinateurs, ateliers, etc.) auront pu être mis en place, il sera possible de réaliser une grande partie des travaux d’exécution ultérieure avec les moyens du Centre, ce qui sera évidemment moins coûteux. Il n’existe malheureusement pas actuellement de moyens d’exécution disponibles qui pourraient éviter la sous-traitance externe : ceux du Palais de la Découverte sont vétustes et numériquement très insuffisants. En fait, plusieurs grandes expositions réalisées au cours des dernières années au Palais de la Découverte ont dû être sous-traitées, de même que les expositions réalisées par de grands établissements publics (CEA, EDF, CNES, etc.) dans le cadre des manifestations auxquelles ils ont participé.
B. LE CALENDRIER
Une réalisation interne progressive
1980 : Conception des thèmes
En supposant que les études d’architecture puissent s’engager dès l’année 1980, on peut espérer que la totalité des constructions nécessaires à l’établissement du Centre sera terminée vers la fin de 1983. Il serait évidemment regrettable que le Musée ne soit pas en mesure d’ouvrir dès les constructions terminées. Dans notre esprit, l’année 1980 étant utilisée pour la conception détaillée des thèmes du Musée, on disposerait d’environ deux ans et demi à trois ans pour l’exécution du contenu des thèmes. Ceci permettra sans doute de réaliser entre 25 000 et 30 000 m2 d’exposition, soit la moitié environ des présentations permanentes. À cela devraient s’ajouter quelques expositions temporaires particulièrement spectaculaires destinées à marquer l’ouverture du Centre. Le reste du contenu muséographique pourrait être réalisé progressivement au cours des trois années suivantes, c’est-à-dire jusqu’à la fin de 1986, ce qui créerait des possibilités intéressantes :
Fin 1986 : Achèvement des présentations quasi-permanentes
– celle de tenir compte des réactions du public, et de mesurer le degré de succès des différentes méthodes d’exposition utilisées ;
– celle de conserver une certaine souplesse dans le dimensionnement des installations communes et des zones de circulation en fonction du nombre de visiteurs effectif (une des difficultés rencontrées actuellement par le Centre Pompidou est que la plupart de ses installations n’ont pas été prévues pour le nombre de visiteurs qu’il reçoit en moyenne chaque jour) ;
– celle enfin, de réaliser une partie des expositions avec des moyens internes, ce qui permettra de faire des économies tout en formant directement les équipes qui seront appelées à assurer le renouvellement du Musée en régime de croisière.
Si seulement une partie du bâtiment, supposé complètement terminé, est accessible au public, ceci ne devrait pas introduire de gêne véritable. C’est la programmation initiale du bâtiment qui en sera rendue plus complexe car elle devra prendre en compte les besoins de souplesse dans les circulations et de spatialisation progressive des expositions.
Un ensemble bien représentatif présent dès l’ouverture
D’autre part, il est évident que les thèmes présents à l’ouverture du Centre doivent déjà constituer un ensemble suffisamment complet et représentatif. Ceci complique un peu le programme architectural. Dans notre esprit, les quatre grands domaines que nous avons définis devraient tous être présents au départ : c’est le contenu intérieur de chacun d’entre eux qui serait enrichi ensuite de façon progressive.
Une phase de préfiguration
Le type de Musée qui est décrit dans ce rapport est relativement peu connu en France et les expériences étrangères, tout en étant évidemment fort utiles, ne peuvent pas être entièrement probantes compte-tenu de la spécificité du public. Dans ces conditions, il nous paraitrait extrêmement souhaitable de réaliser avant l’ouverture du Musée, donc pendant les années 1982 et 1983, une véritable préfiguration de certains thèmes parmi les plus importants. Cette préfiguration utiliserait, sous une forme préliminaire, certains des moyens rassemblés en 1980 et 1981 sur quelques-uns des thèmes qui devront être présentés dès l’ouverture. Elle serait surtout destinée à expérimenter les méthodes de présentation audiovisuelles et informatiques et à évaluer les réactions du public, ce qui permettrait de réussir avec beaucoup plus de certitude les présentations ultérieures. Elle permettrait aussi de faire réagir et de recevoir les critiques et suggestions d’un grand nombre de personnes que les problèmes de présentation muséologique industrielle et scientifique intéressent, mais qui ne trouvent pas le cadre approprié pour présenter leurs idées. Cette préfiguration introduirait très peu de coûts supplémentaires dans la mesure où la plupart des moyens seraient réutilisés dans le Musée proprement dit, le seul problème étant celui du local où elle pourrait être réalisée. Peut-être l’une des Halles actuellement présentes sur le terrain, si son accessibilité à partir de la Porte de Pantin peut être obtenue sans que les travaux de développement du Parc en soient gênés, pourrait-elle fournir le cadre le plus approprié. Ceci permettrait en outre de commencer à sensibiliser le public au projet lui-même (on pourrait, par exemple, exposer en plus de la préfiguration de certains thèmes, une maquette de l’ensemble - Parc, Musée, Auditorium - des installations prévues).
Des études de public à faire dès 1980
D’autre part, des études de public au moyen d’enquêtes et de sondages devraient être réalisées pour guider le travail des programmateurs, qui doivent avoir assez tôt une idée précise de la nature et du nombre des visiteurs potentiels et des besoins exprimés par ceux-ci. Ces études permettraient en outre de bâtir une campagne de promotion du Centre, dans les mois qui précéderont son ouverture.
III FONCTIONNEMENT DU CENTRE
Il n’est pas dans notre propos de décrire de façon détaillée le fonctionnement du futur Centre de La Villette qui devra faire l’objet d’études plus approfondies. Cependant, puisqu’il est nécessaire de faire dès à présent des prévisions sur le budget annuel de fonctionnement du Centre, il est utile d’avoir déjà un certain nombre d’idées sur lis méthodes de fonctionnement et en particulier sur le personnel nécessaire, car les salaires représentent traditionnellement au moins 50% du budget annuel des Musées scientifiques et techniques.
A. LA GESTION DES EXPOSITIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES
Il est évident que le noyau essentiel du futur Centre devra être constitué par les moyens nécessaires pour la conception, la réalisation, l’entretien, le renouvellement et la présentation au public des expositions permanentes et temporaires.
Une équipe permanente pour la conception
Pour la conception, nous pensons qu’un petit état-major d’une douzaine de personnes composé en partie de scientifiques et techniciens et en partie de personnes ayant un profil de « designer » serait nécessaire en permanence.
Notre examen des Musées étrangers nous a montré que ceux qui sont les plus actifs et les plus attrayants sont ceux où une équipe intégrée de scientifiques et de décorateurs, travaillant ensemble de façon régulière, a pu être constituée.
Des moyens de production et d’entretien
Pour la réalisation et l’entretien, le Centre devrait être doté d’un ensemble d’ateliers et de laboratoires techniques permettant l’exécution des présentations et leur entretien. À ces ateliers devraient s’ajouter un centre de production de matériaux audiovisuels. Enfin, une équipe d’informaticiens serait nécessaire aussi bien pour la réalisation des éléments correspondants dans les thèmes que pour l’entretien de ceux-ci et la présentation au public, qui nécessitera la mise au point d’un grand nombre de programmes.
Un personnel spécialisé pour la présentation et l’explication, ayant reçu une formation particulière
D’autre part, il ne faut pas oublier la présentation et l’explication au public du contenu des thèmes. Bien qu’il soit proposé de pousser aussi loin que possible l’automatisation des présentations, il nous parait indispensable de prévoir la présence de personnels spécialisés capables d’aider le public dans son parcours à travers les expositions de façon à ce qu’il retire le maximum de fruit de sa visite, de faire chaque fois que c’est nécessaire des démonstrations et des petits exposés, en particulier pour le public scolaire, de veiller enfin au parfait fonctionnement des installations. Il nous semble que chaque thème important devrait avoir un responsable à la fois du bon développement du thème et de sa présentation au public. Ce responsable pourrait être assisté de deux personnes plus jeunes à temps partiel (en général des étudiants), de façon à assurer une présence pratiquement continue. Alternativement, on peut envisager de regrouper ces responsables, assistés de techniciens, en quelques équipes plus étoffées chargées de plusieurs thèmes correspondant à des domaines voisins.
En ce qui concerne le public scolaire, nous pensons que la charge très lourde qui consiste à assurer des visites programmées pour 2 000 à 2 500 élèves par jour devrait être partagée avec les éducateurs eux-mêmes à qui seraient proposés, comme nous l’avons dit, des séances d’information préalables et des documents écrits à utiliser dans leurs classes.
Le personnel de présentation et d’explication doit avoir un certain nombre de qualités très particulières : compétence, clarté d’exposition, aptitude au contact avec le public, etc. Ce personnel doit nécessairement bénéficier d’une formation spéciale qui pourra être dispensée par le Centre, en relation avec les autres Musées qui existent ou existeront sur le territoire national. Cette action de formation devrait être entreprise bien avant l’ouverture du Centre, en tenant compte bien sûr des moyens existants.
L’avantage d’avoir un personnel d’explication et de présentation, présent en permanence, est de réduire considérablement les besoins en gardiennage, qui ne se présentent d’ailleurs pas de la même façon que pour les Musées artistiques, pour lesquels le vol d’objets de collections constitue évidemment un très gros risque. Dans le cas présent, le risque le plus grand est celui du vandalisme. La combinaison de la surveillance par le personnel de présentation et par un nombre limité de gardiens en uniforme (environ une trentaine serait nécessaire en permanence pour la totalité des surfaces du Centre) permettrait sans doute de résoudre le problème. Il conviendrait en outre :
– d’installer un système de surveillance continue par caméras de télévision et salles de contrôle,
– de magnétiser tous les éléments mobiles des présentations, avec un système de détection aux sorties du Musée.
B - PHILOSOPHIE DES INVESTISSEMENTS : DEUX EXEMPLES
Étant donné la taille considérable imposée au Centre par la structure même du bâtiment principal, nous pensons que la philosophie générale de réalisation du Musée devrait tendre à accroitre au maximum les investissements destinés à réduire le budget de fonctionnement. Cette philosophie peut être poursuivie dans de nombreux domaines, mais nous voudrions insister plus particulièrement sur deux d’entre eux :
Trouver l’automatisation du centre
– L’automatisation : le Centre devant, de toutes manières avoir une équipe d’informaticiens, il nous semble que l’automatisation de la plus grande partie des fonctions du Musée devrait être poussée aussi loin que possible. Ceci pourrait concerner en particulier :
Faire un exemple pour les économies d’énergie
- l’automatisation des expériences elles-mêmes à l’intérieur des thèmes (mise en route, arrêt, dialogue avec le public, etc.)
- la gestion centralisée par ordinateur de tous les audiovisuels du Musée, avec possibilité de détection immédiate des pannes (ce système est utilisé avec succès dans le plus récent des Musées étrangers, celui de l’Air et de l’Espace de Washington),
- la gestion par ordinateur de tous les programmes de spectacles donnés dans le Musée (planétarium, cinéma, etc.),
- la distribution des billets d’entrée, le contrôle numérique des entrées et sorties, etc.,
- la détection des vols et la surveillance du public.
- l’énergie : L’un des objectifs pour le Musée de La Villette devrait être d’en faire, en particulier, le Musée des économies d’énergie. En d’autres termes, toutes les techniques modernes devraient être employées, aussi bien en ce qui concerne l’utilisation des sources d’énergie spécifiques que la mise en œuvre des méthodes d’économie (conservation, récupération et isolation). Nous pensons même que ceci devrait être l’une des clauses de la consultation des architectes. Ces solutions devraient être réalisées autant que possible de façon visible, de manière à servir de démonstration au public et d’éducation de celui-ci. Il semble, en effet, incontestable que l’un des problèmes essentiels des deux prochaines décennies sera de faire pénétrer dans le public la philosophie des économies d’énergie et de matières premières en général. Le Centre de La Villette devrait pouvoir jouer un rôle dans cet effort, Par ailleurs, il devrait y trouver lui-même un avantage appréciable dans la mesure où la facture d’énergie représente un poste important du budget de fonctionnement (la facture d’électricité seule du Centre Pompidou en 1978 était de 9 MF).
C. LE RÉGIME D’OUVERTURE AU PUBLIC
Un musée ouvert jusqu’à 21h
Si l’on veut toucher un public assez vaste, et si l’on veut que les fonctions du Centre soient suffisamment différenciées, il est important que le Centre soit ouvert au public pendant une période assez longue. Le Palais de la Découverte n’est ouvert que de 10h à 18h, six jours par semaine. Nous proposons que le Centre de La Villette soit ouvert six jours par semaine de 9h à 21h, soit pendant une durée hebdomadaire de 72 heures. Pendant les 4 jours ouvrables de la semaine, le Musée serait réservé de 9h à 12h au public scolaire. Le samedi et le dimanche, l’entrée générale se ferait dès 9h.
Le fait de rester ouvert jusqu’à 21h offrirait la possibilité de nombreuses actions orientées vers le public adulte : conférences et débats, séances spécialisées de cinéma, actions de formation permanente sur le Musée, etc. Entre 18h et 21h, il serait possible par contre de réduire peut-être de 50 % la présence du personnel nécessaire pour les présentations, dont une grande partie serait alors assurée de façon automatique.
Compte-tenu des congés annuels, des périodes de maladies, etc., les besoins en personnel nécessaire de façon continue (accueil, gardiens, personnel de logistique, présentations) devraient être calculés au coefficient 2,5. (2,5 personnes par poste effectivement occupé).
Le gardiennage et l’entretien
En ce qui concerne la sécurité du bâtiment et le gardiennage, ils devraient être, à notre avis, assurés par du personnel appartenant au Centre (sauf peut-être pour la sécurité contre l’incendie qui pourrait faire l’objet d’un accord avec les sapeurs-pompiers de Paris). Il faudrait que les gardiens soient recrutés et formés de façon à pouvoir également assurer des activités d’information et d’orientation du public, complétant en cela les présentations audio-visuelles d’accueil et le travail des présentateurs à l’intérieur des thèmes.
Par contre, l’entretien général du bâtiment, aussi bien en ce qui concerne le nettoyage que la maintenance technique générale, pourrait être avantageusement sous-traité à des entreprises extérieures (ceci évite en particulier la multiplication des postes permanents de spécialistes dont le besoin n’est qu’occasionnel).
Par contre, l’entretien et la réparation des expositions elles-mêmes serait assurée par le personnel technique du Centre. Il devrait y avoir dans le Centre, comme nous l’avons expliqué, deux structures qui s’emboîtent : la structure générale du bâtiment, dont l’entretien en serait sous-traité, et l’architecture intérieure des thèmes dont la maintenance qui exige une spécialisation, serait assurée par le Centre lui-même. Celle-ci serait d’ailleurs facilitée par la conception modulaire des éléments qui constituent les présentations thématiques.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Nous résumons ci-dessous les propositions de ce Rapport en vue de la création d’un Musée National des Sciences et de l’Industrie dans le cadre du Parc de La Villette.
1. Si l’on compare la situation française dans le domaine de la muséologie scientifique et technique à ce qui a été réalisé dans les grands pays industrialisés, il paraît évident qu’un besoin existe en la matière qui n’est pas satisfait par les établissements existants. Il est nécessaire en particulier de sensibiliser davantage le public français aux réalisations scientifiques et techniques et d’améliorer, dans notre pays et à l’étranger, l’image de la science et de l’industrie françaises.
2. Il est proposé de créer, principalement dans le cadre de la "Grande Salle’’ du Parc de La Villette, un Centre consacré à la présentation de la science et de la technologie modernes, et des réalisations industrielles les plus significatives. Une approche historique peut cependant être incluse dans les présentations, dans la mesure où elle permet d’éclairer la situation présente. Le Centre de La Villette incorporera les moyens du Palais de la Découverte, l’approche scientifique de celui-ci étant largement complétée par une plus grande ouverture vers la technologie et les réalisations industrielles. Des liens étroits seront établis avec le Musée des Techniques du Conservatoire National des Arts et Métiers et avec l’Académie des Sciences, pour faciliter la visibilité des collections et la possibilité d’emprunts.
3. Le Musée de La Villette organisera ses présentations de façon à ne pas créer de duplication avec les musées spécialisés (Muséum National d’Histoire Naturelle, Musée de l’Air et de l’Espace, etc.) mais s’efforcera au contraire de collaborer avec eux par des échanges et des expositions conjointes. Il devra s’intégrer dans un Réseau National regroupant les centres scientifiques et techniques régionaux qui sont actuellement dans leur phase de conception ou d’organisation. Il est proposé, pour faciliter ce regroupement, de créer rapidement une Association Nationale des Centres scientifiques et techniques.
4. Le Centre de La Villette doit s’adresser à un public aussi large que possible. L’approche pédagogique doit donc être conçue pour intéresser les visiteurs à des niveaux différents. Une attention particulière doit être portée sur le public jeune, qu’il faut intéresser très tôt à la science et à la technique.
5. La partie centrale du Musée devra comporter des présentations quasi-permanentes (c’est-à-dire à renouvellement lent, en moyenne tous les dix ans) équilibrées et représentatives. Ces présentations se feront selon une approche thématique et non disciplinaire, intégrant les aspects scientifiques, techniques et industriels. Elles seront cependant regroupées en quelques grandes sections et arrangées topologiquement de façon à faire apparaître les liaisons qui existent entre elles. Des thèmes unificateurs horizontaux, traitant de quelques grandes questions qui recouvrent plusieurs sujets (l’énergie, l’information, etc.) seront également présents.
6. Les présentations thématiques doivent comporter des objets, anciens et modernes, intégrés dans des ensembles explicatifs, utilisant largement les méthodes audiovisuelles les plus récentes et les applications de l’informatique. L’atmosphère générale doit être agréable, du point de vue des couleurs et de l’éclairage, et ne pas comporter une trop grande concentration des collections.
7. Les thèmes doivent incorporer aux endroits où c’est possible, quelques éléments très spectaculaires permettant d’attirer le public vers le Centre de La Villette. Les présentations doivent également s’efforcer de répondre, d’une manière sérieuse et honnête, aux questions que le public se pose au sujet de l’impact de la science et de la technique sur la vie, l’environnement et la société.
8. À côté des présentations quasi-permanentes, des actions temporaires sont nécessaires, pour suivre l’actualité et favoriser une politique dynamique de promotion industrielle. Les actions réalisées avec l’industrie et les grands établissements publics seront orientées à moyen et à long terme, leur but essentiel étant de constituer une vitrine des réalisations industrielles françaises au moment où celles-ci peuvent avoir le plus d’impact.
9. Le Musée ne doit pas se contenter de faire des présentations, mais doit jouer un rôle dynamique dans la promotion de la science et de la technique et dans la sensibilisation du public. Il doit, en particulier en ce qui concerne les économies d’énergie et l’utilisation de l’informatique, jouer un rôle exemplaire. Pour rendre compte de ces fonctions multiples, un nom spécifique devrait être trouvé pour le Centre, suivi de la mention « Musée National des Sciences et de l’Industrie ».
10. Parmi les activités qui permettent de valoriser les présentations du Musée, une attention particulière devra être apportée à l’action en milieu scolaire et à la formation permanente expérimentale basée sur les moyens du Musée.
11. Le Centre de La Villette devra s’efforcer de jouer un rôle dans le domaine de l’information scientifique et technique. Il devra être doté d’une bibliothèque des sciences et des techniques, largement ouverte au public et d’accès gratuit, couvrant en particulier les ouvrages de référence et les textes de base, ainsi que les ouvrages et revues de vulgarisation. Cette bibliothèque pourra comporter également une section de prêt. Le Centre sera doté d’une photothèque technique ainsi que d’une cinémathèque scientifique et d’une banque de séquences audio-visuelles.
12. Le Centre pourra fournir une structure d’accueil à de petits groupes de chercheurs appartenant à d’autres organismes scientifiques, travaillant sur l’histoire des sciences et des techniques, sur la pédagogie scientifique et sur les relations entre la science et l’industrie avec la société et l’économie. Ces groupes de recherche apporteront en contrepartie une contribution aux activités du Musée.
13. Le Centre devra être doté de moyens techniques et audio-visuels de production de matériels destinés à ses propres présentations, qui pourront être également diffusés à des organismes extérieurs.
14. Le Musée de La Villette doit disposer des installations nécessaires à l’accueil du public (planétarium, salle de conférences et de cinéma, salles de réunions, etc.). L’ouverture du Centre devrait se faire de 9h à 21h, six jours par semaine, de façon à permettre l’organisation d’activités tournées vers le public adulte. En semaine, le Musée serait réservé, de 9h à 12h, au public scolaire. L’entrée du Musée, du planétarium et, dans certains cas, de la salle de cinéma, serait payante. Cependant, il serait créé une zone libre de 6 000 m2 environ au rez-de-chaussée, permettant d’accueillir et de diriger le public entre les différents services du Centre, de l’informer sur les activités de celui-ci et sur les dernières actualités scientifiques et techniques, de l’attirer enfin vers les présentations du Musée.
15. Les présentations quasi-permanentes pourraient couvrir une surface de 50 000 à 60 000 m2, ce qui est tout à fait comparable aux surfaces offertes par les grands Musées de Chicago et de Munich, dans la mesure où les expositions du Centre seront beaucoup plus aérées. Elles seraient réalisées progressivement, à la différence des constructions qui seraient faites en une seule fois. Au moment de l’ouverture du Musée, prévue en 1983, la moitié environ de ces présentations devrait être terminée, cette partie constituant déjà un ensemble suffisamment représentatif et spectaculaire. Le reste serait achevé avant la fin de 1986. Des expositions temporaires, y compris des actions industrielles, seraient organisées dès l’ouverture, en 1983.
16. Pendant la phase de construction, la conception et la réalisation du contenu du Musée se feraient à l’intérieur de l’Établissement Public d’Aménagement du Parc de La Villette. Il est indispensable de maintenir une grande unité dans la conception des présentations, dont la réalisation devra faire intervenir beaucoup de spécialistes et de représentants du public. Avant l’ouverture, une structure administrative appropriée devra être mise en place, qui prendra la relève, pour ce qui concerne le Centre, de l’Établissement Public d’Aménagement.
ANNEXE
LES THÈMES ET LEUR STRUCTURE
Cette Annexe a pour but de donner au lecteur une meilleure idée de la nature exacte de l’approche thématique intégrée proposée pour le Musée. Elle comporte :
1. L’analyse détaillée de deux thèmes de nature « verticale »
– La Lumière, qui devrait faire partie de la section sur « La Matière et la Technique », mais dont les relations avec les autres sections sont, comme on le verra, assez nombreuses.
– Le Milieu Intérieur des organismes vivants, qui devrait faire partie de la section sur la Vie.
Dans chacun des cas, on a donné d’une part les idées principales qu’il faut essayer de transmettre au visiteur et d’autre part des exemples d’illustrations possibles de ces idées.
Ces deux thèmes ont été analysés, l’un par l’équipe du Professeur G. DELACÔTE, de l’Université PARIS VII, l’autre par le Professeur J. HAMBURGER, Directeur du Centre de recherches néphrologiques de l’Hôpital Necker, et ses collaborateurs. Je voudrais les remercier ici très vivement pour cette collaboration.
2. Quelques idées de thèmes possibles pour le Musée, répartis à l’intérieur des quatre grandes sections.
Les thèmes horizontaux envisagés ont été indiqués dans le texte du Rapport (page 33). On a également illustré sur la Figure 1 (page 35) une structuration logique possible des thèmes les uns par rapport aux autres.
I. THÈME LUMIÈRE
L’espace total proposé pour le thème « Lumière » sera divisé en espaces principaux appelés nœuds et espaces secondaires appelés satellites.
Le parcours proposé pour le thème pour un premier contact rapide est celui des six nœuds dans un ordre quelconque. Chaque nœud est identifié par un panneau rappelant le contenu des autres nœuds et de leurs satellites et insistant sur le contenu du nœud où se trouve le visiteur.
Des satellites entourent chaque nœud, soit en impasse, soit en assurant le lien entre deux nœuds. Plusieurs manières de différencier le nœud du satellite peuvent être imaginées, en particulier les différences de niveau. À l’entrée de chaque satellite sera clairement expliqué le caractère d’approfondissement ou de développement de celui-ci par rapport au nœud dont il dépend. Le visiteur pourra donc programmer sa visite autour du parcours principal en y ajoutant à son gré des excursions dans les satellites de son choix.
On offrira en priorité dans les satellites, des possibilités d’expérimentation pour enfants et adultes (manipulations autonomes de matériel).
Les consoles d’interrogation à la disposition des visiteurs peuvent avoir soit une fonction locale, soit une fonction d’interrogation sur l’ensemble des thèmes, permettant ainsi au visiteur une mise en relation, une structuration de ses observations faites au cours de son périple dans l’espace du thème. Ces consoles seront aisément différenciables les unes des autres.
On pourra prévoir des espaces pour s’asseoir qui seront situés aussi bien dans l’ensemble des nœuds et des satellites que dans certaines zones de transition entre nœuds.
On veillera particulièrement à ce que les jeunes enfants, ainsi que les handicapés, aient visuellement accès aux présentations.
L’arrangement spatial des nœuds et des satellites est illustré sur la figure 2.
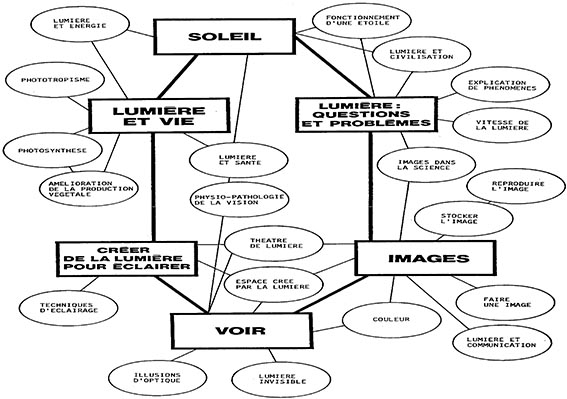
A. LES NŒUDS
| Idée principale | Illustrations principales |
| 1 Soleil | |
-* Le soleil, astre apparemment paisible, est le siège d’une série de phénomènes impressionnants :
|
-* Maquette animée du soleil en 3D
|
| 2 Lumière et vie | |
| -* Le soleil est la principale source d’énergie du monde vivant. C’est sur le monde végétal que ce phénomène est le plus apparent (sinon il faut considérer les chaines alimentaires) En choisissant les paramètres de l’environnement et les espèces végétales, l’homme peut parvenir à maitriser cette énergie.
|
-* Serre tropicale (température contrôlée 26°, humidité 100 %, éclairage naturel et renforcé).
|
| 3 Créer de la lumière pour éclairer | |
L’homme peut créer de la lumière "FIAT LUX".
|
De la lampe à huile au laser : rétrospective et diversité des sources d’éclairage. |
| 4 Voir | |
| La lumière est indispensable à la vision. Elle doit rentrer dans l’œil de l’homme (ou dans celui des autres êtres vivants) pour y induire des processus physiologiques dont l’exploitation est gouvernée par le cerveau. La lumière est donc véhicule d’information. Dans le cas de l’homme, il s’agit de lumière "visible". Il existe des lumières invisibles. Même lorsque celles-ci rentrent dans l’œil, elles ne sont pas perçues. Par contre, elles peuvent être dangereuses pour l’œil. | -* Grande maquette de l’œil humain en 3D Les rayons lumineux sont concrétisés par un faisceau laser ; l’incidence de ce faisceau varie régulièrement ainsi que les caractéristiques du cristallin et du fond de la rétine.
|
| 5 Images | |
| Le procédé de fabrication d’image est très général, indépendant de la nature du rayonnement (IR, Visible, UV, X, etc.). Il consiste à extraire l’information d’un rayonnement issu d’une source et ayant interagi avec un objet (sauf dans le cas de l’image directe d’une source). |
-* Exemples d’images :
|
| 6 Lumière Questions et problèmes | |
| Qu’est-ce que la lumière : une question permanente de l’homme, puis du physicien. La lumière est-elle descriptible en termes d’ondes ou de particules ? |
-* Réflexion et Réfraction :
|
B - SATELLITES
| Idée principale | Illustrations principales |
| 1 Autour du nœud Soleil | |
| a) Fonctionnement d’une étoile | |
| Cas particulier : le Soleil Toute étoile évolue : elle se forme, se développe et tend vers un stade final (naine blanche, étoile à neutrons, trou noir) où elle rayonne très peu. On peut expliquer le fonctionnement d’une étoile par les lois de la physique. On mettra aussi bien l’accent sur les connaissances que l’on a de la vie des étoiles que sur les moyens d’obtenir ces connaissances (spectres). |
-* Maquette animée montrant· l’évolution chronologique d’une étoile.
|
| b) Lumière et énergie | |
Regroupement d’un certain nombre d’aspects du rôle énergétique de la lumière (le développement en serait fait dans une autre partie du musée, autour des thèmes Énergie ou Écologie) :
|
Peut contenir des illustrations spécifiques mais aussi une présentation condensée d’illustrations existant dans d’autres parties du musée.
|
| c) Lumière et civilisation | |
| Culte solaire et compréhension scientifique. Le rôle central du soleil dans la culture a eu un effet à la fois inhibiteur et promoteur sur une approche scientifique. Place du Soleil dans l’Univers, Copernic. |
- Maquette d’observatoire (Stonehenge, Carnac...)
|
| 2 Autour du nœud Lumière et Vie | |
| a) Photosynthèse | |
| Elle utilise l’énergie et l’oxyde de carbone pour stocker cette énergie et fabriquer les éléments nécessaires à la plante. La photosynthèse est distincte de la respiration de la plante. Il existe deux grands systèmes photosynthétiques suivant le métabolisme de la plante. |
-* Maquette de la feuille, de son contenu (cellules, chloroplastes, pores) avec plusieurs niveaux successifs d’agrandissement.
– Manipulation : analyse de C02. Il est possible de faire varier l’éclairage, la longueur d’onde, le débit de C02 ... et d’observer les résultats. |
| b) Amélioration de la production végétale | |
| Montrer l’intérêt des connaissances acquises pour tirer davantage parti de l’énergie solaire sur le plan nutritionnel en utilisant conjointement des connaissances scientifiques et empiriques. | - Répartition géographique des cultures en fonction des conditions climatiques.
– Tri des meilleures "capacités végétales". – Sélection et création de nouveaux génotypes. |
| c) Lumière et santé | |
| Lumière : agent thérapeutique, indispensable au développement, outil médical. À la fois utile et dangereuse. |
- Films et présentations audiovisuelles de réalisations médicales.
– Rachitisme et vitamine D. – Éventuellement diorama d’une opération. Pas de manipulation possible, les effets étant lents et le "matériel" fragile. |
| d) Phototropisme : végétaux et animaux | |
| Plantes et animaux sont sensibles à la lumière et adaptent leur comportement à l’éclairage. | - Élevage d’animaux sensibles à la lumière (ex : blatte). |
| 3 Créer de la lumière pour éclairer | |
| a) Technique d’éclairage artificiel | |
| L’éclairage joue un rôle dans le confort et la sécurité, dans le cadre du travail, du transport ou de l’habitat. | Exemple de différentes situations de la vie courante bien ou mal éclairées en fonction du but à atteindre (pièce d’habitation, autoroute, passerelle de navire, studio d’enregistrement de télévision... ) en grandeur réelle ou en simulation. |
| b) Théâtre de lumière | |
| Présentation synthétique des effets de lumière dans la perception. | Présentation d’un mur d’images appelées successivement et mettant en scène différents aspects du rôle de la lumière et de la couleur-dans la perception. |
| c) Comment créer l’espace avec la lumière | |
| À l’aide de jeux de lumière, il est possible de construire des volumes et donc de structurer l’espace. Application à l’architecture. | Création d’espaces lumineux à l’aide de matériaux légers (filets, etc.) ou de projecteurs. On pourra analyse-certains exemples issus du musée lui-même où l’on a utilisé la lumière pour moduler l’espace. |
| 4 Voir | |
| a) Illusions d’optique | |
| La perception résulte d’une interaction entre les stimuli effectifs et un traitement du cerveau s’appuyant sur un certain nombre de préalables. | -* Chambre d’Ames
|
| b) Physiologie et pathologie de la vision | |
| Décrire les principaux aspects des fonctionnements et dysfonctionnements de l’œil et de la partie du cerveau qui lui est reliée, y compris dans le cadre des modes de vision différents rencontrés dans le monde animal. | - Maquettes de la rétine.
– Diorama d’une expérimentation de neurophysiologie de l’œil. |
| c) Couleur | |
Deux aspects principaux :
|
- Synthèse additive et soustractive
– Ombres en couleur |
| d) Lumière invisible | |
| La lumière fait partie d’un ensemble plus vaste : le rayonnement. Seule une petite partie de ce rayonnement est visible. Cependant, les rayonnements les plus proches du visible (IR) et (UV) peuvent être détectés et utilisés. | Effets visibles de lumière invisible.
– Lumière noire – Détection des IR par cristaux liquides – Caméra infrarouge. |
| 5 Images | |
| a) Images de la science | |
| Satellite de synthèse faisant le point des différents procédés permettant le recueil d’informations différentes. Résumé des techniques industrielles de pointe. |
- Utilisation des images en météo, scanner, échographie.
|
| b) Faire une image | |
| Différents procédés de fabrication d’une image. Problème de traitement de l’information. |
- Manipulation avec projecteur de diapositives permettant de montrer que toute l’information contenue dans l’image est présente en tous points du faisceau lumineux lorsque celui-ci n’a pas été traité par une lentille. |
| c) Stocker l’image | |
| On présentera les procédés anciens et modernes de stockage de l’image (photo, cinéma, magnétoscope, vidéodisque) et leurs principes de fonctionnement. | Exemples des principales techniques avec appareillage en activité. |
| d) Reproduire l’image | |
| Présentation des procédés techniques de reproduction de l’image : tramage, offset... | - Banc de développement photo-automatique
– Photocopie, – etc. |
| e) Lumière et communication | |
| Présentation des techniques de transmission de l’information par canal lumineux. | - Lecture d’un vidéodisque par laser
– Communication par guide de lumière. – Miniaturisation en optoélectronique. |
| 6 Lumière : questions et problèmes | |
| a) Vitesse de la lumière | |
Deux aspects principaux :
|
- Laser à picoseconde
– Méthodes historiques et récentes de mesure de la vitesse. – Téléphone par satellite – Réseau de synchronisation mondiale des horloges. |
| b) Explication de certains phénomènes physiques | |
| - Certains phénomènes physiques posent le problème du modèle de la lumière.
– Lumière : onde ou corpuscule ? – Polarisation – Émission, absorption, réflexion. – Qu’est-ce qu’un photon ? – Explication du laser. |
Manipulations de physique et maquettes |
II. THÈMES "LE MILIEU INTÉRIEURE"
| Idée principale | Illustrations principales |
| 1 Une mer intérieure que nous avons en nous | |
| Claude Bernard crée le concept de milieu intérieur (1859). Claude Bernard, l’homme qui "découvrait comme d’autres respirent" (P. Bert) L’aventure de sa vie. L’homme avant Claude Bernard : un cerveau perché sur un cœur, deux poumons, un foie, un tube digestif, deux reins, etc. L’homme après Claude Bernard : 50 à 100 mille milliards de cellules vivant en société communautaire sur les bords d’une mer intérieure, par où se font échanges et communications. |
Opposer :
|
| 2 La régulation du milieu intérieur | |
| Nous ne pouvons vivre que si la composition chimique de notre milieu intérieur demeure constante. Deux exemples des systèmes de contrôle et de régulation : 1 Le rein : Comment on s’aperçut que le rein n’était pas un simple appareil à éliminer des déchets, mais bien le maitre-régulateur du milieu intérieur. 2 Les glandes endocrines Deux exemples : les surrénales et les parathyroïdes. |
- Images du mouvement perpétuel d’entrées et de sorties, avec bilan équilibré et milieu intérieur stable.
– Tableaux animés de ce qui arrive en cas de carence ou d’excès
|
| 3. Quand la maladie déséquilibre le milieu intérieur | |
| Histoire du concept de "réanimation médicale". | Histoire de quatre malades sauvés par la réanimation : 1 Nourrisson : "toxicose" par diarrhée aiguë 2 Adultes : une intoxication par champignons 3 Adultes : une intoxication par l’oxyde de carbone 4 Adultes : une grande hémorragie externe |
| 4. L’effort industriel au service de la réanimation médicale et de la correction des déséquilibres du milieu intérieur | |
| - Surveillance des périodes critiques | - Les stimulateurs cardiaques « sentinelles »
– Les systèmes de surveillance continue en réanimation. – Les appareils à dosages chimiques « instantanés ». |
| - La correction par les médicaments : l’industrie pharmaceutique
– La correction par des appareils de suppléance. |
- L’aventure exemplaire des médicaments diurétiques
– Les reins artificiels – Les respirateurs artificiels – Les cœurs-poumons artificiels |
III QUELQUES THÈMES POSSIBLES
La liste qui suit, qui n’est donnée qu’à titre indicatif, est tout à fait provisoire. C’est justement le travail approfondi qui sera fait en 1980 qui permettra de définir une liste équilibrée et conforme à l’esprit proposé pour la conception du Musée. Par ailleurs, il faudra choisir dans chaque grande section les thèmes qui devraient être présentés dès l’ouverture et constituer par conséquent déjà un ensemble suffisamment représentatif.
L’UNIVERS
– Les vingt derniers milliards d’années (liaison avec la Vie)
– L’aventure cosmique (l’astronomie, l’évolution de l’Univers)
– La recherche spatiale (l’environnement de la terre, les planètes, les utilisations de l’espace)
– La terre
– L’atmosphère - Les climats - La météorologie
– L’eau (liaison avec la Vie)
– Les ressources naturelles
– Le temps (liaison avec la Matière et la Technique)
LA VIE
– La biochimie - La cellule vivante
– L’immunologie
– Le milieu intérieur du corps humain
– Le cerveau et le système nerveux
– Les paramètres fondamentaux du corps et les méthodes de diagnostic
– La génétique, l’hérédité
– La nutrition
– L’agriculture
LA MATIÈRE ET LA TECHNIQUE
Les mathématiques de notre vie (probabilités, analyse des systèmes, notions sur les formes et les fonctions)
– La lumière
– Les sons
– L’électricité, l’électronique, le magnétisme
– L’atome
– La physique du solide, les télécommunications
– L’informatique et la télématique
– Automatismes et contrôle
– La mécanique et la sidérurgie
– La chimie industrielle - Les matières plastiques
LES SOCIÉTÉS HUMAINES
– De l’éthologie à l’écologie (liaison avec la Vie)
– La Ville (architecture, habitat, urbanisme)
– Les transports - L’Aviation (liaison avec l’Univers)
– Le langage ; la communication
– L’économie ; les scénarios du futur
– L’archéologie
LES ÉTUDES DU MUSÉE NATIONAL DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES INDUSTRIES
N°1 - LES CLUBS SCIENTIFIQUES EN FRANCE
N°2 - POUR UN CENTRE D’HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES A LA VILLETTE
N°3 - LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
N°4 - SE FORMER A LA VILLETTE
N°5 - JANUS, BILAN DES RÉACTIONS DES VISITEURS - TOMES 1 ET 2
N°6 - POUR UN ESPACE PETITE ENFANCE A LA VILLETTE
N°7 - LA MÉDIATHÈQUE
N°8 - CHARTE DES PERSONNES HANDICAPÉES
N°9 - UNE "MAISON DES ASSOCIATIONS" AU MUSÉE DE LA VILLETTE
N°10 - LES MANIFESTATIONS ITINÉRANTES « POUR UN CENTRE DE RESSOURCES A LA VILLETTE »
N°11 - LA MUSÉABILITÉ DES RELATIONS ENTRE SCIENCES, TECHNIQUES ET ÉVOLUTION DES SOCIÉTÉS
N°12 - LA PLACE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU MUSÉE DE LA VILLETTE
N°13 - POUR UN MUSÉE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE (Rapport Lévy)
LES ÉTUDES N°13
POUR UN MUSÉE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
Réalisation-Diffusion : Éditions / Publications, Département Liaisons Extérieures
Cité des Sciences et de l’Industrie.
Tour Pariféric - 6 avenue Émile Reynaud - 93306 AUBERVILLIERS CEDEX
Tél. 839 .87 .30
Impression : ARD, Courbevoie

